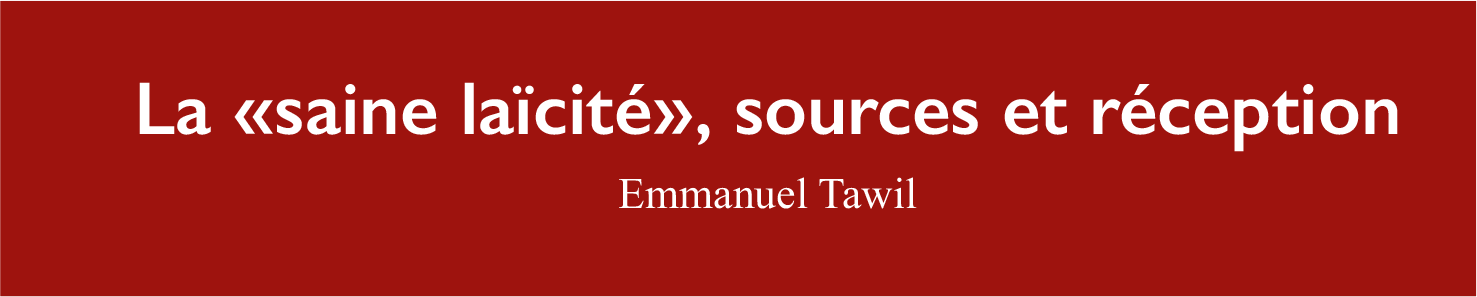
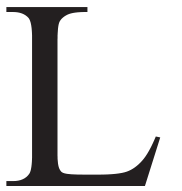 e discours de Pie XII à la Colonie des Marches a un caractère quelque peu exceptionnel dans le magistère du Pasteur Angélique. Pie XII n’a fait référence à la laïcité de l’Etat qu’une seule fois, dans ce discours, qu’il prononce à l’extrême fin de son pontificat.
e discours de Pie XII à la Colonie des Marches a un caractère quelque peu exceptionnel dans le magistère du Pasteur Angélique. Pie XII n’a fait référence à la laïcité de l’Etat qu’une seule fois, dans ce discours, qu’il prononce à l’extrême fin de son pontificat. 
A l’époque, l’emploi du mot laïcité surprend. Il n’y a pas de précédent de l’emploi dans le magistère pontifical depuis Léon XIII, qui sans interruption fait reposer les relations Eglise-Etat sur la doctrine de la société parfaite1.
I. Le caractère inédit de l’utilisation du mot laïcité dans un cadre ecclésial
Laïcité : on a finit par l’oublier, mais le mot sentait le souffre en 1958. Comment en est-on arrivé à ce que le mot puisse être utilisé dans un sens positif par un Souverain Pontife ?
Une étape importante.
En effet, à la Libération, l’épiscopat français se prononce sur le sens à donner au mot « laïcité ». Dans la déclaration de l’épiscopat français du 13 novembre 1945, sur la personne humaine, la famille et la société, les évêques distinguent plusieurs sens possibles de la « laïcité de l’Etat » et, pour chacun des sens possibles, apprécient dans quelle mesure ils sont ou non en conformité avec la doctrine catholique.
Le premier sens possible est
« la souveraine autonomie de l’Etat dans son domaine de l’ordre temporel, son droit de régir seul toute l’organisation politique, judiciaire, administrative, fiscale, militaire de la société temporelle, et, d’une manière générale, tout ce qui relève de la technique politique et économique ».
Dans ce sens, le mot laïcité est en pleine conformité avec la doctrine catholique. Les évêques relèvent que
« les souverains pontifes ont affirmé à maintes reprises que l’Eglise ne songeait nullement à s’immiscer dans les affaires politiques de l’Etat. Ils ont enseigné que l’Etat était souverain dans son domaine propre. Ils ont rejeté comme une calomnie l’ambition qu’une propagande perfide prête à l’Eglise de vouloir s’emparer du pouvoir politique et dominer l’Etat. Ils ont rappelé aux fidèles le devoir de soumission aux pouvoirs établis ».
Un deuxième sens de la laïcité est admissible par l’Eglise catholique :
« La ‘laïcité de l’Etat’ peut aussi être entendue en ce sens que, dans un pays divisé de croyances, l’Etat doit laisser chaque citoyen pratiquer librement sa religion ».
Ce deuxième sens est également en conformité avec la doctrine catholique :
« Ce second sens, s’il est bien compris, est lui aussi conforme à la pensée de l’Eglise. Certes, l’Eglise est loin de considérer que cette division des croyances soit, en thèse, l’idéal, car nous qui aimons le Christ, nous voudrions que tous le connaissent, l’aiment et trouvent en lui et dans son Eglise leur lumière et leur force. Mais l’Eglise, qui veut que l’acte de foi soit fait librement, sans être imposé par aucune contrainte extérieure, prend acte du fait de la division des croyances ; elle demande alors simplement sa liberté pour remplir la mission spirituelle et sociale que lui a confiée son divin Fondateur ».
Outre les deux sens acceptables de la laïcité, les évêques en distinguent deux autres, qui sont eux complètement en contradiction avec la doctrine catholique, et sont donc inacceptables.
Le premier sens inacceptable est celui qui définit la laïcité comme « une doctrine philosophique qui contient toute une conception matérialiste et athée de la vie humaine et de la société » et « un système de gouvernement politique qui impose cette conception aux fonctionnaires jusque dans leur vie privée, aux écoles de l’Etat, à la nation toute entière ». La laïcité ainsi définie est en contradiction avec la « vraie mission » de l’Eglise et de l’Etat.
Le second sens inacceptables de la laïcité est celui qui la définit comme
« la volonté de l’Etat de ne se soumettre à aucune morale supérieure et de ne reconnaître que son intérêt comme règle de son action ». Les évêques condamnent une laïcité ainsi définie. Cette laïcité serait « dangereuse, parce qu’elle justifie tous les excès du despotisme et provoque, chez les détenteurs du pouvoir, quel qu’il soit -personnel ou collectif- les tentations naturelles de l’absolutisme : elle conduit tout droit à la dictature ».
Pie XII a-t-il connaissance de la déclaration de l’Episcopat français ? Très probablement. L’ouverture des archives du pontificat permettra de s’en assurer.
L’on notera que la laïcité définie par Pie XII ne rompt pas avec la doctrine du droit public ecclésiastique, dont elle met en avant quelques éléments.
S’agissant de la distinction des deux pouvoirs, de l’autonomie légitime du pouvoir temporel, et du fondement évangélique de ces principes, Pie XII se situe parfaitement dans la suite des textes qui définissent l’Eglise et l’Etat comme deux sociétés parfaites : l’Eglise, tant que l’Etat, possède « en soi et par elle-même toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action »2. L’autonomie de l’Etat dans son ordre propre, c’est-à-dire sa laïcité, correspond clairement au principe posé par Léon XIII selon lequel les « choses qu'embrasse l'ordre civil et politique, il est juste qu'elles soient soumises à l'autorité civile, puisque Jésus-Christ a commandé de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »3.
II. La réception limitée de la doctrine de la « saine laïcité »
L’on ne s’est pas assez interrogé sur la réception de la « saine laïcité ».
Si l’on compare le discours à la Colonie des Marches au sort d’autres textes de Pie XII, par exemple au radio-message du 24 décembre 1942 qui mentionne les droits de la personne humaine4 et qui est cité comme source de Pacem in Terris5 et de Gaudium et Spes6, l’on ne peut qu’être surpris par la faible réception qu’il a connu.
Si la « légitime et saine laïcité » n’apparaît pas dans les textes du Concile Vatican, trois idées qui y correspondent sont présentes: la distinction des sociétés civile et religieuse 7 ; la coopération entre deux sociétés8 ; l’autonomie des réalités temporelles9 qui sont régies par ses « lois propres »10. La définition de Pie XII est donc parfaitement compatible avec la doctrine conciliaire, mais sans que la « saine laïcité » ne soit mentionnée.
Ce qui est en revanche important pour les Pères conciliaires, c’est la liberté religieuse, à laquelle ils consacrent la déclaration Dignitatis Humanae.
Pour voir réapparaître la laïcité dans un document pontifical, il faut attendre la lettre du Pape Jean Paul II aux évêques de France du 11 février 2005, à l’occasion du centenaire de la loi de 1905, qui affirme que : « Le principe de laïcité […] s’il est bien compris, appartient aussi à la Doctrine sociale de l’Eglise. Il rappelle la nécessité d’une juste séparation des pouvoirs (cf. Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, nn. 571-572), qui fait écho à l’invitation du Christ à ses disciples: ‘Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu’ (Lc 20, 25). Pour sa part, la non-confessionnalité de l’État, qui est une non-immixtion du pouvoir civil dans la vie de l’Eglise et des différentes religions, comme dans la sphère du spirituel, permet que toutes les composantes de la société travaillent ensemble au service de tous et de la communauté nationale.» 11
Jean Paul II insiste sur la distinction entre la laïcité et « un type de laïcisme idéologique ou de séparation hostile entre les institutions civiles et les confessions religieuses »12.
Quand Benoît XVI reprend l’usage du mot « Laïcité », en ajoutant le qualificatif « positif », il a cru qu’il ne surprendrait pas.
L’on ignore trop souvent que la formule « laïcité positive » a son origine dans un discours prononcé par M. Jean-Pierre Chevènement à l’occasion de l’ordination épiscopale de Mgr Joseph Doré, le 23 novembre 1997. Le ministre de l’Intérieur du Gouvernement Jospin, souligne que, malgré la diversité des régimes des cultes, les Pays européens avaient en commun un certains nombre de principes :
« Ce qui nous distingue compte moins que ce qui nous est commun : la liberté de choisir sa religion, y compris celle de n’en pas choisir, le rejet de toute discrimination au regard de son appartenance confessionnelle, le respect rigoureux des consciences et donc des croyances, la soustraction du débat public et de l’activité scientifique à l’empire de quelque dogme particulier, le droit au libre examen, sans borne et sans exclusive, le refus des intégrismes fanatiques, voilà quelques acquis essentiels de la sécularisation de nos sociétés européennes ».
De ce rapprochement, le ministre de l’Intérieur déduit que « la laïcité positive, la laïcité républicaine, au sens étymologique du mot, fait partie du message de l’Europe ».
Lorsqu’il est ministre de l’Intérieur du Gouvernement Raffarin, Nicolas Sarkozy emploie de nouveau la formule « laïcité positive »13. Devenu président de la République, il a l’occasion de théoriser cette notion dans le discours qu’il a prononcé au Palais du Latran, après la cérémonie au cours de laquelle il est reçu comme Chanoine d’honneur de la Basilique de Saint-Jean de Latran14. Dans le discours de Nicolas Sarkozy au Latran, la laïcité positive est présentée comme un objectif : garantir la liberté de conscience, ce qui peut être atteint, précise le président de la République, sans qu’il soit besoin de modifier la loi de séparation. La laïcité positive ne considère pas les religions comme dangereuses et promeut le dialogue : l’Etat doit « rechercher le dialogue avec les grandes religions de France et […] avoir pour principe de faciliter la vie quotidienne des grands courants spirituels plutôt que de chercher à la leur compliquer ».
Le Pape Benoît XVI, emploie la formule « Laïcité positive » pour la première fois à l’occasion de son voyage en France en septembre 2008 dans les termes suivants:
« Sur le problème des relations entre la sphère politique et la sphère religieuse, le Christ même avait déjà offert le principe d’une juste solution lorsqu'il répondit à une question qu'on Lui posait : ‘Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu’ (Mc 12,17). L’Eglise en France jouit actuellement d’un régime de liberté. La méfiance du passé s'est transformée peu à peu en un dialogue serein et positif, qui se consolide toujours plus. Un nouvel instrument de dialogue existe depuis 2002 et j'ai grande confiance en son travail, car la bonne volonté est réciproque. Nous savons que restent encore ouverts certains terrains de dialogue qu'il nous faudra parcourir et assainir peu à peu avec détermination et patience. Vous avez d'ailleurs utilisé, Monsieur le Président, la belle expression de ‘laïcité positive’ pour qualifier cette compréhension plus ouverte. En ce moment historique où les cultures s’entrecroisent de plus en plus, je suis profondément convaincu qu’une nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l’importance de la laïcité est devenue nécessaire. Il est en effet fondamental, d’une part, d’insister sur la distinction entre le politique et le religieux, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l’État envers eux, et d’autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu’elle peut apporter, avec d’autres instances, à la création d’un consensus éthique fondamental dans la société »15.
Puis en 2010, l’Instrumentum Laboris de l’Assemblée spéciale du Synode des Evêques réuni pour le Moyen-Orient, envisage la laïcité positive comme un moyen de dépasser le confessionnalisme musulman des Etats arabes16.
Les membres du Synode rejettent cette notion de laïcité positive, qu’ils estiment peu pertinente dans le contexte du Moyen-Orient Selon le rapporteur, Mgr Naguib, certains participants ont une réaction « d’allergie », tandis qu’un évêque explique :
« Cette laïcité nous pose problème, à nous chrétiens orientaux. Elle a un arrière-goût français, d’opposition à l’Église. Or nos pays sont religieux et nous voulons un espace pour l’Église sur la place publique. Il ne faut pas laisser penser que la foi est une menace pour la liberté »17.
Les Pères synodaux insistent en revanche sur la liberté de culte : « Au Moyen-Orient, les chrétiens partagent avec les musulmans la même vie et le même destin. Ils édifient ensemble la société. Il est important de promouvoir la notion de citoyenneté, la dignité de la personne humaine, l’égalité des droits et des devoirs et la liberté religieuse comprenant la liberté du culte et la liberté de conscience » (Synode des Evêques, Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient, Proposition n°42).
La laïcité positive n’est alors pas vraiment reçue... Néanmoins, dans le Message du à l’occasion de la Journée Mondiale de la Paix du 1er janvier 2011, le Pape Benoît XVI revient sur le sujet et donne des éléments de définition :
« Dans le respect de la laïcité positive des institutions étatiques, la dimension publique de la religion doit toujours être reconnue. Dans ce but, il est fondamental que s’instaure un dialogue sincère entre les institutions civiles et religieuses pour le développement intégral de la personne humaine et l’harmonie de la société »18.
Quelle réception de la doctrine de la laïcité positive ? Il est sans doute trop tôt pour le mesurer. Le Pape François ne s’appuie guère sur cette notion, préférant faire référence à la liberté religieuse , bien qu’il ait l’occasion de déclarer à la presse qu’ « un État doit être laïque. Les États confessionnels finissent mal. Cela va contre l’Histoire. (…) une laïcité accompagnée d’une solide loi garantissant la liberté religieuse offre un cadre pour aller de l’avant. »19
NOTE:
1 Roland Minnerath, Le droit de l’Eglise à la liberté, Beauchesne, Paris, 1982, 207 pages ; Matteo Nacci, Origini, sviluppi e caratteri del Jus publicum ecclesiasticum, Roma, Lateran University Press, 2010, 232 pages ; Emmanuel Tawil, Laïcité de l’Etat et liberté de l’Eglise, Artège, 2013, 160 pages ; Marie Zimmermann, Structure sociale et Eglise, Cerdic publications, Strasbourg, 1981, 181 pages.
2 Denz. n°3167.
3 Léon XIII, Encyclique Immortale Dei, préc.
4 Pie XII, Con sempre nuova freschezza, 24 dicembre 1942, AAS 35(1943), p. 9-24
5 Jean XXIII, Encyclique Pacem in Terris, n°7,
6 GS n°68.
7 GS 76§2; LG 36.
8 Ibid.
9 AdG 12.
10 AA 7 ; GS 36 §2.
11 Jean Paul II, Lettre aux évêques de France à l’occasion du centenaire de la loi de 1905, 11 février 2005, DC 2005, p. 202.
12 Jean Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europa (2003), n°117, DC 2003, p. 706.
13 Nicolas Sarkozy, La République, les Religions, l’Espérance, Cerf, 2004, 173 pages.
14 Nicolas Sarkozy, Discours prononcé au Palais du Latran, 20 décembre 2007, DC 2008, p. 92. Commentaire par Patrick Valdrini, « La Laicità positiva. A proposito del discorso del Presidente Sarkozy al Laterano », in Giuseppe Dalla Torre e Cesare Mirabelli (a cura di), Lo sfide del Diritto, Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini, Soveria Manneli, Rubbettino, 2009, p. 409.
15 Benoît XVI, Voyage Apostolique en France, Cérémonie de Bienvenue au Palais de l’Élysée (Paris, 12 septembre 2008), DC 2008, p. 824-25.
16 Synode des Evêques, Instrumentum Laboris, 6 juin 2010, n°25, DC 2010, p. 609.
17 Isabelle de Gaulmyn, « Laïcité et Primauté en débat », La Croix, 13 octobre 2010
18 Benoît XVI, Message à l’occasion de la Journée Mondiale de la Paix du 1er janvier 2011, 8 décembre 2010, n°9.
19 Entretien avec Guillaume Goubert et Sébastien Maillard, La Croix, 16 mai 2016.
 IT
IT  EN
EN 











