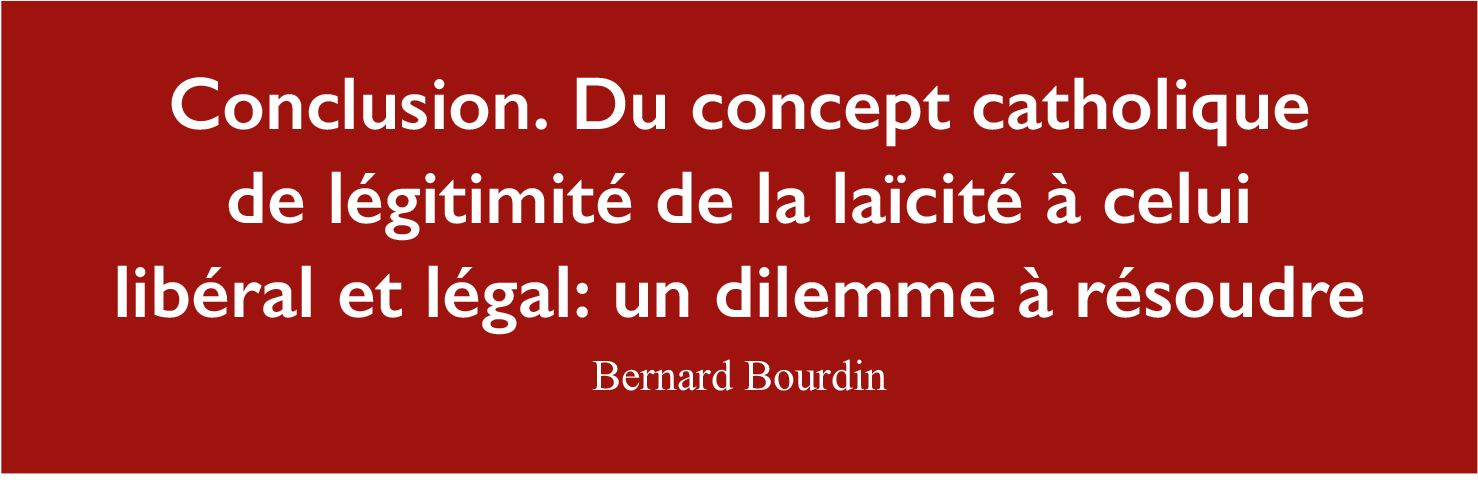
 a défense par Pie XII de « la légitime et saine laïcité » n’est pas le fruit d’un long discours du pape consacré à la relation entre l’Eglise et l’Etat en France. Il est un thème d’une Allocution « à la colonie des Marches à Rome » le 23 mars 1958. C’est pourtant cette brève incise qui a suscité l’organisation d’un séminaire
a défense par Pie XII de « la légitime et saine laïcité » n’est pas le fruit d’un long discours du pape consacré à la relation entre l’Eglise et l’Etat en France. Il est un thème d’une Allocution « à la colonie des Marches à Rome » le 23 mars 1958. C’est pourtant cette brève incise qui a suscité l’organisation d’un séminaire  pluridisciplinaire co-organisé par AIDOP et le Centre d’études du Saulchoir et en partenariat avec la Faculté des sciences sociales de l’Université dominicaine de l’Angelicum. Une conclusion n’étant pas un résumé, je voudrais, à la lumière des différentes communications de nature historique, juridique, canonique et théologique, restituer les réflexions que celles-ci m’ont inspirées. Au centre de celles-ci, la question soulevée par le pape lorsqu’il en appelle à la légitimité de la laïcité comme principe de « la doctrine catholique ». Cette affirmation se situe dans un contexte où il doit apaiser la crainte selon laquelle « le christianisme » chercherait à s’emparer de ce qui revient « à César ». Or, rappelle le pape, « ce qui est à César » est « un commandement de Jésus ». La laïcité a donc un fondement scripturaire que corroborent la doctrine catholique (la légitimité intervient à ce niveau d’autorité) et « la tradition de l’Eglise » qui distingue et unie les deux pouvoirs. Selon Pie XII, ces trois niveaux d’autorité sont les meilleurs armes pour contrer « le mélange du sacré et du profane…quand une partie des fidèles s’est détachée de l’Eglise 1». D’où la conclusion sur la nécessité d’articuler la dualité des pouvoirs à l’unification chrétienne de la cité (« Les cités seront la partie vivante de l’Eglise »). Par cette approche de la laïcité2, Pie XII n’innove pas autant que l’on pourrait le penser, comme en témoigne son ancrage dans une critériologie scripturaire, doctrinale et de la tradition. Le besoin pour les cités d’être unifiées par la doctrine du Christ montre bien que dans son esprit, la « séparation » (terme que le pape n’utilise pas puisqu’il il s’agit de distinguer les deux pouvoirs spirituel et temporel) doit demeurer dans le cadre d’une société de chrétienté. Le concept de légitimité (complété par son caractère « sain ») est donc à comprendre selon la traditionnelle théologie politique catholique des deux pouvoirs3. Dans le cadre de cette brève conclusion, il ne m’est pas possible de situer l’allocution de Pie XII au sein de l’évolution de la pensée magistérielle depuis la loi de 1905 en France.
pluridisciplinaire co-organisé par AIDOP et le Centre d’études du Saulchoir et en partenariat avec la Faculté des sciences sociales de l’Université dominicaine de l’Angelicum. Une conclusion n’étant pas un résumé, je voudrais, à la lumière des différentes communications de nature historique, juridique, canonique et théologique, restituer les réflexions que celles-ci m’ont inspirées. Au centre de celles-ci, la question soulevée par le pape lorsqu’il en appelle à la légitimité de la laïcité comme principe de « la doctrine catholique ». Cette affirmation se situe dans un contexte où il doit apaiser la crainte selon laquelle « le christianisme » chercherait à s’emparer de ce qui revient « à César ». Or, rappelle le pape, « ce qui est à César » est « un commandement de Jésus ». La laïcité a donc un fondement scripturaire que corroborent la doctrine catholique (la légitimité intervient à ce niveau d’autorité) et « la tradition de l’Eglise » qui distingue et unie les deux pouvoirs. Selon Pie XII, ces trois niveaux d’autorité sont les meilleurs armes pour contrer « le mélange du sacré et du profane…quand une partie des fidèles s’est détachée de l’Eglise 1». D’où la conclusion sur la nécessité d’articuler la dualité des pouvoirs à l’unification chrétienne de la cité (« Les cités seront la partie vivante de l’Eglise »). Par cette approche de la laïcité2, Pie XII n’innove pas autant que l’on pourrait le penser, comme en témoigne son ancrage dans une critériologie scripturaire, doctrinale et de la tradition. Le besoin pour les cités d’être unifiées par la doctrine du Christ montre bien que dans son esprit, la « séparation » (terme que le pape n’utilise pas puisqu’il il s’agit de distinguer les deux pouvoirs spirituel et temporel) doit demeurer dans le cadre d’une société de chrétienté. Le concept de légitimité (complété par son caractère « sain ») est donc à comprendre selon la traditionnelle théologie politique catholique des deux pouvoirs3. Dans le cadre de cette brève conclusion, il ne m’est pas possible de situer l’allocution de Pie XII au sein de l’évolution de la pensée magistérielle depuis la loi de 1905 en France.
Mais pour m’en tenir au cadre discursif du dernier paragraphe de cette allocution, il est clair que pour Pie XII, il ne saurait y avoir de « légitime » laïcité en dehors de ce cadre conceptuel catholique. C’est pourtant par cette structure argumentative prémoderne (au sens de la séparation libérale) que Pie XII peut apporter une autre interprétation de la laïcité, dont la notion appartient au lexique libéral. D’où l’ambiguïté inévitable, mais ambiguïté féconde du recours au concept de légitimité qui privilégie l’antériorité historique fondée sur la donation christique de ce qui appartient à César4. Les théoriciens de la laïcité n’ont au fond rien n’inventé. Ils n’ont fait que prendre le relais d’une idée chrétienne et catholique très ancienne sans laquelle la laïcité n’existerait pas5. Pour ce motif de précédence historique, Pie XII ouvre tout un débat sur la filiation/rupture entre la philosophe libérale et la théologie politique chrétienne et catholique. A cet égard, la pensée de John Locke, fondateur du libéralisme philosophique, mériterait un examen. Mais si la séparation libérale n’est que l’héritage dévié de la théologie politique catholique, et que le discours de celle-ci est le seul légitime sur la laïcité, la laïcité libérale (et républicaine s’agissant de la France) est délégitimée (ou même illégitime). Là encore, la raison repose sur son incapacité à conjuguer la distinction des pouvoirs avec l’unification de la société par le catholicisme. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le fait que l’allocution de Pie XII ne constitue qu’une étape dans la pensée magistérielle sur la relation de l’Eglise et e l’Etat. Depuis Vatican II6, la pensée du Saint-Siège a beaucoup évolué. Mais prenons cette étape comme un enjeu de réflexion fondamentale qui est plus large que la seule relation Eglise/Etat. Ce dont il est question est le rapport du magistère catholique avec la sortie de chrétienté : enjeu historique, sociologique, juridico-canonique, théologique, traités par mes collègues au cours de ce séminaire, et que le philosophe politique doit faire sien aussi.
La modernité libérale est loin d’être un paradis terrestre, mais les défis qu’elle soulève ne peuvent avoir de réponses catholiques porteuses d’avenir par le discours de la légitimité pour soi et donc de la dé-légitimation de l’adversaire, ou bien de la simple adaptation aux réalités nouvelles. Je me limiterai, pour achever ma conclusion, à indiquer deux observations. La première est celle du rôle historique du christianisme (et du catholicisme) dans l’avènement de la séparation libérale. La deuxième est celle de la tâche nouvelle qui lui incombe pour surmonter une laïcité en situation de décrochage historique par rapport à sa matrice chrétienne. S’agissant de l’observation historique : Indéniablement, Pie XII a raison de rappeler que la « laïcité » est le fruit de la matrice chrétienne. Contrairement à ce que pensait Aristide Briand (et bien d’autres que lui, y compris dans la sphère catholique), il n’y a jamais eu de confusion entre le spirituel et le temporel, tant ont été nombreux les conflits entre ces deux pouvoirs. Au plan théorique, aussi bien les théologies catholiques que protestantes (Saint Augustin, Saint Thomas d’Aquin, Luther et Calvin) se sont attachées à distinguer les deux sphères. Il n’en demeure pas moins, comme je l’ai déjà fait valoir, que la philosophie libérale de la séparation de l’Eglise et de l’Etat a une toute autre signification. Bénéficiaire d’un héritage chrétien, la séparation libérale a neutralisé tout impact politique de l’Eglise par rapport à l’Etat et jusque dans ses conséquences dans son rapport à la société. D’où une deuxième observation sur le rapport  contemporain de la laïcité avec son histoire chrétienne. Poser la question, comme le fait Pie XII en terme de « légitimité » repose sur une vérité historique, mais à double tranchant. Ce que j’ai souligné pour Aristide Briand vaut pour Pie XII. L’histoire est suffisamment faite de continuités et de ruptures pour ne pouvoir l’invoquer de façon univoque. C’est cette filiation paradoxale qui rend inopérant, pour relever le défi contemporain d’une laïcité qui a décroché de son historique chrétien, le concept de légitimité. La laïcité est en réalité une décision légale. Elle se situe donc du côté de la loi et du droit et non pas de l’invocation d’une filiation historique. Par voie de conséquence, la laïcité pose la question beaucoup plus large de la légitimité des temps modernes7, pour paraphraser le philosophe Hans Blumenberg. C’est pourquoi, à front renversé de Pie XII, Blumenberg se trompe. Les temps modernes ont leur propre légalité, mais n’ont nul besoin de légitimité. Ils existent en connaissance de cause de leur « passé » chrétien tout en lui étant « affranchi ». La question qui se pose est dès lors celle de la solution à ce dilemme entre légitimité et légalité. Vouloir opposer les deux conduit inévitablement à une impasse, ces deux concepts obéissant à deux logiques différentes : d’un côté, le souci de l’appartenance à une histoire politico-religieuse et à une civilisation qui offre un rempart contre « le mélange du sacré et du profane », de l’autre, le souci de mettre en œuvre un principe d’organisation de la société sur le fondement d’un agnosticisme constitutionnel (la neutralité juridique de l’Etat laïc) et qui offre un rempart contre les ingérences religieuses dans le sanctuaire de la conscience. Autrement dit, la légitimité justifie l’hétéronomie du fondement de la société, corollaire d’une transcendance protectrice. La légalité justifie l’autonomie du fondement démocratique-libérale, corollaire de la protection de la conscience. Légitimité et légalité ont chacune leur part de vérité. Pourtant, l’une et l’autre peinent à s’entendre alors qu’elles se trouvent dans la même situation critique. Pour réactiver un discours opératoire sur la légitimité, l’arrimer à un principe d’organisation légale de la société, ne devrait-il pas en passer par une nouvelle économie de la transcendance ? Concrètement, congédier tout fondement hétéronome à l’ancienne, et par là-même revitaliser un discours sur l’autonomie qui se confond trop depuis ces dernières décennies avec une auto-fondation dont on peut mesurer les périls pour la légalité démocratique et laïque8. Redécouvrir la pertinence de ce qui est légitime et de ce qui n’est l’est pas reviendrait à redonner de l’épaisseur à la légalité d’un principe d’organisation laïque, en redonnant une orientation au libéralisme démocratique sur le fondement de sa matrice historique. A sa façon, Vatican II a ouvert une voie. Il convient de l’approfondir : Une société politique peut-elle avoir un avenir sans se reconnaître dans un héritage commun ?
contemporain de la laïcité avec son histoire chrétienne. Poser la question, comme le fait Pie XII en terme de « légitimité » repose sur une vérité historique, mais à double tranchant. Ce que j’ai souligné pour Aristide Briand vaut pour Pie XII. L’histoire est suffisamment faite de continuités et de ruptures pour ne pouvoir l’invoquer de façon univoque. C’est cette filiation paradoxale qui rend inopérant, pour relever le défi contemporain d’une laïcité qui a décroché de son historique chrétien, le concept de légitimité. La laïcité est en réalité une décision légale. Elle se situe donc du côté de la loi et du droit et non pas de l’invocation d’une filiation historique. Par voie de conséquence, la laïcité pose la question beaucoup plus large de la légitimité des temps modernes7, pour paraphraser le philosophe Hans Blumenberg. C’est pourquoi, à front renversé de Pie XII, Blumenberg se trompe. Les temps modernes ont leur propre légalité, mais n’ont nul besoin de légitimité. Ils existent en connaissance de cause de leur « passé » chrétien tout en lui étant « affranchi ». La question qui se pose est dès lors celle de la solution à ce dilemme entre légitimité et légalité. Vouloir opposer les deux conduit inévitablement à une impasse, ces deux concepts obéissant à deux logiques différentes : d’un côté, le souci de l’appartenance à une histoire politico-religieuse et à une civilisation qui offre un rempart contre « le mélange du sacré et du profane », de l’autre, le souci de mettre en œuvre un principe d’organisation de la société sur le fondement d’un agnosticisme constitutionnel (la neutralité juridique de l’Etat laïc) et qui offre un rempart contre les ingérences religieuses dans le sanctuaire de la conscience. Autrement dit, la légitimité justifie l’hétéronomie du fondement de la société, corollaire d’une transcendance protectrice. La légalité justifie l’autonomie du fondement démocratique-libérale, corollaire de la protection de la conscience. Légitimité et légalité ont chacune leur part de vérité. Pourtant, l’une et l’autre peinent à s’entendre alors qu’elles se trouvent dans la même situation critique. Pour réactiver un discours opératoire sur la légitimité, l’arrimer à un principe d’organisation légale de la société, ne devrait-il pas en passer par une nouvelle économie de la transcendance ? Concrètement, congédier tout fondement hétéronome à l’ancienne, et par là-même revitaliser un discours sur l’autonomie qui se confond trop depuis ces dernières décennies avec une auto-fondation dont on peut mesurer les périls pour la légalité démocratique et laïque8. Redécouvrir la pertinence de ce qui est légitime et de ce qui n’est l’est pas reviendrait à redonner de l’épaisseur à la légalité d’un principe d’organisation laïque, en redonnant une orientation au libéralisme démocratique sur le fondement de sa matrice historique. A sa façon, Vatican II a ouvert une voie. Il convient de l’approfondir : Une société politique peut-elle avoir un avenir sans se reconnaître dans un héritage commun ?
NOTES
1 Nous pouvons conjecturer, plusieurs années après la Deuxième Guerre mondiale, une critique implicite du fascisme et du nazisme.
2 Il semble que la langue italienne utilise les deux notions de Laïcità et secolarismo. Il faudrait connaître la version italienne de l’allocution de Pie XII pour s’assurer du terme exact utilisé par le pape.
3 Documentation catholique, Amour de sa province, de sa patrie et de l’Eglise, Allocution de S.S. Pie XII à la colonie des Marches à Rome (23 mars 1958), 1275, 13 avril 1958, col. 454-458 (456-457).
4 Il faudrait sur cette donation consacrer toute une réflexion sur la base d’une exégèse néotestamentaire.
5 Voir le préambule du rapport d’Aristide Briand qui fait remonter la séparation de l’Eglise et de l’Etat au Nouveau Testament : Matthieu, 22, 15-21. Mais ce fondement scripturaire permet au Ministre de déplorer la confusion qui s’est installée entre les pouvoirs spirituel et temporel depuis Constantin et la Réforme grégorienne. Comme dans toute apologétique, le rapport à l’histoire peut justifier des positions antinomiques !
6 Gaudium et Spes, chap. IV, 76 : La communauté politique et l’Eglise. Voir également Dignatatis humanae.
7 Hans Blumenberg, La légitimité des temps modernes, Paris, Nrf Editions Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 1999.
8 Je pense au morcellement culturel des sociétés démocratiques contemporaines, très bien analysé récemment pour la France par le politiste Jérôme Fourquet.
 IT
IT  EN
EN 











