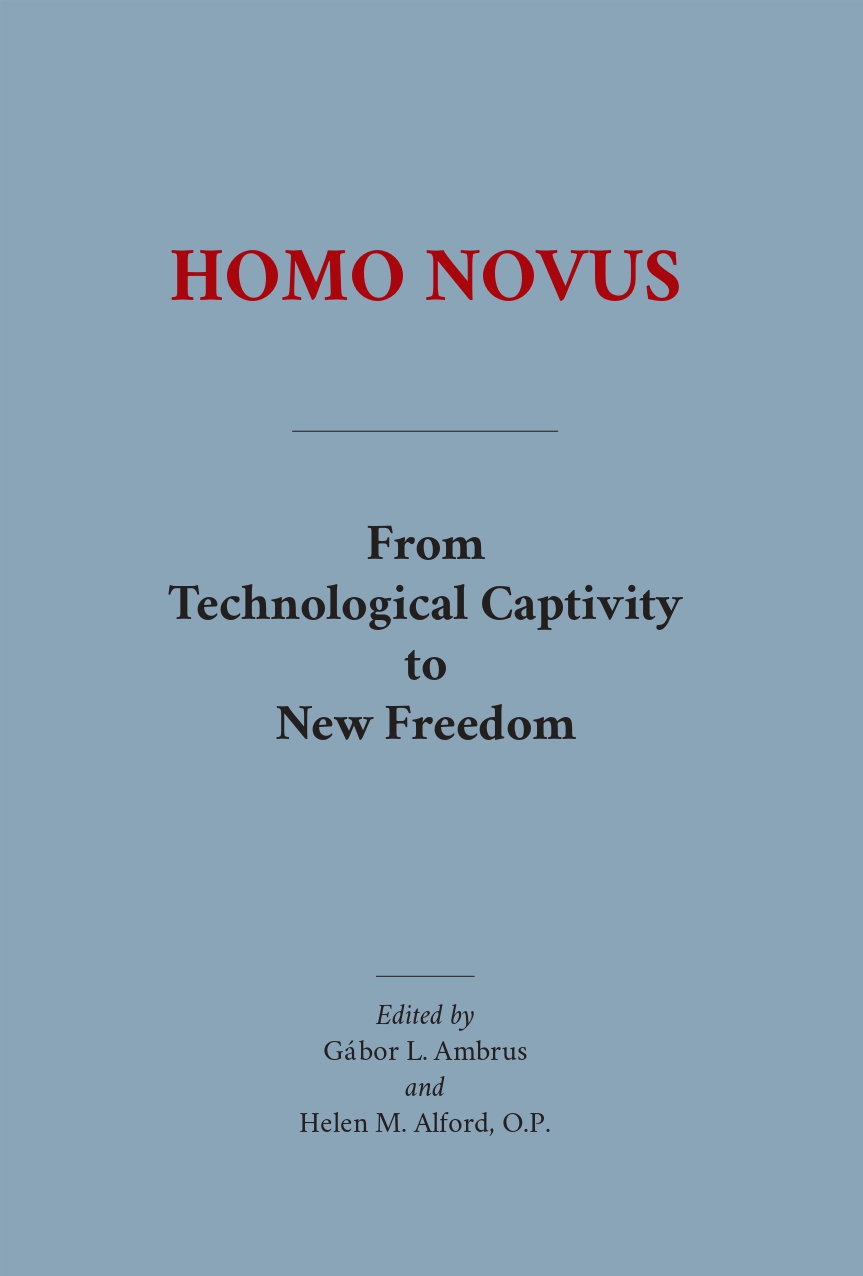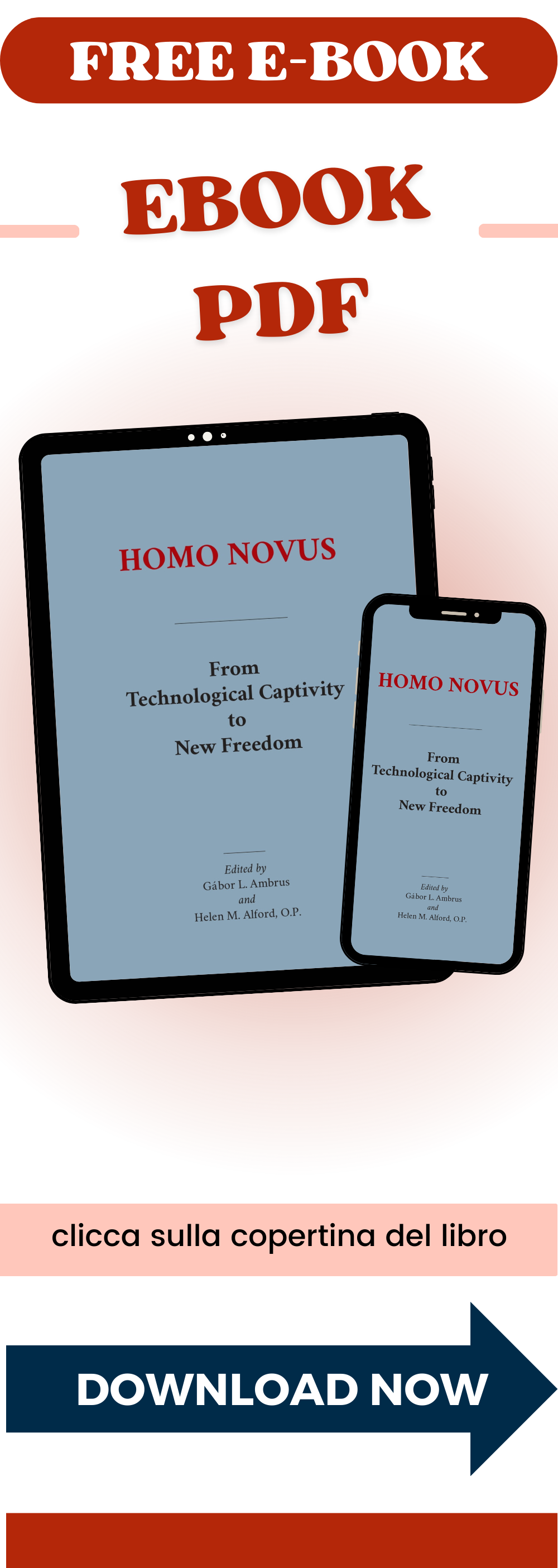![]()
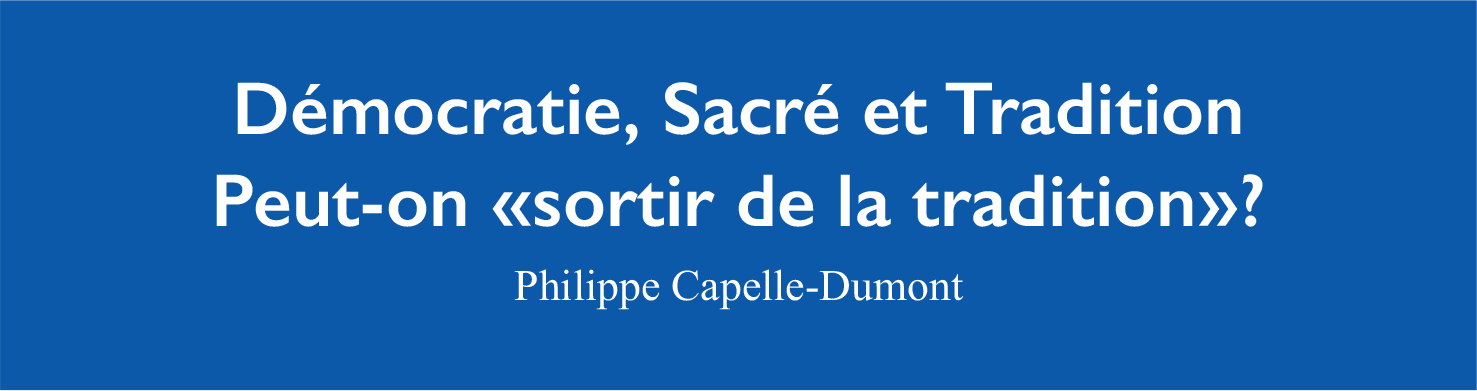

 e Service Communication d’AIDOP a l’honneur de préciser que cet article est tiré de la conférence, encore enrichie en 2017, qu’avait donnée l’auteur le 31 mai 2016 à l’École Normale Supérieure (ENS) dans le cadre des séances académiques centrées sur le thème “Démocratie et sacré” qui ont précédé en 2016 – ou suivi en juin 2019 – la tenue à l’Université pontificale de l’Angelicum le 6 décembre 2018, de la séance académique commémorant le 60e anniversaire du discours en 1958 du Pape Pie XII sur “la légitime et saine laïcité de l’État” (Cf. Numéro de juin 2019 in OIKONOMIA). Avec le concours du Séminaire de Madame le Professeur Dominique de Courcelles (“Transferts culturels”. CNRS-ENS), les séances “Démocratie et sacré” de 2016, 2019 et 2020, ont pour objet d’apporter des éclairages issus des recherches théologico-politiques dans le cadre du Séminaire pluriannuel – crée en 2015 à Paris – “Devenir de l’État laïc” (AIDOP & CES: ce sont les partenaires de la Faculté de Sciences Sociales de l’Angelicum, qui ont pris l’initiative de la séance commémorative romaine du 6 décembre 2018, co-dirigée par le Recteur émérite Francesco Compagnoni op de l’Angelicum, et par le Doyen honoraire Jean-Paul Durand op, Institut catholique de Paris, Fondateur en 2003 de AIDOP).
e Service Communication d’AIDOP a l’honneur de préciser que cet article est tiré de la conférence, encore enrichie en 2017, qu’avait donnée l’auteur le 31 mai 2016 à l’École Normale Supérieure (ENS) dans le cadre des séances académiques centrées sur le thème “Démocratie et sacré” qui ont précédé en 2016 – ou suivi en juin 2019 – la tenue à l’Université pontificale de l’Angelicum le 6 décembre 2018, de la séance académique commémorant le 60e anniversaire du discours en 1958 du Pape Pie XII sur “la légitime et saine laïcité de l’État” (Cf. Numéro de juin 2019 in OIKONOMIA). Avec le concours du Séminaire de Madame le Professeur Dominique de Courcelles (“Transferts culturels”. CNRS-ENS), les séances “Démocratie et sacré” de 2016, 2019 et 2020, ont pour objet d’apporter des éclairages issus des recherches théologico-politiques dans le cadre du Séminaire pluriannuel – crée en 2015 à Paris – “Devenir de l’État laïc” (AIDOP & CES: ce sont les partenaires de la Faculté de Sciences Sociales de l’Angelicum, qui ont pris l’initiative de la séance commémorative romaine du 6 décembre 2018, co-dirigée par le Recteur émérite Francesco Compagnoni op de l’Angelicum, et par le Doyen honoraire Jean-Paul Durand op, Institut catholique de Paris, Fondateur en 2003 de AIDOP).
Au mois de février 2017, la mairie de Paris - ayant préalablement mis en place une “boîte à idée numérique” au nom de la “démocratie participative”, a recueilli sur son site internet cette proposition qui a reçu le plus grand nombre d’approbations parmi les 2448 formulées : que soit démolie la Basilique du sacré-cœur à Montmartre lors d’une grande fête populaire, parce que, lisait-on, sa construction, fut et reste une “insulte à la mémoire de la Commune de Paris”. Qu’un adjoint à la Mairie de Paris ait rappelé que cet édifice n’appartient pas à celle-ci et qu’il est classé “monument historique”, que donc pour des raisons juridiques la demande ne peut aboutir, cela n’est pas la question centrale; non plus que cette parole citoyenne ignore le fait que le vœu de construction de cette basilique, formé en novembre 1870 n’a aucun rapport de dépendance historique avec la Commune, déclenchée en mars 1871.
La question principale est ailleurs, elle réside dans le rapport entretenu entre la démocratie participative et le sacré les traditions religieuses. On le comprend bien qu’il ne s’agissait point en l’espèce de biffer le sacré, mais d’opposer un sacré contre un autre : le sacré de la “Commune” contre le “Sacré-cœur” et ainsi de placer en rivalité totale un sacré respectable contre un sacré illégitime voire délictueux. On pourra toujours appeler, là-contre, que cette proposition de démolition n’est pas nouvelle, que donc elle ne constitue pas une simple “potacherie” accidentelle; mais il y a ici, d’abord et de façon inédite, un fait sensible: cette proposition prenait place dans un cadre participatif institué par une démocratie participative; ce fait pose certes à lui seul la question de la place que reçoit l’expression du sacré dans nos démocraties. Elle pose surtout la question du pouvoir inhérent à la démocratie et de son appropriation du critère qui juge de ce qui est sacré et de ce qui ne l’est pas.
Je ne m’attarde pas ici sur les étymologies, allant du sanscrit au latin, accordées au mot “sacré” et qui renvoient aux notions d’interdiction, d’inviolabilité et de séparation, voire, en droit romain, à l’exclusion. Je ne puis également d’évoquer les différentes théorisations dont il a été l’objet depuis plus d’un siècle notamment dans son opposition au pro-fanum, qui faisait les délices de Benveniste ou de Mircea Eliade, mais que pratiquait déjà, on peut le rappeler, Spinoza dans le cadre de sa philosophie politique, — cf. son Traité théologique-politique (chap.12); ou encore, l’opposition sacré/saint célébrée par Emmanuel Levinas et qui avait, aussi chez lui , des incidences de premier ordre dans le domaine politique.
*
Nous partirons des thèses de Marcel Gauchet, consignées dans le quatrième tome de son ouvrage : “L’avènement de la démocratie: Le nouveau monde” (Gallimard 2017) et tenterons d’ouvrir dans son prolongement quelques pistes de réflexions que leurs contenus inspirent. Nous procéderons ensuite et en contraste à la lecture des thèses de Pierre Gisel soutenues dans son ouvrage publié la même année: Qu’est-ce qu’une tradition? (Hermann.).
M. Gauchet est resté fidèle à son projet déclaré depuis Le désenchantement du monde (1985), de lire le processus fondamental de nos sociétés occidentales comme une “sortie de la religion”, entendons: comme un affranchissement progressif des démocraties vis-à-vis de toute puissance de structuration religieuse des sociétés. Pou Gauchet, nous y sommes enfin. Il y passe donc en revue toutes les étapes, avec leurs ralentissements et leurs accélérations, depuis la Révolution française jusqu’à la présente époque qui à ses yeux réalise aujourd’hui le parachèvement de cette sortie. Celui-ci est décliné en quatre moments : 1. parachèvement de la monopolisation du lien politique; 2. parachèvement corrélatif de l’individualisation de ce même lien; 3. parachèvement du devenir abstrait de l’Etat; 4. parachèvement du renvoi de la dimension symbolique dans l’implicite.
La thèse ancienne de l’auteur, de la “sortie de la religion”, est ici relancée et étayée : depuis deux siècles, se sont succédées différentes figures de “compromis” — ce vocable revenant constamment sous sa plume — entre la demande d’autonomie politique et l’hétéronomie religieuse, compromis manifesté ici par le retour provisoire de la monarchie napoléonienne et le maintien de procédures démocratiques, manifesté là par l’installation du paradigme “socialiste” et ses références auto-sacralisées, ou encore par l’adaptation laïque à la marginalisation de la religion alors que son camp progressiste envisageait son élimination. Ce que veut d’abord retenir Gauchet dans une thèse qui au fond rejoint les thèses anciennes de Karl Löwith sur la sécularisation, c’est que les sociétés n’ont pas su identifier le piège dans lequel elles sont longtemps tombées et qui consiste à concevoir l’autonomie politique sur “le patron inconscient de l’hétéronomie”. Cette ombre de l’“Un “hétéronome leur était en effet nécessaire pour nourrir “l’imaginaire de l’émancipation”. Mais dans son ultime version, l’autonomie démocratique qui avait joué de l’alternative entre répression (religieuse) et libération (de l’individu), a fini par dissoudre, dans un processus inéluctable, l’hétéronomie du projet émancipatoire lui-même. Où réside alors l’implicite symbolique de nos sociétés démocratiques? Renonçant à l’ostentatoire, la symbolique se loge, affirme Gauchet, dans l’extraordinaire efficacité de nos sociétés à assumer la différence culturelle, voire les contradictions idéologiques; le symbolique qui a déserté les institutions (transformées en “services”) mais il reste l’obsession de nos sociétés: «Nos société sont hantées par cette dimension symbolique qui a perdu son langage et dont elles devinent la présence sans parvenir à l’appréhender. C’est le fond du sentiment d’insécurité qui les habite» (p.313).
Sur le versant chrétien, la pratique de compromis, dit notre auteur, n’a pas été moins vive, notamment par l’adaptation chrétienne à la République laquelle, en dépit de son refus de l’autorité théologique restait en effet un espace potentiel de conquête spirituelle, ce jusqu’à l’idée de “démocratie chrétienne” qui exprimait, cette fois non plus par le “haut” mais par “en bas”, la possibilité d’établir un ordre social inspiré par les principes évangéliques. On pourrait s’interroger sur la confusion théorique que commet M. Gauchet entre “démocratie chrétienne” et “théologie de la libération” lorsqu’il prétend voir chez l’une et chez l’autre une ultime tentative de sauver le la théologie politique. Mais ce qu’il veut retenir, c’est la perte de l’idée même d’organisation chrétienne de la société y compris en religion, sans spécifier suffisamment toutefois qu’il s’agit pour lui de la “religion chrétienne” tout en laissant délibérément “de côté les problèmes d’acculturation posés par un islam d’importation” (p.192). La perte en question n’est certes pas celle de la conscience religieuse qui s’investit aujourd’hui dans l’autonomie démocratique sans revendication d’aplomb, et qui place le divin “par essence en altérité en vis-à-vis de cette sphère d’autonomie” (p.191).
En tout cela, Gauchet relève non sans force une crise qui laisse intacte l’obligation, pour les sociétés humaines autonomisées, de se confronter au “mystère qu’elle (l’humanité) est pour elle-même” (p.193); plus encore et courageusement il incite à ne pas mésestimer le potentiel de réinvention théologique que recèle le repli politique “du religieux, “avec ses suites imprévisibles” (p.192).
En toute hypothèse, tel est au yeux de Gauchet le secret d’un statu quo qui a prévalu jusqu’à maintenant et dont les décennies qui ont suivi la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 et qui n’ont cessé d’honorer ce compromis, cet équilibre entre volonté d’autonomie et ce résiduel d’hétéronomie avec d’un côté de qui était écrit “sur le papier” et qui bannissait le partage du pouvoir avec toute incarnation monarchique, et de l’autre “les faits” où l’Etat lui-même se pare d’une transcendance jusqu’à laisser l’irrésolue la tension entre la liberté théorique des individus et ses appartenances communautaires. On connaît le beau discours de Clermont-Tonnerre, prononcé devant l’Assemblée Constituante le 23 décembre 1789, dont on a retenu, et pour de bonne raisons, ce qui concerne spécialement les Juifs: «Il faut refuser tout aux juifs comme nation, et accorder tout aux juifs comme individus; il faut méconnaître leurs juges; ils ne doivent avoir que les nôtres; il faut refuser la protection légale au maintien des prétendues lois de leur corporation judaïque; il faut qu’ils ne fassent dans l’Etat ni un corps politique, ni un ordre; il faut qu’ils soient individuellement citoyens». Avec du recul, on voit que cette demande n’a pu qu’échouer dans ses effets. Ce qui rend compte de ce que M. Gauchet appelle le statut ambigu des Eglises mais aussi des religions instituées qui, d’un côté, ne devraient plus jouir d’une position officielle mais en en pratique la conservent. Telle est aussi la sourde inquiétude qui traverse nos sociétés en demande d’un dépassement d’elle-même au titre du mystère “métaphysique” qui persiste en elles et qu’elles ne sauraient reléguer.

Reste que pour nos contemporains, et Gauchet ne saurait en faire fi, le projet laïque aujourd’hui n’est certes plus de séparer l’État de la religion dominante dans la société, il est de séparer la société elle-même de la religion, en l’occurrence des religions. La première laïcité, la laïcité de la République, en enlevant à l’Église la part qu’elle avait encore au gouvernement de la société, ne lui ôtait pas sa liberté d’expression culturelle. La seconde laïcité, la nôtre, celle des “valeurs de la République”, entend obtenir et maintenir qu’aucune religion ne puisse faire porter sa marque sur la vie sociale, d’abord parce que cela impliquerait l’oppression ou du moins la subalternation des autres religions, et donc l’inégalité entre les citoyens. Elle entend obtenir et maintenir que la société soit religieusement inexpressive, intouchable par la religion, hors d’atteinte de toute proposition religieuse. Ces demandes, voire ces exigences révèlent en réalité une situation contradictoire, théoriquement et pratiquement, puisque ce sont les mêmes droits humains qui garantissent la liberté religieuse et qui tendent à en prévenir le déploiement effectif.
Relevant la dramatique de la situation ainsi évoquée et analysée, je proposerai d’une part que le vocabulaire et le lexique utilisé, i.e. : “symbolique”, “sacré”, “transcendance”, soit affranchi du faux universalisme dans lequel une certaine sociologie de la religion tend à l’enfermer, présupposant pour chacun d’eux un sens commun, un fond de significations trans-culturelles et trans-religieuses. Parlant de ce qui ne cesse constitue la référence objective des considérations dominantes de Gauchet et pas seulement lui, à savoir le christianisme, j’inviterai d’autre part à convenir d’une reprise catégoriale fondamentale; elle qui supposerait à tout le moins, quatre types de dissociations sémantiques; entre l’hétéronomie et l’Un, entre le symbolique et l’extériorité, entre le sacré et le pur, et entre la transcendance et le surplomb. Ces quatre dissociations étant faites au titre des trois schèmes théoriques centraux du christianisme, que sont l’incarnation, la création et la rédemption, le mystère des sociétés humaines sur lequel finit par buter ladite “sortie démocratique de la religion”, ouvrirait la porte non pas à un compromis pragmatique, mais à une nouvelle “alliance”, une alliance critique, dans la distinction, non la séparation, de leurs polarités, entre le sacré du théologique et le sacré du politique.
**
Pour avancer dans cette nous nous focaliserons sur la question du statut des traditions dans la cité, non pas par une reprise du désormais vieux débat entre “communautariens” et “libéraux” mais par une confrontation aux thèses dans l’ouvrage de Pierre Gisel: “Qu’est-ce qu’une tradition?” et qui pose la question décisive de l’articulation entre les concepts de tradition et de raison.
Raison et tradition forment un couple mouvementé dont le divorce, au cours des deux derniers siècles, fut maintes fois annoncé, voire hardiment déclaré. Si la première, depuis les Lumières, a fait principalement de la seconde un objet antinomique de sa revendication d’universalité, la plupart des religions, de leur côté, ne se sont jamais interprétées sans, à quelque degré, en convoquer l’un et l’autre concepts. Le débat “moderne” entre ces deux polarités s’est donc noué autour de binômes à l’autorité auto-célébrée: universalité/particularité, spéculation/narration, entendement/foi, logique/mémoire, ce dont s’accommode encore aujourd’hui une certaine forme de sécularité, qu’elle soit éthique, culturelle ou politique. Certes, tout un pan de la philosophie contemporaine, avec Hans Georg Gadamer puis Paul Ricoeur, a permis de redonner à la “tradition” une dignité conceptuelle notamment par la réhabilitation philosophique de la notion de “préjugé” et par la radicalisation ontologique, avec Heidegger, de la disposition herméneutique. Reste qu’entre la complaisance communautariste d’un côté et le jeu éthique néo-libéral de l’autre, la tradition doit encore frayer son propre chemin qui puisse justifier son mode de rationalité et récuser toute assignation de son office au monde sauvage.
Pierre Gisel réussit ici un tour de force où se conjuguent sans cesse la fermeté de l’examen et la charge de l’érudition. Le lecteur relève ainsi le soin tout “scolastique” apporté à l’exercice de la distinction. Loin des généralités et des slogans courus, l’auteur y entreprend un travail de clarification dont intitulé modestement interrogatif ne peut dissimuler longtemps le caractère systématique et fondamental.
La manière de la question : “Qu’est-ce qu’une tradition?” est une prise de parti méthodologique contre cette autre posée ailleurs et souvent : “Qu’est-ce que la tradition?” — indiquant en cela que pour un tel objet, toute essentialisation est exclue. Elle n’est certes pas sans analogie avec l’assertion de Paul Ricoeur dans ses Gifford lectures: “Il n’y a de religion que là où il y a des religions”, à ceci près que si toute tradition est une singularisation vis à vis d’une autre, elle intègre plus souvent en son sein diverses traditions. La question élevée est alors de savoir comment une tradition se fait, alors qu’elle s’écarte toujours d’une pluralité (externe) et qu’elle en assume une autre (interne). Si elle est de la sorte une “construction” (p.10. 24), elle appelle une “déconstruction” ou plus précisément une “perlaboration” — l’auteur reprenant ici un néologisme d’origine psychanalytique — qui la restitue soigneusement à l’histoire et à son champ de réalité. La réponse passera par l’“illustration” (mais ce vocable n’est sans doute pas, philosophiquement, le plus adéquat) des deux traditions du judaïsme et du christianisme. Trois caractères sont retenus de la première : 1/ elle est “texto-centrée”; (soit, mais ne faudrait-il pas aussitôt préciser que son “texte” est toujours déjà lui-même décentré par la tradition qui l’a produit? N’est-ce pas d’ailleurs le sens de la remarque en fin d’ouvrage : “On pourrait y ajouter un fond fait de séquences prélevées d’une histoire”, p. 150)?); 2/ elle “donne forme à la lignée d’un agencement sur un autre”; enfin, 3/ elle est traversée de “discontinuités” et de “pluralité” (p. 12–17). Quant à la tradition du christianisme, si elle est, dit l’auteur, la reprise instauratrice d’une lignée antérieure, mais également une traversée de discontinuités qui, de “réformes” en “réformes” (p. 21) la constitue en un geste unitaire. PG ne ménage pas ici la difficulté : «Les historiens hors confessionnalité ont beau jeu de souligner les discontinuités […] et de montrer que chacun (des) moments historiques présente une cristallisation d’éléments du temps, donnant chaque fois lieu à du “syncrétisme culturel”», venant ainsi à parler “des” christianismes, “des” islams, “des” bouddhismes et “des judaïsmes” (p. 24). C’est qu’y est négligé le champ d’interrogation pourtant tenu, en ces lieux, de rendre compte du principe unitaire (ou unifiant) qui donne comme tel “une” tradition juive, “une” tradition chrétienne etc. La tache aveugle est donc celle de l’identité qui s’affirme dans l’articulation des discontinuités et que l’auteur appelle ici la “construction d’une continuité” (p. 25) qui n’a rien à voir avec quelque “continuum de l’histoire” (p. 152). Une construction en réalité mystérieuse qui échappe à toute opération subjective. N’est-ce pas ce qu’indique l’étymologie (transmettre), renvoyant à l’impossibilité d’en cerner quelque “origine”? L’auteur le conçoit : «Au reste, une tradition est de fait ce qui nous est donné et nous donne le monde» (p. 27); cf. également p.146–149) L’essentiel est dit qui maintient la tradition dans l’historialité, toujours coextensive au présent qu’elle garantit, au passé qu’elle en ne cesse de renégocier, et au futur qu’elle ouvre.
Mais l’analyse de P. Gisel n’est pas orientée vers les seules traditions “religieuses”, elle recouvre un champ de traditions sociales dont les réalités complexes et multiformes (culinaires, artisanales esthétiques …) doivent être prises en charge dans un discours qui sache honorer, là aussi, leur irréductibilité. Ainsi se pose la question du régime de rationalité propre à telle tradition – question comme telle trop oubliée, voire reléguée non seulement par “les Lumières européennes” mais aussi par les ratiocinations des “théologies philosophiques” (p.38-39). Sans doute conviendrait-il à ce dernier égard d’éviter les généralisations hâtives; mais la réponse passe aussi selon l’auteur par une lecture critique de la raison en exercice dans la philosophie analytique. S’y trouvent alors longuement relevés les présupposés à l’avantage de l’ “épistémique”, du “concept “et du “théisme”, présupposés qui tiennent au privilège accordé, pour de louables motifs anti-cognitivistes, au tout “propositionnel”, révélation religieuse incluse. Mais à redonner ainsi “raison” aux croyances, la philosophie analytique attesterait d’un autre oubli qui concerne le rapport au monde, au temps, à soi et “aux autres” (p. 51), oubli, autrement dit, de la tradition en laquelle ces croyances, leur émergence, leurs déplacements se nouent : «En dernière instance […], elle répond à une inscription à même le monde, et son donné propre à chaque fois est transversal et en participe ou en est fait, un geste qui en appelle en même temps à un hétérogène et vise au-delà du simple donné» (p. 53). P. Gisel sera peut-être étonné de ce que cette observation ne se soit pas sans analogie avec celle, formée autrefois par M. Blondel qui récusait le “repos de la vue” au profit du “chemin de la vie”, et qui, en précurseur, habilitait philosophiquement le concept de tradition comme “mémoire en travail” 1. C’est en effet, au plus profond, la rationalité de la tradition qui est en jeu et du même effet son articulation avec l’humanité commune.
***
Ici s’indique, aux yeux de PG, une double tâche. Partant d’un travail sur les traditions particulières, on sera renvoyé aux schèmes du “monde de tous “tout en en maintenant l’écart; et, partant d’un travail sur le donné social, on sera renvoyé aux traditions comme à des vecteurs de décentrement. Dit autrement, s’il y a le monde commun à même la ou les tradition(s), il y a non moins de la tradition à même le monde. Aux catégories du possible/nécessaire, du non-contradictoire et du logique/plausible, centrales en perspective “analytique”, doit être en quelque sorte substitué — bien qu’il ne soit pas formulé comme tel — le binôme Immanence/transcendance, les deux termes indiquant, à l’encontre une raison en surplomb, la tension qui interdit tant la confusion que la séparation.
Dans ces conditions, penser la religion et les traditions religieuses philosophiquement — c’est-à-dire en-deçà des procédures d’idéologisation déjà identifiées par Alasdair McIntyre (After Virtue. A study in Moral Theory, 1981) — cela est devenu une entreprise aussi indépassable qu’urgente. On rappellera toutefois que cette trajectoire philosophique exigeante, à double distance des sciences objectivantes et de la classique philosophie de la religion, fut initiée voici bien longtemps par tout un pan phénoménologique (distinct de la phénoménologie husserlienne) avec Scheler et le jeune Heidegger des années 1918–1922: soucieux de faire des objets de la religion des phénomènes de plein droit, ils leur avaient conféré les titres de l’irréductibilité et de l’originaire. Mais l’insistance, originale, de P. Gisel vise 1/ à porter la logique propre de la “tradition” devant la raison dite “publique”, ce qui “exige une “transposition” (ne vaudrait-il pas mieux parler ici de “traduction?”) de la réflexivité théologique dans le champ séculier; 2/ en retour : à porter le corps social à la reconnaissance de ce que la tradition veut dire. La perspective ainsi ouverte par l’auteur est d’un double intérêt: d’une part, demander au religieux, partant au théologique, d’attester que ses contenus et son discours répondent de ce qu’est l’habitation du monde; d’autre part, requérir de toute lecture du donné social qu’elle sache relever la dimension d’excès qui déjà le fonde comme tel.
Ce jeu noble d’interlocution concerne deux ordres de réalités qui connaissent l’un et l’autre leurs réalités institutionnelles. Celles-ci s’invitent donc au débat; sur le “bien commun” qui commande (ou devrait présider à) l’organisation sociale, et au titre duquel “une communauté morale peut apporter sa contribution”. Soit, mais pourquoi ajouter aussitôt: «… mais elle [la communauté morale] ne le fera pas en répondant de ce qui l’institue comme communauté propre (Eglise par exemple, ou analogue)» (p. 64)? On est étonné. Ne retombe pas ici dans ce que la thèse principale de l‘ouvrage semble avoir voulu éviter à savoir la dilution de l’irréductibilité historiale des traditions et de leurs supports institutionnels dans une vague contribution socio-éthique? D’autres affirmations de l’auteur montre qu’il n’en est rien (voir par exemple p. 141). Le lecteur comprend bien que l’institutionnalité religieuse ne saurait exhiber toutes ses pratiques rituelles ou catéchétiques au titre d’un immédiat service sociétal; la question est cependant de savoir comment elle articule médiatement cette exigence à la nécessité impérieuse de renvoyer à ce qui fait aussi pour elle “bien commun”, à savoir le rapport au Dieu et/ou au divin? On se rappellera en effet que le “bonum commune” dont la notion dut reprise par Thomas d’Aquin au 13è siècle après sa lecture d’Isidore de Séville et de saint Augustin, était alors de facture à la fois philosophique2 et théologique3. Entendons : si le “bien commun” est d’abord Dieu lui-même, alors la raison politique, qui fonde elle aussi dans son ordre propre le bien commun, ne saurait - le respect des médiations étant garanti — manquer de s’y exposer, voire de s’en inspirer. N’est-ce pas d’ailleurs sous cet aspect que peut être relu, dans sa complexité, le mode contributif de c certaines traditions religieuses — en premier lieu du christianisme, même trahi – dans l’avènement de la démocratie moderne, des droits de l’homme et de la laïcité?
Si, comme le dit justement P. Gisel, la “tradition” est appelée à faire passer ses données particulières sur l’axe social à la manière d’un intérêt spécifique (p. 67), on ne saurait pour autant rallier le jeu métaphorique très problématique de la démythologisation bultmannienne, celui de l’“écorce” faisant place au “noyau”, et que l’auteur connait supérieurement bien. Ce sont alors des procédures herméneutiques rigoureuses qui doivent être mises en œuvre afin que soit écarté le risque d’une nouvelle instrumentalisation (éthique ou esthétique) de la tradition religieuse. Il le sera cependant plus encore si les concepts de “tradition” et de “communauté” sont résolument distingués; il n’est pas sûr, en effet que l’Eglise catholique, pour ce qui la concerne, se conçoive comme “communauté” si tant est qu’elle est d’abord un “rassemblement” (ecclesia) de complexités dont seul l’horizon christo-eschatologique assure, dans l’espérance vécue, une communion déjà visible. Ainsi pourrait être satisfait le premier réquisit légitimement introduit par PG, de rouvrir la réflexion sur la pertinence, les limites et la force possible de la tradition. Le second réquisit n’est pas moins essentiel qui porte sur la conscience des divers visages de la tradition et de ses articulations effectives aux sociétés. Le troisième réquisit visant à mettre en correspondance les données (symboliques, doctrinales, rituelles) en tradition et les “questions humaines générales” (p. 77) n’est certes pas sans ressemblance, mutatis mutandis, avec l’ancien et prestigieux projet rahnerien d’une “anthropologie transcendantale”. En toute hypothèse, l’auteur voit tout le bénéfice — et comment ne pas y souscrire — que les sociétés peuvent retirer de la mise en œuvre de tels réquisits : à la fois dans la confrontation rigoureuse des différences interculturelles mais aussi quant à l’apport des spécificités des traditions particulières aux sociétés séculières.
Ces propositions sont élaborées sur fond de crise du politique que l’auteur analyse sans concession comme perte du lien social, situation mettant en cause la pertinence des instances pourtant chargées d’organiser celui-ci. Se trouvent alors réinterrogés les concepts qui les accompagnent, telle la “souveraineté” politique qui a pu, en l’espèce, nourrir les totalitarismes historiques. Mais alors, le religieux et le théologique sont concernés, “touchés” directement par la demande de “fondement” et de vérification des fondements que cette crise fait surgir; non pas, certes, qu’il faille retourner à la soumission pure et simple du politique au théologique, mais, dans un mouvement inverse, interroger les limites et les ambivalences des thèmes sociaux parfois hypostasiés mais fragiles, telle l’auto-affirmation de la Modernité, l’autonomie du Sujet, l’accession à soi etc (p.93); retrouver en cela des convergences possibles avec les analyses de l’Ecole de francfort (Adorno, Horkheimer) et ses héritiers (Zizek, Sloterdijk, Agamben) sensibles à la nécessité de penser un “dehors”, en le protégeant de tout envahissement irrationnel.
****
«Dans cette conjoncture — la nôtre —, il est urgent de s’atteler à un autre penser du social. Donc à un autre penser du “politique” et à un autre penser du religieux» (p. 103). Penser, donc, une “symbolisation”, un “dépassement” et les “médiations” (p. 111–113), à l’heure où ont perdu toute crédibilité d’un côté les rêves de progrès et de révolutions heureuses et de l’autre les traditionalismes emmurés dans leurs fixismes anhistoriques. L’une des contributions théoriques et pratiques les plus attachantes exprimées sur cette ligne propositionnelle, concerne le double rapport des traditions au monde et à autrui. On retiendra la critique du modèle communautaire du lien social, investi d’un “commun” affectif voire fusionnel. Là-contre, PG suit volontiers ce que Jean-Luc Nancy a appelé l’“inappropriable”, … un inappropriable fidèle à l’événement improbable ou impossible qui surgit “anarchiquement”, comme disait déjà Levinas, dans la pluralité irréductible de sens. Appeler cette exposition un “transcendantal “comme s’y emploie Gisel après Nancy, c’est faire droit à notre condition originaire mais aussi à ce que requiert notre situation nouvelle de confrontation interreligieuse et interculturelle, où toute réalisation doit/peut distinguer, dans son en-deçà, la différence de l’excès.
Reste qu’en christianisme, cet originaire vécu à même tradition, doit se penser en articulation avec le phénomène historique, mieux: l’événement qu’est Jésus où s’origine, précisément historialement (dans la trentaine d’années de sa vie terrestre), la tradition chrétienne.
En invoquant dans la dernière partie du livre l’autorité de Pierre Manent (p.130 et suivantes) qui a stigmatisé avec force et talent la réduction “individualiste” des sociétés modernes et a réhabilité, à son encontre, l’idée de corps social d’appartenance4, P. Gisel veut retirer un suc précieux pour les coexistences nécessaires, à savoir l’exigence d’une double inscription des sujets humains: dans un corps social de conviction et dans un corps social civique. Quelle en est la promesse? Une régulation de l’une et de l’autre, l’une par l’autre. Gisel ne manque de faire observer que certaines traditions religieuses — partant, le judaïsme et le christianisme — non seulement ne répugnent pas à cette partition solidaire mais la promeuvent: la loi juive n’est-elle pas aussi la loi des nations? La cité de Dieu n’est-elle pas, selon saint Augustin, épaisse de la cité des hommes? Sans doute convient-il alors de d’élucider ce que l’alliance entre ces deux irréductibles polarités a toujours déjà inspiré.
NOTES
1 M. BLONDEL, Le point de départ de la recherche philosophique, in «Annales de Philosophie chrétienne», n° juin 1906, p. 249. Blondel a écrit abondamment sur la notion de “tradition”; voir “Histoire et dogme” (1904); Vocabulaire Lalande: article “Tradition” (1921); Correspondance, M. Blondel-J. Wehrlé, (1924–1928); La philosophie et l’esprit chrétien (1944). Nous nous permettons de renvoyer ici notre étude : De l'histoire à la tradition. La réaction philosophique de M. Blondel, in Fr. Bousquet et J. Doré (ed.), Théologie et histoire, Beauchesne 1997, pp.109–131.
2 Thomas D’AQUIN, Somme de théologie, Ia IIae, q. 91, a. 4. Voir Gaston FESSARD, Autorité et bien commun, Aubier- Montaigne, 1969 ainsi que Jacques Maritain, La personne et le bien commun, dans Jacques et Raïssa Maritain, (Euvres complètes, vol IX, Fribourg (Suisse), Paris, Editions universitaires, Editions Saint-Paul, 1990.
3 Thomas D’AQUIN, Somme contre les Gentils, III, 17; Somme de théologie, Ia, IIae, q. 60, a. 5, ad 5.
4 Pierre MANENT, Situation de la France, Paris, Desclée de Brouwer, 2016.
 IT
IT  EN
EN