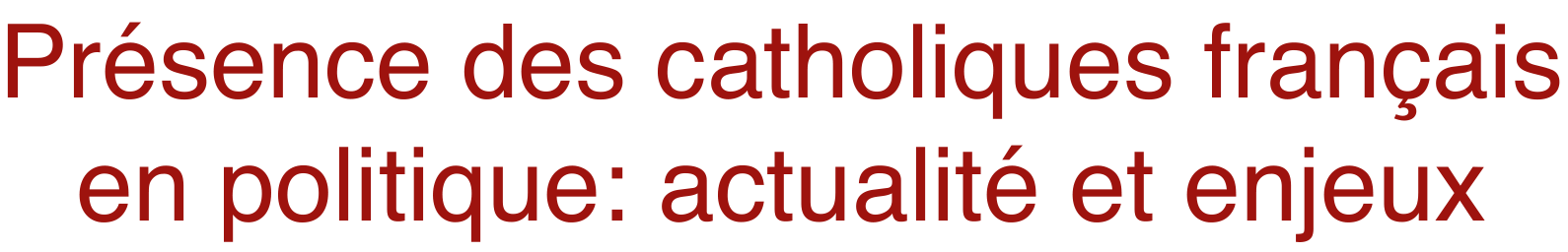
SÉBASTIEN PERDRIX
Le retour des catholiques en politique?

 a Loi Taubira qui a ouvert en 2013 le mariage aux personnes de même sexe (“le mariage pour tous”) a suscité une vague d’opposition d’une ampleur peu commune en France. Entre l’automne 2012 et le printemps 2013, des manifestations ont rassemblé en province et à Paris plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce mouvement connu sous le nom de “Manif pour tous”, bien que se voulant a-confessionnel, était majoritairement constitué de catholiques. D’abord ignoré puis caricaturé (taxé d’homophobie) par l’opinion médiatique dominante favorable au mariage homosexuel, le succès inattendu de la Manif pour tous avec son million de manifestants au plus fort du mouvement a contraint les médias à s’intéresser à ce phénomène. Certains, comme Gaël Brustier, n’hésitent pas à parler d’un “mai 68 conservateur” ou d’un “mai 68 inversé”1. Assiste-t-on depuis 2013 au retour des catholiques français en politique2? La question est sans doute mal posée. A vrai dire, les catholiques ont toujours été présents dans le champ du politique. Contrairement à d’autres pays européens, la France n’a certes jamais connu de tradition de démocratie chrétienne, si bien qu’il est difficile de quantifier l’engagement partisan des catholiques3. Ainsi que le souligne le sociologue Yann Raison du Cleuziou, “les partis ne leur semblent pas l’espace le plus adéquat pour ‘’servir’’ avec ‘’désintéressement’’ la société4”. Cependant, si les catholiques militent peu en groupe constitué, ils sont très présents sur le terrain social et sociétal, ainsi que dans les corps de l’Etat. Avec la Manif pour tous et la naissance d’un mouvement politique comme Sens commun, il semble qu’il s’opère comme une mutation de l’engagement politique des catholiques. Une partie des cathos est en train de passer du politique à la politique. Il se peut que l’on assiste prochainement à l’émergence de nouvelles figures de leaders et d’acteurs politiques ouvertement catholiques issus des rangs de la Manif pour tous.
a Loi Taubira qui a ouvert en 2013 le mariage aux personnes de même sexe (“le mariage pour tous”) a suscité une vague d’opposition d’une ampleur peu commune en France. Entre l’automne 2012 et le printemps 2013, des manifestations ont rassemblé en province et à Paris plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce mouvement connu sous le nom de “Manif pour tous”, bien que se voulant a-confessionnel, était majoritairement constitué de catholiques. D’abord ignoré puis caricaturé (taxé d’homophobie) par l’opinion médiatique dominante favorable au mariage homosexuel, le succès inattendu de la Manif pour tous avec son million de manifestants au plus fort du mouvement a contraint les médias à s’intéresser à ce phénomène. Certains, comme Gaël Brustier, n’hésitent pas à parler d’un “mai 68 conservateur” ou d’un “mai 68 inversé”1. Assiste-t-on depuis 2013 au retour des catholiques français en politique2? La question est sans doute mal posée. A vrai dire, les catholiques ont toujours été présents dans le champ du politique. Contrairement à d’autres pays européens, la France n’a certes jamais connu de tradition de démocratie chrétienne, si bien qu’il est difficile de quantifier l’engagement partisan des catholiques3. Ainsi que le souligne le sociologue Yann Raison du Cleuziou, “les partis ne leur semblent pas l’espace le plus adéquat pour ‘’servir’’ avec ‘’désintéressement’’ la société4”. Cependant, si les catholiques militent peu en groupe constitué, ils sont très présents sur le terrain social et sociétal, ainsi que dans les corps de l’Etat. Avec la Manif pour tous et la naissance d’un mouvement politique comme Sens commun, il semble qu’il s’opère comme une mutation de l’engagement politique des catholiques. Une partie des cathos est en train de passer du politique à la politique. Il se peut que l’on assiste prochainement à l’émergence de nouvelles figures de leaders et d’acteurs politiques ouvertement catholiques issus des rangs de la Manif pour tous.
Une nouvelle génération de militants catholiques de droite
Les enquêtes sur le vote des catholiques indiquent que traditionnellement leurs suffrages se portent plutôt à droite. Plus les catholiques se disent “pratiquants” moins ils ont tendance à voter aux extrêmes et notamment à l’extrême-droite (Front National). Ce sont ces catholiques de droite, ordinairement peu portés à la militance, qui se sont levés au moment de la redéfinition du mariage allant jusqu’à affronter dans la rue le gouvernement mené par une majorité de gauche. Ainsi s’est réveillé en France la vieille guerre entre la gauche et les catholiques, guerre qui dure en fait de plus de deux siècles et qui s’était apaisée depuis quelques années, notamment sous les précédents gouvernements de droite. Le président François Hollande et son premier ministre Emmanuel Valls ont contribué à raviver les tensions entre l’Eglise et la République par leur mépris affiché pour ces catholiques incarnant les derniers restes d’une “France du passé”.
Le renouveau d’une forme intolérante de la laïcité et le sentiment d’être considérés comme des citoyens de seconde zone par une partie de la classe politique a eu pour effet de galvaniser les troupes de la Manif pour tous dans le sens d’un engagement civique plus visible et plus organisé. De ses rangs, comme je l’ai déjà signalé, est sorti un mouvement politique, Sens commun, dont l’un des objectifs est de faire entendre au sein de la droite traditionnelle une autre voix: celle de la conscience catholique. Lors des dernières élections présidentielles de 2017, les catholiques, bien que désormais minoritaires en France, sont apparus comme une force politique de poids, très convoité par la droite, mais aussi par une partie de l’extrême droite représentée par la “philo-catholique” Marion Maréchal Le Pen. Le candidat de droite François Fillon a pu compter sur le soutien de Sens commun avant d’être écarté de la course à la présidentielle pour des affaires morales. La victoire d’Emmanuel Macron a cependant rebattu les cartes en entraînant un affaiblissement des parties historiques. Il est actuellement difficile de voir comment les catholiques et notamment les cathos de droite vont désormais peser sur la vie politique.
La disparition des «cathos de gauche»?
Le fait remarquable de l’évolution de la vie politique en France depuis 2013 est donc le renouveau d’un militantisme partisan chez les catholiques de droite qui ne flirte pas d’emblée avec les extrêmes (comme l’Action française). Ce fait est remarquable car depuis la Libération ceux qui militaient parmi les catholiques étaient idéologiquement à gauche. Et jusque dans les années 80, il y avait parmi les cathos de gauche une sympathie non dissimulée pour le marxisme. Pour reprendre les catégories sociologiques de Y. Raison du Cleuziou5 , les “catholiques observants” et “charismatiques” ont ainsi pris la place des “catholiques émancipés” (gauches et extrême-gauche) et pour une part des “conciliaires ou fraternels » (centredroit) dans le domaine de la militance politique. La force des “observants” est de pouvoir encore compter sur une jeune génération de catholiques éduqués et maîtrisant les réseaux sociaux.
La Manif pour tous semble avoir sonné le glas des “cathos de gauche”. Jacques Julliard remarque à ce propos que “tout se passe comme si le christianisme de gauche s’était abîmé dans le social, et le social dans le sociologique6”. Le catholicisme de gauche en intégrant la sécularisation au point de devenir un vague humanisme vidé de toute substance spirituelle tend à disparaître faute de renouvellement. Une polémique datant de janvier 2018 au sujet du “droit fondamental à l’avortement” a laissé penser à G. Brustier que les cathos de gauche s’étaient réorganisés au point de signer leur “grand retour”7. Mais que représente un mouvement d’action catholique comme le MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne)? Il ne toucherait que quelques milliers de jeunes, tout au plus. Peut-on encore se définir comme catholique lorsque l’on défend des positions idéologiques qui vont à l’encontre de l’enseignement constant du Magistère ou que l’on a abandonné toute pratique religieuse? Au delà des critères sociologiques comme la reconnaissance de certaines valeurs du catholicisme, force est de recourir à des critères autres comme ceux de l’orthodoxie et de l’orthopraxie en y intégrant un légitime pluralisme d’expression et d’opinion. Ainsi des “quatre familles des catholiques français” seulement trois pourraient encore prétendre au qualificatif de catholique.
Les rapports en l’Eglise en France et la République
Bien que la France ait connu entre la fin du XIXe et le début du Xxe siècles de violentes luttes entre l’Eglise et la République, les relations se sont apaisées depuis plusieurs décennies. Les catholiques de France ont intégré le principe de séparation des sphères politiques et religieuses et ne constituent aucune menace pour la souveraineté de l’Etat. Rare sont les moments où les catholiques en corps constitué s’élèvent contre les lois de la République au nom de la liberté ou du bien commun. En 1984, l’Eglise s’était mobilisé contre la Loi Savary qui mettait en cause le statut de l’enseignement confessionnel. Face à la mobilisation, le gouvernement Mitterrand avait reculé. Il faudra donc attendre 2013 et le Mariage pour tous pour voir une partie des catholiques de France protester à nouveau contre le caractère injuste d’une loi de la République. Ainsi que nous l’avons évoqué plus haut, l’attitude méprisante d’une partie de la classe politique au nom d’une certaine conception de la laïcité a blessé les catholiques. Cette attitude s’inscrit dans un tendance bien présente à gauche mais aussi à droite parmi les partisans d’une conception radicale de la laïcité qui ne manquent pas les occasions pour dénoncer les risques d’ingérence des religieux dans les affaires de l’Etat (droit à l’IVG [Interruption Volontaire de Grossesse], PMA [Procréation Médicalement Assistée], GPA [Gestation Pour Autrui]...), ranimant ainsi la flamme de la “guerre des deux Frances”. Concernant les catholiques, la chose prête à sourire puisqu’ils ne sont pas plus qu’une minorité, certes “créative”, mais loin de constituer un contre-pouvoir. La dénonciation récurrente de la menace catholique n’est en fait qu’un paravent pour cacher les peurs face à la montée de l’Islam en France dont nombre de pratiques sont jugées incompatibles avec les mœurs républicaines.

C’est dans ce contexte qu’il convient de comprendre le discours du Président Macron aux Bernardins prononcé le 9 avril 2018. En présence de la conférence épiscopale, le Président de la République motive sa volonté de rencontrer l’Eglise en France ainsi: “si nous l’avons fait, c’est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l’Eglise et l’Etat s’est abîmé, et qu’il nous importe à vous comme à moi de le réparer8”. Face à un pays “qui ne ménage pas sa méfiance à l’égard des religions”, E. Macron réaffirme l’existence de liens indestructibles entre la nation française et le catholicisme. “[L]a France a été fortifiée par l’engagement des catholiques.” Le temps est venu de ne plus méconnaître ou d’ignorer les catholiques de France et ne plus les laisser dans le sentiment d’être aux “marches de la République”. De plus, il promeut une conception de la laïcité qui loin de privatiser
le fait religieux, reconnaît “la part sacrée” qui nourrit tant de citoyens. Fort de ces principes, le président convie les catholiques à retrouver confiance dans les politiques et la politique pour servir à nouveau la nation. La pointe de son discours va prendre la forme d’un vœu solennel, à savoir que l’Eglise fasse trois dons à la République: le don de sa sagesse, le don de son engagement et le don de sa liberté.
Faut-il ne voir dans ce discours qu’une simple manœuvre de séduction de l’électorat catholique? Nous ne le pensons pas. Le Président a pris le risque de se mettre à dos les “hussards de la République”. Le discours aux Bernardins augure de relations apaisées entre les catholiques et la République. Il doit d’abord être accueilli avec bienveillance comme une invitation à s’engager politiquement. Cependant deux points de tension méritent d’être soulignés. Premièrement, si E. Macron appelle de ses vœux la sagesse des croyants, il n’attend pas de la voix de l’Eglise qu’elle soit “injonctive”, mais humblement “questionnante”; “je n’attends pas des leçons mais plutôt [une] sagesse d’humilité”. L’Eglise peut-elle se contenter de n’être qu’une voix de plus dans le concert de la cacophonie éthique? Deuxièmement, tout en rappelant la liberté de croire ou ne pas croire, E. Macron rappelle à l’ordre l’Eglise et lui demande “de respecter absolument et sans compromis aucun toutes les lois de la République”. Le don de la liberté se voit ainsi muselé. A cette demande, les catholiques ne peuvent que répondre: non possumus! Le conscience chrétienne – et tout simplement humaine – doit avoir la liberté de juger des lois humaines à la lumière de la loi morale.
Les enjeux politiques du “moment catholique”
Le discours de Mgr Georges Pontier aux Bernardins souligne quelques uns des enjeux politiques dans lesquels les catholiques de France auront à s’engager9. Le président de la Confé rence des évêques de France liste ainsi: la révision prochaine des lois de bioéthique, la présence de la communauté musulmane, la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté, la question environnementale et celle des flux migratoires. Sur la bioéthique et le spectre d’une “PMA pour tous”, l’institution ecclésiale et les lobbys catho liques comme l’Alliance Vita se sont déjà forte ment mobilisés lors des récents Etats Généraux de la bioéthique. Pour le moment, le gouvernement a souhaité jouer la carte du dialogue et de l’écoute. E. Macron prendra-t-il le risque de voir à nouveau les catholiques descendre dans la rue? Quant aux questions liées à l’Islam et aux flux migratoires, Mgr G. Pontier ne cache pas ses craintes à propos des “soupçons permanents” envers l’Islam et les tentations de replis parmi les français et donc aussi les catholiques.
En effet, le discours politique s’est focalisé depuis quelques années autour du thème de l’identité et des racines chrétiennes. Y. Raison du Cleuziou défend la thèse selon laquelle on assisterait à une convergence entre la droite (et la droite “dite forte”), les intellectuels “néo-réactionnaires” et les catholiques observants. Le produit de cette convergence serait alors “un néo-républicanisme identitaire dont le catholicisme tiendrait lieu de religion civile sous couvert patrimonial, dans un cadre laïque activé principalement pour décourager les musulmans français10.” Si la thèse se confirmait, il y aurait alors un danger d’instrumentalisation d’une partie des catholiques à des fins politiques en contradiction avec plusieurs aspects de la doctrine sociale de l’Eglise. Il est certain que parmi les “observants” et les “traditionalistes”, il se trouve des nostalgiques de Benoît XVI. Ceux-ci ne manquent pas de faire des procès d’intention à François, “pape vert”, relativiste et vendu au multiculturalisme.
Le repli d’une partie des catholiques sur le thème de l’identité ne révèle pas tant la nécessité de redéfinir le “vivre ensemble” ou “le contrat social” comme le dit maladroitement le document de 2016 des évêques11 que la nécessité de retrouver le sens du bien commun. François Daguet va dans ce sens en affirmant que la question de l’identité n’est pas la bonne question à se poser dans la situation actuelle de la France:
[...] lorsque l’on devient incapable de formuler ce qui finalise la vie de la cité, l’unité de celle-ci devient problématique. La question de l’identité de la cité politique dévoile en fait l’incapacité à exprimer ce qui la finalise. Le bien commun, le bien vivre, est devenu informulable. Là réside, selon nous, la cause profonde de la tragédie européenne actuelle, qui vaut sans doute pour tout le monde libéral12.
Selon nous, la question d’aujourd’hui n’est pas de savoir en quoi l’identité chrétienne prétendue et passée de la France serait de nature à prévaloir sur l’identité musulmane de communautés importantes sur le territoire national, elle est de parvenir à exprimer le projet politique d’une société libérale qui ne semble plus se définir que dans son activité économique, sur fond d’individualisme juridiquement garanti par l’édifice des droits13.
L’urgence n’est donc pas celle de l’identité, mais celle du lien entre morale et politique afin de retrouver des conceptions communes du vrai et du faux, du bien et du mal et du juste et de l’injuste comme principes de base de la vie de toute cité humaine.
S’il y a un moment catholique en France, il est de travailler à la convergence de tous les citoyens de bonne volonté et en premier lieu chez les catholiques, quelle que soit leur sensibilité et les étiquettes partisanes. Il n’est pas certain qu’un catholique puisse se retrouver uniquement dans une droite néo-libérale et conservatrice. Il y a des enjeux sociaux (pauvreté, écologie, immigration) et sociétaux (famille et bioéthique) qui ne sont ni le privilège de la gauche pour les premiers, ni de la droite pour les seconds. Tous concernent les catholiques puisque “tout est lié”.
NOTES
1 Cf. Gaël BRUSTIER, Le Mai 68 conservateur, Que restera-t-il de la Manif pour tous?, Paris, Cerf, 2014.
2 Sur le thème du retour des catholiques voir: Vincent TRÉMOLET DE VILLERS et Raphaël STAINVILLE, Et la France se réveilla, Enquête sur la révolution des valeurs, Paris, Toucan, 2013; Gérald DE SERVIGNY, Les cathos sont-ils de retour?, Perpignan, Artège, 2017 et Jean-Luc MARION, Brève apologie pour un moment catholique, Paris, Grasset, 2017.
3 De fait le MRP Mouvement républicain populaire (1944-1967) est un parti démocrate chrétien, mais c’est un cas isolé.
4 Yann RAISON DU CLEUZIOU, “Les quatre familles des catholiques français” [en ligne], Sciences humaines, Mars/avril2017. Accès: https://www.scienceshumaines.com (consulté le 3 août 2018).
5 Cf. Y. RAISON DU CLEUZIOU, Qui sont les cathos aujourd’hui? Sociologie d’un monde divisé, Paris, DDB, 2014.
6 Jacques JULLIARD, “Gauche et catholicisme”, Mil neuf cent 34 (2016), p. 9-16 [p. 12].
7 Cf. G. BRUSTIER, “Le grand retour des cathos de gauche” [en ligne], regards.fr, 1 avril 2018. Accès: http://www.regards.fr (consulté le 3 août 2018).
8 Emmanuel MACRON, “Discours du Président de la République devant les évêques de France au Collège des Bernardins” [en ligne], 9 avril 2018. Accès: https://eglise.catholique.fr (consulté le 3 août 2018).
9 Mgr Georges PONTIER, “Discours de Mgr Georges PONTIER à l’adresse des invités à la soirée du 9 Avril 2018 aux Bernardins” [en ligne]. Accès: https://eglise.catholique.fr (consulté le 3 août 2018).
10 Y. RAISON DU CLEUZIOU, “Un ralliement inversé? Le discours néo-républicain de droite depuis la Manif pour tous”, Mil neuf cent 34 (2016), p. 125-148 [p. 127].
11 Cf. Conseil permanent de la Conférence des évêque de France, Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique [en ligne], 2016. Accès: https://eglise.catholique.fr (consulté le 3 août 2018).
12 François DAGUET, “La question de l’identité est-elle la bonne? Qu’est-ce qu’une communauté politique?”, Nouvelle revue théologique 140 (2018), p. 295-307 [p. 303].
13 F. DAGUET, “La question de l’identité...”, p. 304. Voir aussi: Pierre Manent, Situation de la France, Paris, Desclée de Brouwer, 2015.
 IT
IT  EN
EN 











