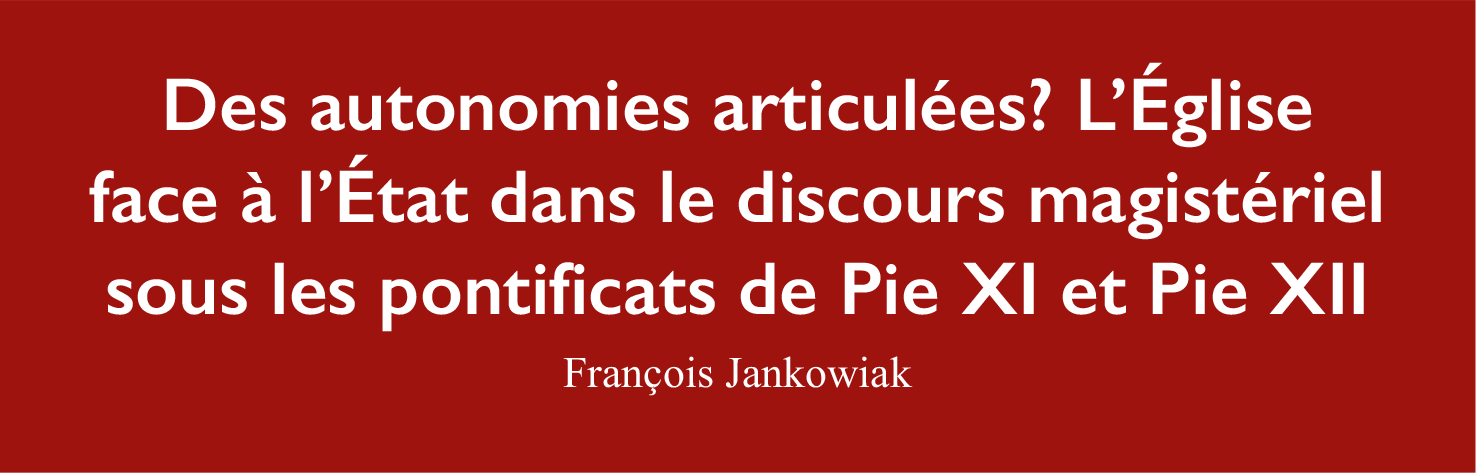
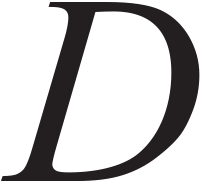 istincts et toutefois unis, selon les vrais principes ». Appliqués par Pie XII le 23 mars 1958 aux « deux pouvoirs » de l’État et de l’Église lors de son allocution à la colonie des Marches1, ces deux adjectifs à la simplicité, voire la limpidité apparentes reposent sur un socle d’une extrême richesse doctrinale et
istincts et toutefois unis, selon les vrais principes ». Appliqués par Pie XII le 23 mars 1958 aux « deux pouvoirs » de l’État et de l’Église lors de son allocution à la colonie des Marches1, ces deux adjectifs à la simplicité, voire la limpidité apparentes reposent sur un socle d’une extrême richesse doctrinale et  d’une grande complexité historique. Cette complexité, laquelle a nourri la réflexion pluriséculaire du magistère pontifical et contribué à l’évolution des formes du discours ainsi qu’à l’enrichissement substantiel de l’argumentaire déployé, a néanmoins produit une frappante continuité doctrinale sur ce thème d’importance majeure. Le motif de la libertas Ecclesiae, aussi ancien que l’Église elle-même, naquit peut-être, suivant ici l’hypothèse émise par Émile Poulat, « avec les religions de salut, affirmant leur spécificité par rapport aux religions de société (qui s’imposèrent des cités antiques à l’empire romain) »2, ces dernières étant intrinsèquement liées et subordonnées au pouvoir politique. La revendication d’autonomie, comprise au sens prêté à Aristote, qui l’envisageait essentiellement à l’échelon individuel, de capacité de se donner à soi-même ses propres lois (nomoi), s’étendit à la sphère de la Cité, pour signifier la condition fondatrice de sa liberté politique3 ; cette acception institutionnelle la fit brandir par l’institution ecclésiale, aux moments de tension particulièrement fortes, à l’encontre de l’État romain païen puis, une fois ouverte l’ « ère constantinienne », face au césaropapisme du Bas-Empire puis de Byzance et, pour la partie occidentale de la chrétienté, à l’occasion de la querelle des Investitures et de la Réforme grégorienne. La caractérisation de cette période comme celle, suivant la formule devenue célèbre, de l’Église placée « au pouvoir des laïcs »4 motive et explique largement l’organisation d’une liberté « par le haut », soit en assurant l’indépendance du chef de l’Église. Celle-ci se traduisit notamment, en phase de vacance du Siège apostolique, par le monopole de l’élection pontificale confié en 1059 aux cardinaux-évêques par le décret In nomine Domini du pape Nicolas II5. La configuration de cette liberté in capite, complétée en 1179 par l’imposition de la règle de la majorité qualifiée des deux-tiers, précéda de peu la réapparition, au XIIe siècle, des définitions d’origine antique de la science politique, telles l’autarcie ou l’isonomie ; l’emportant dans les universités naissantes sur les maîtres ès-arts, les juristes des deux droits les étudièrent et les approfondirent, avant que Guillaume de Moerboeke redécouvre et traduise la Politique d’Aristote au cours de la décennie 1260. Thomas d’Aquin, instruit des commentaires de l’Éthique laissés par Robert Grosseteste et Albert le Grand, révèle une connaissance complète de la Politique dans la seconde partie (IIa IIae) de la Somme théologique6. Outre sa préférence, argumentée, pour le régime monarchique face aux regimina plurium, l’Aquinate déploie un raisonnement qui, tout en maintenant l’autorité temporelle, ou plus précisément les communautés politiques, dans le schéma de la Création, leur confère la légitimité dans leur propre sphère7.
d’une grande complexité historique. Cette complexité, laquelle a nourri la réflexion pluriséculaire du magistère pontifical et contribué à l’évolution des formes du discours ainsi qu’à l’enrichissement substantiel de l’argumentaire déployé, a néanmoins produit une frappante continuité doctrinale sur ce thème d’importance majeure. Le motif de la libertas Ecclesiae, aussi ancien que l’Église elle-même, naquit peut-être, suivant ici l’hypothèse émise par Émile Poulat, « avec les religions de salut, affirmant leur spécificité par rapport aux religions de société (qui s’imposèrent des cités antiques à l’empire romain) »2, ces dernières étant intrinsèquement liées et subordonnées au pouvoir politique. La revendication d’autonomie, comprise au sens prêté à Aristote, qui l’envisageait essentiellement à l’échelon individuel, de capacité de se donner à soi-même ses propres lois (nomoi), s’étendit à la sphère de la Cité, pour signifier la condition fondatrice de sa liberté politique3 ; cette acception institutionnelle la fit brandir par l’institution ecclésiale, aux moments de tension particulièrement fortes, à l’encontre de l’État romain païen puis, une fois ouverte l’ « ère constantinienne », face au césaropapisme du Bas-Empire puis de Byzance et, pour la partie occidentale de la chrétienté, à l’occasion de la querelle des Investitures et de la Réforme grégorienne. La caractérisation de cette période comme celle, suivant la formule devenue célèbre, de l’Église placée « au pouvoir des laïcs »4 motive et explique largement l’organisation d’une liberté « par le haut », soit en assurant l’indépendance du chef de l’Église. Celle-ci se traduisit notamment, en phase de vacance du Siège apostolique, par le monopole de l’élection pontificale confié en 1059 aux cardinaux-évêques par le décret In nomine Domini du pape Nicolas II5. La configuration de cette liberté in capite, complétée en 1179 par l’imposition de la règle de la majorité qualifiée des deux-tiers, précéda de peu la réapparition, au XIIe siècle, des définitions d’origine antique de la science politique, telles l’autarcie ou l’isonomie ; l’emportant dans les universités naissantes sur les maîtres ès-arts, les juristes des deux droits les étudièrent et les approfondirent, avant que Guillaume de Moerboeke redécouvre et traduise la Politique d’Aristote au cours de la décennie 1260. Thomas d’Aquin, instruit des commentaires de l’Éthique laissés par Robert Grosseteste et Albert le Grand, révèle une connaissance complète de la Politique dans la seconde partie (IIa IIae) de la Somme théologique6. Outre sa préférence, argumentée, pour le régime monarchique face aux regimina plurium, l’Aquinate déploie un raisonnement qui, tout en maintenant l’autorité temporelle, ou plus précisément les communautés politiques, dans le schéma de la Création, leur confère la légitimité dans leur propre sphère7.
Ainsi que le relève Péter Molnár, « même s’il n’est pas exclu que l’initiateur, voire le bénéficiaire de cette argumentation [en faveur de la monarchie] fût la papauté, il n’en demeure pas moins que ces arguments ont été vite adaptés aux monarchies temporelles »8. De façon tendancielle, le discrédit progressivement jeté sur les schémas théocratiques, en dépit du retour en force de l’augustinisme politique au début du XIVe siècle à la faveur du courant nominaliste, a porté au renforcement des libertés respectives des deux Pouvoirs, reconnus autonomes et légitimes, car conformes à la loi divino-naturelle, chacun dans sa sphère propre. Les dissensions ultérieures, qui marquèrent, en leurs expressions régalistes diverses, la période moderne, fournirent un contexte favorable à l’invocation de la libertas Ecclesiae9 comme de l’argumentaire visant à affranchir le Prince de la sujétion pontificale et à assurer sa mainmise sur l’Église locale en passe de devenir « nationale »10.
De manière singulière, le modèle médiéval de la République chrétienne fut remis à l’honneur par la papauté sur le terrain politique, par déploration de la situation faite à l’Église depuis la Révolution française et les pontificats « martyrs » de Pie VI et de Pie VII. Les actes magistériels du XIXe siècle regorgent de références en ce sens11, exaltant la grandeur passée des pontifes ayant sauvé la civilisation exposée aux menaces barbares ou ayant mené à bien la réforme de l’Église en l’arrachant à l’emprise des pouvoirs séculiers. Le pouvoir pontifical exhorta alors à recourir à un droit naturel chrétien, distinct de celui promu par la pensée juridique des Lumières puis par celle de la Révolution française, fondé sur une vision de l’individu porteur et horizon de sa propre finalité et en cela même doté de droits « inaliénables et sacrés » opposables, sous certaines conditions, à l’ordre juridique positif établi par la loi, fruit de la volonté générale, et donc à l’État, le droit se trouvant réduit à la loi. La naissance contemporaine de la Question romaine suscitèrent un recours accru à l’argument de la libertas Ecclesiae, appuyé et relayé, à partir des années 1840, par le courant néo-thomiste et la transposition dans le registre du droit canonique de l’ecclésiologie de la société parfaite (societas juridice perfecta)12. Les formulations les plus abouties de ce principe théologico-politique sont rapportées aux thèses 19 et 20 du Syllabus et explicitées par l’encyclique Quanta cura, Pie IX y rappelant que
Rien ne peut être plus profitable et plus glorieux aux chefs d’État et aux rois que ce que Notre Prédécesseur saint Félix, rempli de sagesse et de courage, écrivait à l’empereur Zénon : « Qu’ils laissent l’Église catholique se gouverner par ses propres lois, et ne permettent à personne de mettre obstacle à sa liberté [...]13.
Par symétrie, et visant spécifiquement le danger du séparatisme, Léon XIII, premier pape élu dans la condition revendiquée de « prisonnier de l’Italie » après l’achèvement de l’unité politique du royaume survenu en 1870, put, dans la série essentielle des encycliques publiées entre 1885 (Immortale Dei, sur la constitution chrétienne des États) et 1892 (Au milieu des sollicitudes), invoquer « une saine et légitime liberté » de l’action de l’État, dès lors que chacune des deux puissances « est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Il y a comme une sphère circonscrite dans laquelle chacune exerce son action, iure proprio »14. Le séparatisme est tenu pour illégitime, la liberté correspondant à la liberté de perdition déjà pointée par saint Augustin à propos des Donatistes, lorsque l’État se prend lui-même pour fin. Le magistère procède alors par analogie, étendant à l’État devenu sa propre totalité le constat déjà dressé pour l’individu – ainsi avait fait Pie VI dans le bref Quod aliquantum de 1791 condamnant la constitution civile du clergé. Cette tentation totalitaire, stigmatisée par Pie XI dans ses trois grandes encycliques formant triptyque, Non abbiamo bisogno, Mit brennender Sorge et Divini Redemptoris, renforçait, en dépit des Accords du Latran refermant la plaie de la Question romaine, l’exigence de la libertas Ecclesiae : dès le premier texte de son pontificat, l’encyclique Ubi arcano Dei (23 décembre 1922), Pie XI rappelait que « [l’Église] ne peut dépendre d’une volonté étrangère dans l’accomplissement de sa mission divine d’enseigner, de gouverner et de conduire au bonheur éternel tous les membres du royaume du Christ », ce qui postulait, « en vertu de son droit originel qu’elle ne peut abdiquer, une pleine liberté et immunité par rapport au pouvoir civil »15. L’encyclique Quas primas du 11 décembre 1925 peut également être lue dans cette perspective : Pie XI y réaffirmait que la royauté du Christ recouvre la sphère temporelle (§ 12 al. 1), plaçant cette assertion dans la continuité des propos tenus par Léon XIII en 1899 dans l’encyclique Annum sacrum et l’étendant au combat majeur contre le « laïcisme » (§ 18), lequel, sous de multiples aspects, se montre attentatoire aux « droits de l’Église »16. Cette expression, dérivant de la thèse défendue par Bellarmin de la potestas indirecta in temporalibus17, conduisait Pie XI à réaffirmer la « forme organique d’une société parfaite » de l’Église (§ 20 al. 2)18.
L’encyclique Mystici corporis de Pie XII, publiée le 29 juin 1943, formera un ultime jalon de cette démonstration, affirmant que l’Église, explicitement identifiée au Corps mystique du Christ depuis le concile Vatican I19, est une société parfaite « en son genre » - sui generis, tout comme avait été campé l’État pontifical dans les années 1860, c’est-à-dire irréductible tant aux autres sociétés temporelles qu’à une pure entité spirituelle. L’année précédente, Pie XII avait exposé, dans son radio-message du 24 décembre 1942, la représentation de l’articulation des libertés de chacune des deux sphères :
« L’Église pose les règles fondamentales de l’ordre intérieur des États et des peuples : promouvoir le respect et l’exercice pratique des droits fondamentaux de la personne humaine ; rejeter toute forme de matérialisme qui ne voit dans le peuple qu’une masse, qu’un troupeau d’individus sans connexion intime ; rendre au travail sa dignité et ses prérogatives ; réveiller la conscience d’un ordre juridique et la défendre contre tout arbitraire ; ramener l’État à sa puissance au service de la société et au respect de la personne humaine »20.
Si ce schéma pourra bien être qualifié de « moderne », et contre-intuitif s’agissant de la perception courante des rapports de l’Église au monde avant le concile Vatican II21, il est surtout enraciné dans la représentation organique nourrie par l’Église des deux Pouvoirs constituant un ordre, lequel ménage la liberté réciproque de chacun : des autonomies articulées en vue du bien commun.
NOTE
1 Trad. fr. dans La Documentation catholique, n°1275, 1958, col. 456.
2 Poulat (Émile), compte-rendu de l’ouvrage de Spinelli (Lorenzo), Libertas Ecclesiae. Lezioni di diritto canonico [Milan, Giuffrè, 1979], Archives de Sciences Sociales des Religions, 53/2, 1982, p. 357-358, cit. p. 357.
3 Le terme n’était toutefois appliqué qu’aux cités-État se trouvant dans l’orbite et sous la menace d’un voisin puissant, et non aux communautés politiques fortes. Voir M. Ostwald, Autonomia : its genesis and early history, Chico [Californie], Scholars Press (coll. American Classical Studies, 11), 1982, et, pour le débat sur les origines du terme, confronté à celui d’eleutheria, E. J. Bickerman, « Autonomia. Sur un passage de Thucydide (I, 144, 2) », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 3e série, V, 1958, p. 313-344. En ce sens, l’autonomie s’oppose à l’hétéronomie, définie comme « le fait, pour une personne ou pour une chose, d’être soumise à des règles d’origine extérieure » (J-P. Chazal, « Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux », dans Études de droit de la consommation. Liber amicorum Jean Calais-Auloy, Paris, Dalloz, 2004, p. 279-309, cit. p. 286). Voir P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, Dalloz (coll. Précis Dalloz), 2000, p. 99-113 ; J.-Ch. Jobart, « La notion de constitution chez Aristote », Revue française de droit constitutionnel, 65/1, 2006, p. 97-143 ; voir aussi J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu’à Aristote, Paris, 1982.
4 É. Amann et A. Dumas, L’Église au pouvoir des laïques (888-1057), Paris, Bloud et Gay (coll. Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours, A. Fliche et V. Martin (dir.), t. VII), 1940.
5 Voir F. Jankowiak, « Libertas Ecclesiae. Les cardinaux sede vacante et la législation du conclave », dans Les cardinaux entre cour et curie. Une élite romaine (1775-2015), F. Jankowiak et L. Pettinaroli (dir.), Rome, École française de Rome (coll. Collection de l’École française de Rome ; 530), 2017, p. 155-166.
6 P. Molnár, « Saint Thomas d’Aquin et les traditions de la pensée politique », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 69/1, 2002, p. 67-113, en particulier p. 79. Au jugement de Michel Villey, cette lecture faite devant ses élèves par Thomas d’Aquin de la Politique d’Aristote et le commentaire qui en a résulté constitua à lui seul « un événement : rien de moins que l’acte de naissance en Europe de la science politique. Dégagée de la morale, elle y retrouve son autonomie : son objet spécifique, l’étude des cités (poleïs). Il ne s’agit plus d’une pastorale coulant de la Parole divine, mais d’une science d’observation » (« Thomas d’Aquin et la formation de l’État moderne », dans Théologie et droit dans la science politique de l’État moderne. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987), Rome, École française de Rome (coll. Publications de l’École française de Rome ; 147), 1991, p. 31-49, cit. p. 34-35. Les italiques figurent dans le texte original.
7 Sur cette construction, voir L. E. Boyle, « The De Regno and the Two Powers », dans Essays in Honour of Anton Charles Pegis, J. R. O’Donnell (éd.), Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1974, p. 237-247 ; L. P. Fitzgerald, « St. Thomas Aquinas and the Two Powers », Angelicum, 56, 1979, p. 515-556 ; F. Daguet, Du politique chez Thomas d’Aquin, Paris, Vrin (coll. Bibliothèque thomiste, 64), 2015, en particulier le ch. IV « Les deux pouvoirs », p. 127-158.
8 Idem, p. 84.
9 Voir Libertas Ecclesiae. Esquisse d'une généalogie (1650-1800), S-M. Morgain (dir.), Paris, Parole et Silence, 2010, ainsi que les nombreux travaux de S. de Franceschi, parmi lesquels La crise théologico-politique du premier âge baroque. Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince : le Saint-Siège face au prisme français, 1607-1627, Rome, École française de Rome (coll. BEFAR ; 340), 2009.
10 Voir à ce sujet les nombreuses publications de ou dirigées par J-P. Durand, parmi lesquelles « Colloque sur les Églises nationales », L’Année canonique, 63, 2001, p. 4-118 ; également B. Basdevant-Gaudemet, « Églises nationales. Histoire d’une expression », dans Id., Églises et autorités, Études d'histoire de droit canonique médiéval, Limoges, Pulim, 2006, p. 285-295.
11 Voir F. Jankowiak, « La papauté médiévale, recours et secours du Saint-Siège au temps du Risorgimento », dans Plenitudo iuris. Mélanges en hommage à Michèle Bégou-Davia, B. Basdevant, F. Jankowiak, F. Roumy (dir.), Paris, Éditions Mare et Martin, 2015, p. 275-296.
12 Au sein d’une abondante bibliographie, voir récemment E. de Valicourt, La société parfaite. Catégorie de la modernité, catégorie théologique [th. hist. du droit, Université Paris-Sud et Institut catholique de Paris], 2016.
13 F.-L.M. Maupied, Le Syllabus et l’encyclique Quanta cura du 8 décembre 1864. Commentaire théologique, canonique, historique, philosophique et politique, et réfutation des erreurs qu’il condamne, Tourcoing- Mouscron, 1876, texte de l’encyclique p. 8-33, cit. p. 28.
14 Léon XIII, encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885, dans ASS, 18, 1885, p. 166. Voir R. Minnerath, Le droit de l’Église à la liberté. Du Syllabus à Vatican II, Paris, Beauchesne (coll. Le Point théologique ; 39), 1982, p. 100.
15 AAS, 14, 1922, § 19, p. 690.
16 AAS, 17, 1925, p. 593-610, cit. p. 600-601.
17 Bellarmin, De Summo Pontifice [1584], dans Id., Opera omnia, t. I, Naples, 1856 [3e controverse].
18 Idem, p. 608-609 : « [...] Ecclesiam, utpote quae a Christo perfecta societas constituta sit, nativo sane iure, quod abdicare nequit, plenam libertatem immunitatemque a civili potestate exposcere, eandemque, in obeundo munere sibi commisso, divinitus docendi, regundi et ad aeternam perducendi beatitatem eos universos qui e regno Christi sunt, ex alieno arbitrio pendere non posse ». Voir G. Sicard, Le christ roi dans la pensée théologico-politique de Pie XI, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, 102/2, 2001, p. 149-166.
19 Concile Vatican I, schéma De Ecclesia, chap. I intitulé Ecclesiam esse Corpus Christi mysticum et chap. III Ecclesiam esse societatem veram, perfectam, spiritualem et supernaturalem (J. Mansi, Sacrorum conciliorum, nova et amplissima collectio, 51, Paris, 1926, col. 539-540). La formulation répondait parfaitement à la définition bellarminienne de l’Église.
20 Pie XII, Radio-message au monde entier, 24 décembre 1942, trad. fr. dans Centre d’études de la doctrine sociale de l’Église, L’Église et les libertés, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1974, p. 150.
21 Voir notamment les réflexions de Ph. Portier, « L'Église catholique face au modèle français de laïcité », Archives de sciences sociales des religions, 129, 2005, p. 117-134.
 IT
IT  EN
EN 











