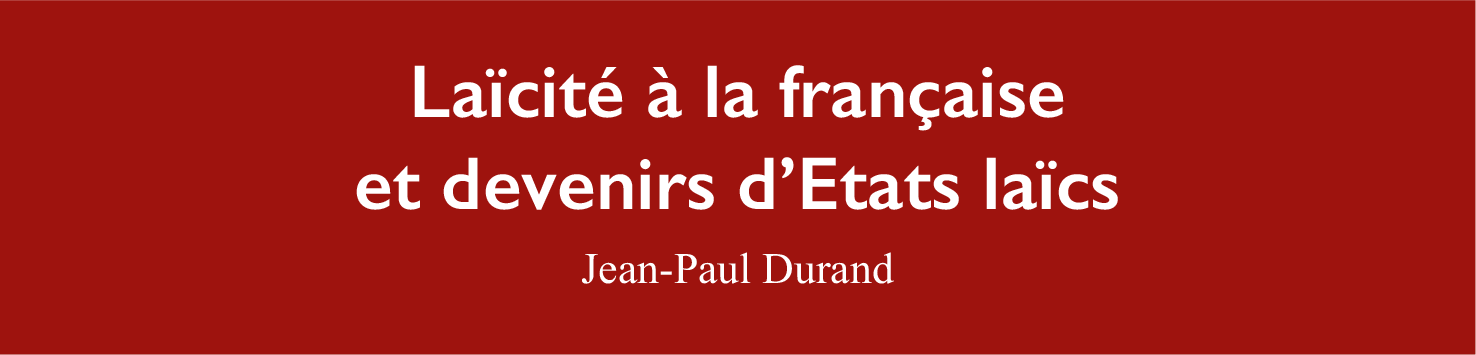
Préliminaires

 ien que pour l’histoire de la France, il est possible de traiter des laïcités à la française, d’employer ainsi le pluriel : les laïcités. En 1998, il y a vingt ans, des laïcités à la française ont été exposées d’un point de vue générique dans les pages du livre co-écrit par le magistrat Jean-Paul Costa et l’historien Guy Bedouelle op, publié aux Presses Universitaires de France. Mais il faut ajouter au point de vue générique1 le point de vue de la concomitance géographique , comme j’ai dû plusieurs fois le publier2, et que, surtout, le Conseil constitutionnel a pu le rappeler en 2013 : car en 2018-2019 par exemple, existent , de droit en territoire français de la Métropole et de son Outre-Mer, plusieurs formes différentes de laïcités . Nous pouvons en dénombrer huit 3 . Différentes formes de laïcités cohabitent en France, c’est à dire au sein du régime constitutionnel de la République française , République qui reste néanmoins Une et indivisible . Ce sont des régimes se différenciant au nom de plusieurs critères qui sont territoriaux, génériques, diplomatiques4, législatifs , règlementaires, en regard de la jurisprudence civile, de la jurisprudence administrative et de la pratique administrative comportant un très grand nombre de circulaires fort riches, presque toutes publiées et s’imposant à chaque fonctionnaire concerné.
ien que pour l’histoire de la France, il est possible de traiter des laïcités à la française, d’employer ainsi le pluriel : les laïcités. En 1998, il y a vingt ans, des laïcités à la française ont été exposées d’un point de vue générique dans les pages du livre co-écrit par le magistrat Jean-Paul Costa et l’historien Guy Bedouelle op, publié aux Presses Universitaires de France. Mais il faut ajouter au point de vue générique1 le point de vue de la concomitance géographique , comme j’ai dû plusieurs fois le publier2, et que, surtout, le Conseil constitutionnel a pu le rappeler en 2013 : car en 2018-2019 par exemple, existent , de droit en territoire français de la Métropole et de son Outre-Mer, plusieurs formes différentes de laïcités . Nous pouvons en dénombrer huit 3 . Différentes formes de laïcités cohabitent en France, c’est à dire au sein du régime constitutionnel de la République française , République qui reste néanmoins Une et indivisible . Ce sont des régimes se différenciant au nom de plusieurs critères qui sont territoriaux, génériques, diplomatiques4, législatifs , règlementaires, en regard de la jurisprudence civile, de la jurisprudence administrative et de la pratique administrative comportant un très grand nombre de circulaires fort riches, presque toutes publiées et s’imposant à chaque fonctionnaire concerné.
Mais l’usage des laïcités et de leurs formes plus ou moins typées de concrétudes principielles et cliniques ne se limite pas au XX° et au XXI° siècle à la sphère de la souveraineté française.
Je me souviens avoir co-dirigé avec l’historienne du droit des religions , Mme le Professeur émérite Michèle Bégou-Davia , une thèse à Paris , au moins, quatre constitutions adoptées successivement par la République du Congo (Brazzaville) depuis son indépendance ; une thèse où le doctorant (le Dr Juhan Mackosso, Congolais ) a pu observer et tenter d’interprêter l’apparition dans leurs statuts respectifs du mot laïcité ou du mot laïc. 5
Il nous est donc demandé, pour la séance académique commémorative du 6 décembre 2018 à Rome, d’évoquer les laïcités à la française et quelques devenirs d’Etats laïcs.
La présente séance commémorative du jeudi 6 décembre 2018 qui se tient à l’Université pontificale de l’Angelicum est l’une des étapes en réalité d’un séminaire international pluriannuel : un séminaire qui a été créé par l’Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique (AIDOP) et par le Centre d’Etude du Saulchoir (CES), le 9 décembre 2015 à Paris, avec pour thème « le devenir de l’Etat laïc dans le monde ». Ni l’ensemble de ce séminaire pluriannuel, ni sa séance romaine spéciale du 6 décembre 2018, ne procèdent eux-mêmes à des études de bilans en France et dans le monde en histoire, en sociologie, en science politique, ni philosophie et théologie du théologico-politique. Mais ces séances interrogent sans relâche en histoire, en investigations universitaires comparatives, en philosophie et théologie des laïcismes anti-religieux et de laïcités qui, elles, ont le propos de cultiver les respects réciproques entre Etats, religions et société civile. C’est ce qui justifie aussi le riche programme de cette courte séance commémorative romaine du 6 décembre 2018. Et sans prétendre exceller en prophéties, ni encore moins en futurologie, la prospective est au cœur de la préoccupation de ce séminaire pluriannuel et de sa présente séance romaine.
Aussi, notre séminaire pluriannuel ose se poser des questions comme celles-ci:
Premier exemple de questionnement:
comment ne pas signaler la situation du devenir de la laïcité en Turquie, problème qui a déjà fait l’objet d’une séance à Paris avec notamment le Révérend Père Alberto Fabio Ambrosio op , chercheur universitaire quant aux mutations politico-religieuses à relire entre la disparition de la Sublime Porte, puis le régime instaurateur de laïcité par le Président Mustapha Kémal Atatürk, ensuite des islamisations et modernisations plus récentes.
Deuxième exemple de questionnement:
est-ce que la loi française du 15 mars 2004 contre le voile et ses suites, ont-elles difficilement assumé les tensions entre diversité et civisme , alors que le régime constitutionnel français n’est pas communautariste, comme l’a rappelé en novembre 2004 le Conseil constitutionnel. Les échos de cette séance romaine du 6 décembre 2018, que recueille ici en 2019 la Revue Ökonomia , publient le texte d’une intervenante prévue au programme de cette séance de décembre 2018 , mais qui avait été empêchée au dernier moment de venir de Paris à Rome : je renvoie donc au texte de la communication de Mademoiselle Anne-Violaine Hardel, Chef du Service juridique de la Conférence française des évêques catholiques romains. Après des études à la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, notamment en droit français des religions et après une séance académique avec elle à Paris à notre séminaire pluriannuel, l’honorable collègue a publié dans ma collection aux Editions du Cerf en novembre 2018 un livre sur cette loi de 2004 et ses suites : Signes religieux et ordre public. 6 L’année 2004 est, en outre, l’année de la parution d’un important rapport du Conseil d’Etat sur la laïcité. Et j’insiste sur le fait que Mademoiselle Anne-Violaine Hardel cite le Professeur Philippe Portier qui a écrit en 2015 : « L’Etat hésite entre reconnaissance et surveillance des religions » ; il précise ceci : « Depuis les années 2000, on voit se développer une laïcité de surveillance , voire d’interdit, avec une véritable restriction des libertés acquises auparavant (La loi de 2004, interdisant les signes religieux ostensibles , marque sans doute le point de départ )». 7 Alors qu’en 1989, le Conseil d’Etat et la circulaire Jospin préconisaient un raisonnement non idéologique, et donc plus respectueux de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. Car un signe n’a pas à être forcément en soi une occasion de trouble de l’ordre public. Et si un signe traverse des circonstances qui troublent l’ordre public, il importe de chercher à ce que ce signe ne soit pas utilisé, ni détourné à des fins susceptibles d’occasionner ou s’accentuer un trouble de l’ordre public. Mais le signe, y compris les signes religieux, ne sont pas en eux-mêmes des troubles faits . Sauf s’ils constituent, malgré eux, une provocation à perturber l’ordre public. Tandis qu’à partir de cette loi de 2004, le juge va devoir chercher , sans doute difficilement , à objectiver le fait qu’un signe soit devenu suffisamment ostensible pour être un signe à interdire, et afin de proscrire son port et cette ornementation.
Troisième exemple de questionnement:
En interrogeant des sociologues, notre séminaire pluriannuel s’interroge pour savoir comment apprécier en France et dans le monde des années 2018-2019 , des régressions ici, des conquêtes là, quant à des progrès dans les définitions et critériologies des laïcités, ainsi que s’agissant des régimes et statuts usant de notions de laïcités.
Nous souffrons aussi de manques de sources documentaires et statistiques , tout en ne négligeant pas les rapports véhéments du Département d’Etat des USA , surtout sur les atteintes à la liberté religieuse et de religion.
Et notre séminaire est notamment attentif aux travaux de nos collaborateurs sociologues investis au séminaire pluriannuel , tels le Canadien catholique Paul André Turcotte et le Français protestant Philippe Gaudin8 .
Sans mentionner hélas ici certaines de leurs publications, nous sommes attentifs aux travaux du Professeur au Collège de France Pierre Rosanvallon. Nous sommes en contacts par le CES aussi avec les chercheurs Lucien Jaume, Laurent Bouvet9, Pierre Manent, Marcel Gauchet.
Ces apports en socio-histoire , en sociologie et en science politique insistent sur de nouveaux déplacements de contextes politico-religieux, notamment en France pendant ces presque vingt premières années du XXI° siécle :
sont remarqués à la fois le discours à Rome prononcé en 2007 au Latran par Monsieur Nicolas Sarkozy , alors Président de la République française , sur la laïcité positive , puis le discours à Paris prononcé aux Bernardins par Monsieur Emmanuel Macron, actuel Président de la République française, sur l’estime appuyée désormais de la part de l’Etat républicain français et de la part de plus larges couches de la population en France à l’égard des religions , à l’égard du catholicisme, quant à leurs contributions au vivre ensemble et à la générosité humaniste et humanitaire. Mais plusieurs sources d’endémie persistent , se développement, et qui fragilisent cette laïcité positive , ainsi que cette estime française en faveur des religions : Comme en 2000-2001 dans le Rapport de Monsieur Régis Debray sur le déficit de culture religieuse des Françaises et Français, comme les travaux , toujours lus et discutés, de Messieurs François Isambert, Jean Séguy , Jacques Maître , Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Edgar Morin, ainsi que de Madame Danièle Hervieu Léger. Ils insistent diversement sur des tendances de sécularisations post-modernes, de radicalisations politico-religieuses, où l’anti-séminisme et la phobie anti-sectes sont relayés surtout par l’islamophobie et la hantise des demandes d’asile et de migrations incontrôlées , mais cruellement exploitée par la criminalité et la corruption. Signalons les travaux épris de responsabilité républicaine pour un ordre public qui puisse conjuguer la liberté de conscience et les intérêts névralgiques tant nationaux , sociaux, qu’écologiques, comme chez le philosophe Claude Nicolet et l’homme politique Jean-Pierre Chevènement. Signalons aussi les écrits de critiques anthropologiques de Madame Elisabeth Badinter, son féminisme souvent très entier et sa méfiance continuée à l’encontre de nombreux phénomènes religieux. Et les institutions religieuses, ainsi que les autres lieux qui sont en rapport avec des mineurs(es), sont tenus de lutter et de prévenir contre toutes les formes d’harcèlements, spécialement sexuels : que ces graves fragilités et ces criminalités ne disqualifient pas les religions – voir des travaux récents de la médecin et théologienne moraliste le Pr Marie Jo Thiel, de l’Université de Strasbourg - , ni les éducateurs et ni les familles, quant à leur fiabilité pour respecter les mineurs(es), toute les personnes, les femmes, les individus les plus fragiles.
Quatrième exemple de questionnement:
concernant l’intégration européenne , malgré le Brexit et concernant les tentatives de solidarisations et de mutualisations et d’ Union de la Méditerranée avant et après les Printemps arabes, berbères, kurdes, ayant surgi autour de l’année 2011 :
A ces tendances affectant le vivre ensemble politico-religieux et les rapports entre laïcisme anti-religieux et laïcité bien tempérée , la France et les autres Etats membres de l’Union européenne , ainsi que les nombreux Etats du Conseil de l’Europe, connaissent de profondes incidences juridiques venant des jurisprudences et des règlementations européennes, comme l’ont récemment analysé les Professeur Belges Louis-Léon Christians et Jean-Pierre Schouppe. Ce dernier oeuvrant en particulier avec le Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas Paris II Emmanuel Decaux, à propos des droit de l’Homme, en Europe et dans le monde . Sans non plus mentionner ici certaines de leurs publications, notons aussi les études dans ces domaines, notamment des Professeurs Roméo Astorri , Sylvio Ferrari à Milan, Giorgio Féliciani à Venise, Francesco Margiotta-Broglio à Florence, Vicenzo Pacillo à Modène, Patrick Valdrini à Naples, Joseph Krukowski à Varsovie, Jifi Raimund Tretera à Pragues, Adrian Loretan à Luzern10, Michal Chakhov à Moscou ; les travaux du Centre « Droit et sociétés religieuses » et du programme Erasmus GRATIANUS, spécialement en histoire du droit et des droits internes de religions, à Sceaux à partir de la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris Sud Paris Saclay : nous avons à la séance du 6 décembre écouté la communication du Professeur François Jankowiak, Directeur de l’équipe d’accueil doctoral et de recherche « Droits et sociétés religieuses » de la Faculté de Droit Jean Monnet de l’Université Paris Sud Paris Saclay. Le texte de cette conférence figure dans le présent dossier de textes en échos des travaux prévus ou réalisé à la séance académique commémorative à l’Angelicum le jeudi 6 décembre 2018 . Notons les travaux à Strasbourg autour de l’œuvre du Professeur René Cassin et les travaux à Paris autour de l’œuvre de l’homme politique Robert Schuman dans le cadre de la Fondation Robert Schuman animée par Monsieur Jean-Dominique Giuliani (voir son imposante Lettre électronique).
Notons l’oeuvre des organismes humanitaires, comme Pharos à Paris, et des organismes religieux d’études et de dialogues auprès du Conseil de l ‘Europe et auprès de l’Union européenne, notamment pour ne jamais effacer le souvenir de la Shoa.
Le Conseil œcuménique des Eglises se veut attentif aux dialogues en Europe et dans le monde, sans oublier les traumatismes subsistants des Croisades médiévales , ni des Guerres de religions, elles qui ont ravagé l’Europe jusqu’aux Traités de Westphalie de 1648.
Des initiatives de l’UNESCO et la création à Paris de L’Institut du monde arabe illustrent quelques-unes des tentatives de dialogue avec et dans l’islam.
Cinquième exemple de questionnement:
Importent sans doute de considérer sans relâche des traçabilités culturelles en matière linguistique et stylistique de terminologie concernant les laïcités :
Par exemple, les travaux de thèse co-dirigée à Paris par le Vice Recteur émérite Roland Jacques omi (Ottawa, Saïgon, Strasbourg) et moi-même, sur les rapports en Inde entre secularism et constitution moderne de l’Union indienne ( Dr Sagayaraj Lourdusamy , Tamoul, Madras, Inde, thèse publiée en Inde en anglais) Ces travaux contribuent à chercher à y mieux comprendre l’inscription du catholicisme en droit indien des religions. Ces études nous préparent à analyser les radicalisations nationalistes des petits partis indous, mettant en danger le degré de laïcité qui habite en quelque sorte le secularism constitutionnel fédéral indien.
Autres échos de développements d’usage du mot laïcité en jurisprudence : En Espagne, l’expression liberté religieuse, comme l’avait écrit le Pr I.-C. Iban , de Madrid, a longtemps semblé suffire après le concile Vatican II de 1962-1965 ; mais plus récemment, le mot laïcité a fini par être introduit.
De même que les Professeurs Romeo Astorri et Giorgio Feliciani, de Milan, ont pu exposer en 2003-2004 dans la Revue d’éthique et de théologie morale ‘Le Supplément’ (RETM), comme quoi la jurisprudence italienne commençait à faire usage du mot laïcité.
Comme j’ai pu le constater et le publier avec le Professeur allemand Gerhard Robbers , - désormais devenu Ministre de la Justice pour le grand Land de Düsseldorf,alors Directeur de recherches universitaires européennes de la liberté religieuse, à Trèves - , qu’à l’occasion des Essener Gespräche sur la comparaison entre séparations allemande et française entre Etat et religions, la culture germanique de la séparation en termes de Trennung éprouvait de la peine à dédouaner la notion bien tempérée de laïcité, chère au Professeur historien français Jean-Marie Mayeur, des affres persécutrices et d’ostracismes de la notion de laïcisme.
Définir les laïcités non laïcistes en France11 et hors de France? 12
Suite à la constitution française de 1946 qui a proclamé pour la première fois que la République française est laïque, le Professeur de droit Jean Rivero a précisé dès 1949, notamment à partir des études du Professeur Louis Trotabas , qu’il n’existait pas de définition juridique univoque de la laïcité, hormis l’insistance juridique sur la neutralité religieuse de l’Etat, comme le rappelle Mademoiselle Anne-Violaine Hardel dans le texte de sa contribution au présent dossier de la Revue Ökonomia . Dès les années soixante, le Professeur d’histoire Jean-Marie Mayeur, a été de ceux qui ont insisté, afin de qualifier la laïcité, sur la notion de respect réciproque entre l’Etat laïc et les religions, à savoir des partenaires convictionnels religieux ou philosophiques, selon les termes de pratiques du droit européen , à savoir les groupements de convictions. Le professeur lyonnais d’Histoire et missiologue Jacques Gadilles insistera sur une relation politico-religieuse ternaire : l’Etat laïc, les traditions philosophico-spirituelles et aussi l’ensemble plus ou moins pluraliste de la société civile. Sans non plus mentionner leurs travaux, je tiens à signaler qu’en dialogue avec les Conseillers d’Etat français François Méjan, André Damien, Roger Errra, Michel Guillaume, Jean-François Terry, avec l’ancien Directeur central du Bureau des cultes Jean Vacherot, avec le socio-historien Emile Poulat, les professeurs de droit Jacques Robert, Jean Morange, Jean Gaudemet et Jean Imbert, j’ai dû insister pour ma part, dans quelques écrits, sur trois composantes de la catégorie de droit constitutionnel français qu’est la laïcité depuis 1946 :
d’une part, le caractère non confessionnel de l’Etat laïc, avec d’efficientes garanties des libertés de conscience, philosophiques, spirituelles , religieuses, des libertés d’établissement, d’association, de religion, de collectivités de vie commune,
d’autre part, des limites constitutionnelles posées par un ordre public de démocratie parlementaire humaniste incitant au respect réciproque entre tous les partenaires nationaux et étrangers ,
enfin, le maintien de l’option possible, ouverte, entre d’un côté des régimes d’ordre public , où l’Etat reconnaît et subventionne certains ou quelques groupements de conviction, et d’un autre côté des régimes d’ordre public , où l’Etat ne reconnaît, ni subventionne aucun groupement de conviction .
Ce qui signifie que la forme législative de la séparation entre l’Etat laïc et les religions n’est pas l’unique forme que la laïcité peut admettre pour régenter le cadre d’ordre public des rapports entre l’Etat laïc et chaque groupement de religion.
Mais, comment réduire et éviter les discriminations occasionnées par des disparités occasionnées selon des régimes d’ordre public , régimes assignés ou négociés par l’Etat laïc, entre les différentes religions ?
Déjà des systèmes de pondérations d’ordre public, par la loi et par le règlement, peuvent intervenir, afin par exemple qu’entre un culte reconnu et un culte non reconnu , et afin - autre exemple - qu’entre une association déclarée selon la loi française du 1° juillet 1901 et une association inscrite selon la loi allemande de 1908 - francisée à partir des années vingt au retour à la souveraineté française des contrées d’Alsace et de Moselle et reprises dès 1944 - , les conditions d’astreintes et les conditions de capacités puissent réussir à parviennent à un équilibre plus équitable, tout en restant de régimes de natures différentes du même ordre public , et cela en raison de la prégnance de cultures historiques, de l’obligation de liens par traités internationaux, de législations en vigueur à haute sensibilité symbolique.
Or, cette trilogie laïque à la française peut-elle intéresser d’autres pays ?
Faute d’enquêtes, dont la fiabilité suffisamment soit éprouvée, je puis seulement proposer ces quelques observations :
La laïcité n’est pas liée nécessairement au régime républicain, étant donné que des régimes monarchistes - comme celui de l’Espagne - ont intégré des critères de garanties de démocratie parlementaire et de respect , sans ostracisme, ni racisme . Un respect qui soit universel ou interactif, entre chaque Etat concerné , ses partenaires convictionnels et toute la population. Ajouter aux garanties déjà existantes en faveur de la liberté religieuse, des garanties en faveur du respect interactif entre tous les partenaires politico-religieux, cela n’est pas sans portée profonde et durable en anthropologie sociale, religieuse, politique.
Il n‘en reste pas moins que la culture laïque du respect politico-axiologique rencontre de graves défis du fait de la valse des éthiques : ces effondrements de valeurs et de pratiques éprouvent la conscience, l’éducation, le droit, notamment le droit pénal. Certes, le caractère non confessionnel de l’Etat, sa neutralité non confessionnelle d’Etat s’affirment davantage dans le monde . Que faire , en politique, en droit constitutionnel non confessionnel, des valeurs et de l’éthique ?
Perspectives conclusives.
L’Etat non confessionnel est-il un Etat neutre, quant aux valeurs et à l’éthique des individus , des collectivités et des institutions ?
Cependant l’Etat non confessionnel ne peut pas cultiver une neutralité axiologique, ni en éthique , même si des voix individualistes libertaires réclament de la part de l’Etat que ce dernier limite son gouvernement à honorer des prestations compensatoires , afin de ne pas intervenir en morale privée par exemple. Des  Etats conscients de tels périls cherchent des valeurs et des régimes de protection, dans le but de toujours mieux garantir le respect de la dignité et de l’intégrité humaines, à commencer par celles des plus faibles .
Etats conscients de tels périls cherchent des valeurs et des régimes de protection, dans le but de toujours mieux garantir le respect de la dignité et de l’intégrité humaines, à commencer par celles des plus faibles .
Un Etat non confessionnel , même séparé des religions, peut puiser , sans crainte, et de sa propre initiative, de sa propre autorité , dans des valeurs humanistes d’origine religieuse ici, philosophiques là .
Des Etats non confessionnels , même séparés des religions, peuvent subventionner de œuvres religieuses à finalité d’intérêt général, et subventionner les assistances spirituelles que réclament les usagers de services publics au nom de la liberté de conscience, de la liberté religieuse, de la liberté de religion .
Des Etats non confessionnels, même séparés des religions, peuvent estimer avoir à choisir de soutenir les groupements de conviction , s’ils respectent suffisamment l’ordre public de l’Etat de droit, étant donné que des contributions philosophiques et religieuses , mieux comprises, mieux reçues, peuvent plus aisément honorer de légitimes besoins de la population , de la nation , de la société civile, de l’Etat.
Des Etats et courants politico-religieux estiment que l’Etat de droit humaniste doit soutenir tous les groupements de conviction, dans la mesure où les doctrines et les statuts de ces derniers ne s’opposent pas à la dignité humaine, ni aux principes constitutionnels humanistes des Etats non confessionnels concernés.
NOTE
1 Voir aussi notamment les études de François Méjan, de Jean Kerlevéo, de Jean Latreille, de Louis de Naurois, de Jean Imbert, de Roland Drago, de Roland Minnerath, de Jean-Louis Tauran, de Jean Gaudemet, de André Damien, de Jean Foyer, de Jean Tulard, de Bernard Stasi, de Jean-Louis Debré, de Jean Baubérot, d’Emile Poulat, de Jean-Paul Willaime, de Philippe Gaudin, de Francis Messner, de Brigitte Basdevant-Gaudemet, de Franck Roumy, de Jean-Louis Bianco, de Yves Gaudemet, de Daniel Moulinet , de Blandine Chélini-Pont, d’Emmanuel Tawil, de Jean-Pierre Machelon, de Philippe Portier, de Philipe Greiner, de Olivier Echappé, de Anne Violaine-Hardel, de Laurence Baghestani, etc.
2 www.jeanjacques-boildieu.fr/JPD/
3 Droit local français des cultes et congrégations religieuses d’Alsace-Morelle, lui-même composite ; Droit de la Séparation issue des lois de 1905 et 1907 , et concernant - par l’article 8 de la loi du 9 décembre 1905 - le droit français des congrégations religieuses ; Droit particulier français des culte et des congrégations religieuses en Guyane ; Droit particulier français des cultes et des congrégations religieuses à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Droit particulier français des cultes et des congrégations religieuses à Tahiti ; Droit particulier français des cultes et des congrégations religieuses à Mayotte ; Droit particulier français des cultes et congrégations religieuses en Nouvelle Calédonie ; Droit particulier français des culte et éventuelles congrégations religieuses pour les possessions françaises en Arctique et en Antarctique .
4 Guillaume Drago et Emmanuel Tawil (Dir.), France & Saint-Siège. Accords diplomatiques en vigueur, Préface de Mgr Roland Minnerath, collection Droit canonique. Droit international de la liberté religieuse et de religion, (Cerf/Patrimoines), avec le concours de l’Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique, Paris, Cerf, 2017, 181 p. ; Emmanuel Tawil (Ed.), Recueils des accords en vigueur entre la France et le Saint-Siège, Préface d’Alain Dejammet, collection Droit canonique, droit international de la liberté religieuse et de religion, (Cerf/Patrimoines), Paris, Cerf, 2017, 280 p.
5 Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris et Faculté de Droit Jean Monnet de l’Université Paris Sud, Paris Saclay.
6 Voir la Communication de Mademoiselle Anne-Violaine Hardel dans le présent dossier de la Revue ökonomia.
7 Signes religieux et ordre public, Paris, Cerf, p. 242.
8 Tempête sur la laïcité , Paris, Ed. Laffond.
9 La nouvelle question laïque , Paris, Ed. Flammarion.
10 Adrian Loretan, Félix Wilfred (Eds), Revision of the Codes. An Indian-European Dialogue, Zurich, Lit Verlag, 2018, 317 p.
11 Laurence Baghestani, « Le principe de laïcité, une invention française ignorée », in Petites affiches,N°52, 13 mars 2019, p. 15-21.
12 A. Jeauneau, L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2019, 450 p.
 IT
IT  EN
EN 











