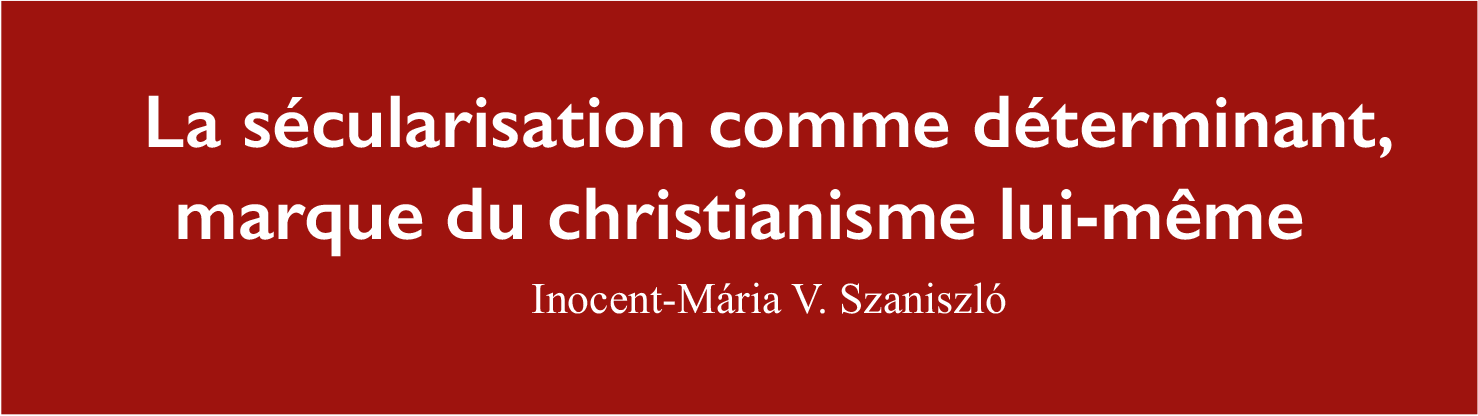
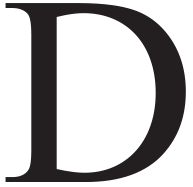 ans le cadre de notre colloque international à l’occasion de 60° anniversaire du discours du Pape Pie XII (le 23 mars 1958) sous le titre « Légitimité et saine laïcité de l’Etat » qui a eu lieu à l’Université pontificale Saint Thomas d’Aquin (Angelicum) à Rome le 6 décembre 2018, avec la collaboration de l’Agence
ans le cadre de notre colloque international à l’occasion de 60° anniversaire du discours du Pape Pie XII (le 23 mars 1958) sous le titre « Légitimité et saine laïcité de l’Etat » qui a eu lieu à l’Université pontificale Saint Thomas d’Aquin (Angelicum) à Rome le 6 décembre 2018, avec la collaboration de l’Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique (AIDOP) et du Centre d’études du Saulchoir de Paris, nous avons travaillé sur le thème de la relation entre l’Église et l’État, que nous pouvons appeler sécularité ou laïcité. Même si notre société post-chrétienne utilise souvent un autre mot, celui de sécularisation, il n’est pas toujours facile de bien comprendre de quoi il s’agit.
Internationale Diplomatie et Opinion Publique (AIDOP) et du Centre d’études du Saulchoir de Paris, nous avons travaillé sur le thème de la relation entre l’Église et l’État, que nous pouvons appeler sécularité ou laïcité. Même si notre société post-chrétienne utilise souvent un autre mot, celui de sécularisation, il n’est pas toujours facile de bien comprendre de quoi il s’agit.
Qu’est-ce donc réellement que la sécularisation?
Depuis la Révolution de velours, nous entendons de nombreux représentants de l’église sur le territoire de l’Europe centrale parler de « la malédiction de la sécularisation », de « la menace de la sécularisation » ou même de « la laïcisation rampante » et ainsi de suite. Dans la plupart des cas, les définitions suivantes sont applicables : il s’agit de déchristianisation de notre société, respectivement de perte de la foi ou d’abandon progressif de la position de la foi ou du détournement des choses célestes pour des choses terrestres (par ex. la fermeture de monastères et leur transfert à des fins laïques) ou du début de l’indifférentisme religieux et de l’ouverture à l’athéisme de facto. Toutes ces idées supposent que l’Évangile ne pourrait s’exprimer que dans des « environnements » entièrement religieux, que les modes de vie du monde séculier seraient contre l’efficacité de l’Evangile et qu’il serait nécessaire de les surmonter ou encore que la modernité fondée sur la supposée « distance de Dieu » aurait été marquée par la pourriture et l’indifférence en matière de religion.
Une autre définition (il est intéressant de savoir comment ce thème résonne dans des périodiques catholiques très conservateurs comme l’autrichien: www.kath.net et le tchèque: Monitor) parle d’un processus de perte d’influence de la religion sur le développement de la société étatique. Il s’agit du processus graduel de profanation du sacré (mais dans la compréhension de la religion dans un sens large, comme la religion implicite, il ne s’agit pas de perte, mais d’autres formes moins visibles de religion).1 Mais il s’agit aussi d’un regard sur la croissance de la liberté individuelle grâce au déplacement de la religion vers la sphère privée (ici on court le risque d’une société injuste et d’une non-installation de la paix dans le monde, en aidant ainsi l’ennemi de la liberté – Benoît XVI, Message pour la Journée mondiale de la Paix 2011).2 Et bien sûr notre milieu conservateur, comme par exemple le professeur Sousedík de Prague en parlant de Lessing, Kant, Hegel, Marx, comme aussi d’autres milieux conservateurs parlent d’une nouvelle interprétation des vérités de la foi qui retire à l’homme son sens vers la vie éternelle.3
D’autre part les défenseurs de la sécularisation positive, et, parmi eux, beaucoup de théologiens rarement cités dans l’Église parlent de:
- bénéfices de la sécularisation pour la religion (prof. Vittorio Hösle de l’Université catholique de Notre Dame, South Bend, Indiana, États-Unis)4
- la nécessité de la sécularisation (méthodes d’organisation de l’espace publique – Amir Taheri et Claudio Monge, OP, prieur de la communauté des frères dominicains à Istanbul)5
- fondements bibliques de la sécularisation et de la sécularité (la mission autonome des choses du monde et la nécessité de la respecter), qui a sa place seulement dans le christianisme – la question ne se pose pas dans les autres religions (cardinal Dominik Jaroslav Duka OP de Prague à Berlin en octobre 2010).6
Le professeur Höffe dans son almanach « Religion im säkularen Europa » utilise aussi le terme « sécularisation » dans le sens de « mondialisation », « laïcisation », voire « déchristianisation », et écrit que ce sens remonte loin dans l’histoire, au moins à la querelle des investitures entre l’empereur et le pape, et concerne à l’époque, dans les années 1057 à 1122, l’autonomie du pouvoir séculier, la « sécularité du politique ». Mais il va même plus loin et affirme que la sécularisation remonte au Nouveau Testament de sorte que la sécularisation n’est pas nécessairement un phénomène de détournement du christianisme. La sécularisation est aussi une marque de détermination, une marque du christianisme lui-même, selon deux paroles bibliques : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21), et « Mon royaume n’est pas de ce monde » (Jean 18, 36).7 Enfin, ajoute Höffe, le sociologue de la religion Larry Shiner a proposé de distinguer cinq significations. D’après lui, la sécularisation signifie : la disparition des religions ; une adaptation mondiale ; une désacralisation du monde ; la libération de la société des religions et finalement une transposition, le transfert des croyances et des comportements de la sphère religieuse à la sphère laïque.8 D’ailleurs, continue Höffe, au XIXe siècle la sécularisation signifiait le rejet de la doctrine des deux royaumes représentée par saint Augustin et reprise dans le passage cité de Jean, à savoir le dépassement de l’opposition entre l’éternité de l’autre côté et le monde de ce côté. Enfin, il soutient la thèse de Max Weber selon laquelle la société européenne-occidentale est passée par un processus de sécularisation dans lequel le désenchantement du monde se combine à une domination de plus en plus rationnelle du monde devenu significative.9
Dans sa conférence pour le cercle d’Innsbruck présenté en janvier 2018 sous le titre « L’éthique sociale et la postsécularité », le professeur Hansjörg Schmid du Centre suisse pour l’Islam et la société de l’Université de Fribourg en Suisse montre dans son analyse que la sécularité n’est pas un privilège chrétienn en citant les auteurs musulmans Azzam Tamimi et Bassam Tibi qui plaident pour une postsécularité comme un défi pour l’éthique interreligieuse.10
Néanmoins, nous avons aussi un représentant sous l’angle de vue direct de la christianité, Martin Rhonheimer, professeur émérite d’Université Santa Croce du mouvement Opus Dei à Rome qui parle précisément de la sécularité chrétienne.11 Il est rejoint par le professeur Foerst de Regensburg en Allemagne qui montre une sécularité théologiquement légitime12, celle de l’acceptation de ce monde comme un domaine d’existence en raison de sa propre indépendance et de la raison d’être des réalités mondiales et profanes selon le document final du conseil de Vatican II dans la constitution Gaudium et Spes: « parce que leur légitimité ne devrait pas compter sur la religion, mais sur leurs propres structures, à savoir ‘d’être ce qu’ils sont’ ».13 En effet, Dieu a créé aussi le monde profane – donc il n’y n’a pas ici la décadence, mais quelque chose en fait propre à l’être dans ce monde de l’homme moderne. Cependant, si la société séculière est a priori considérée comme « éloignée » de Dieu, voire même lieu « sans Dieu », alors cette interprétation nous mène à la position athéiste parce qu’elle nie la capacité de l’Evangile à se développer dans le monde. Mais encore, si le relativisme est interprété comme une conséquence du sécularisme, qui se concentre sur le détournement de l’homme moderne de sa relation fondamentale avec Dieu et crée ainsi le « désert intérieur » comme le montre l’interprétation de Benoît XVI en établissant le dicastère pour la nouvelle évangélisation sous la direction de l’archevêque Mgr. Fisichella14, nous en arrivons alors à lutter contre lui. D’autre part, précisément la sécularisation, même si elle conteste la tradition établie de longue date, libère de grandes forces créatrices et est, finalement, aussi une piété vivante comme le montre le prof. Hösle à l’Académie autrichienne des sciences en février 2014.15
De cette première analyse nous vient à l’esprit aussi l’ambiguïté de la sécularisation. Cela surgit exactement de la recherche des savants turcs qui distinguent entre :
- la sécularité assertive (confiante) du type français – la laïcité (introduite par Atatürk et ses disciples). Cela confère à l’Etat le rôle de protéger les gens de la religion.
- la sécularité passive de type américain. Cela garantit que chaque citoyen peut apporter quelque chose, indépendamment de la religion, et sans exclure la motivation religieuse et la perspective du marché des idées. (Mustafa Gokcek dans son livre L’unité de la Turquie découle de la laïcité).16
La sécularisation positive selon Gibellini parle de la désacralisation. Il s’agit d’un processus relatif ou radical de formation des idées chrétiennes dans la société moderne comme un moment de continuité. La désacralisation relative que nous trouvons déjà dans la création où le Créateur lui-même diffère fortement de la création (contre le panthéisme, le monisme et l’animisme). Cela limite l’influence excessive de la religion sur le monde profane et pousse chaque partie de la société (y compris l’Eglise) à chercher sa propre place dans le monde. Enfin, comme le dit B. Häring, il s’agit aussi de la lutte contre les dieux : le christianisme a sécularisé ce monde et l’a libéré de la fausse sacralisation.17 Au contraire la sécularisation radicale bâtit le monde sans le sacré.
La sécularisation comme divinisation nous montre que l’homme séparé de Dieu finit par absolutiser et idéaliser la réalité séculière, et donc la divinise de façon inappropriée (la sacralise). Anselm Günthör poursuit en disant ue que le sécularisme absolu lié à une autonomie absolue du monde passe sous silence la nécessité du salut, la rédemption et la réalité du péché et favorise l’idée que l’homme pourrait se sauver par lui-même (en ignorant le mal et celui qui en est la cause). Une telle validation de l’homme par lui-même est utopique et inhumaine. L’homme ignore ses origines comme la création de Dieu et sa dépendance à l’égard de la volonté de Dieu. Au contraire, la question est de savoir si l’homme concentré sur Dieu et reconnaissant la souveraineté de Dieu est capable de donner aux domaines humaines leur propre autorité. Une telle personne est-elle en mesure d’avoir une relation pratique avec le monde, ou au contraire, est-elle complètement aliénée de ce monde ?18
A la recherche de la définition en faveur du christianisme
Une des définition trouvée dans le cadre de la théologie morale nous enseigne que le sécularisme est une forme extrême de sécularisation, lorsqu’une personne a besoin, pour elle-même et pour « son » indépendance totale, du monde et de l’autonomie à l’égard de Dieu, voire même de nier l’existence de Dieu directement, afin de prouver son indépendance. Ceci diffère de l’athéisme. Il s’agit plutôt de l’échec de permettre à un autre monde d’exister. Cette direction n’a donc pas reconnu que la foi (la religion ou l’église) avait quelque chose à dire sur les questions fondamentales de la vie. En éthique, en économie, dans la culture et la politique on exige l’autonomie, mais la religion est déplacée dans la région hors du monde. Mais Gogarten ajoute que le sécularisme ne reste pas seulement dans la sécularité à la suite de la sécularisation, mais il devient souvent doctrine du salut ou idéologie.19 Cependant, une personne est (théologiquement, selon le premier commandement) obligée de suivre le vrai Dieu, en dépit de sa propre autonomie.
Kaľata nous montre encore un fois que la sécularisation a son fondement dans la Bible et le monde chrétien.20 Le Saeculum (l’âge humain, la race, la génération, l’âge, le temps, le siècle, la précocité, la naturalité, la mondanité) désigne le monde dans le temps historique (aeon) au lieu du monde de l’espace mundus (cosmos). Pour les Grecs il s’agit toujours de l’espace, d’un lieu, mais pour les Hébreux le monde est l’histoire (l’histoire dans le temps), qui a son origine en Dieu. L’américain Cox a souligné les enjeux en ajoutant qu’il est important de noter que le christianisme a démythifié l’Empire romain! Les dieux y jouaient le rôle d’une certaine magie pour réaliser l’unité entre l’homme et la nature, et les deux ont été une partie de la nature.21 Le Cosmos grec (l’espace et dieu, et même la Société) est déifié. L’espace hébreu est la création de Dieu. Le monde est devenu l’histoire. Cosmos aeonom et mundus saeculum. L’approche biblique pour comprendre le monde nous montre la compréhension du monde comme une entité limitée dans le temps.22
Mráz montre les trois sources de la sécularisation chrétienne, qui sont : la transition de la façon de penser grecque à la façon judaïque (biblique), la transition de l’essentiel au fonctionnel dans la vision du monde et la transition du supranaturalisme à l’autonomisation de la vie. Ce sont les trois éléments clé de la foi basés sur la Bible pour l’expansion de la sécularisation. Il s’agit d’un processus de la renaissance de la relation à Dieu, à l’homme et au monde, et qui apporte le développement de la science naturelle, la montée des institutions démocratiques et l’expansion du pluralisme culturel. Cela se fait par la dédivinisation de la nature dans le processus de la Création, puis par la désacralisation de la politique par rapport à l’Exode et finalement par la déconsécration des valeurs avec l’adoption de la loi sur le mont Sinaï, en particulier la loi concernant l’idolâtrie.23
Les temps idéologiques e la sécularisation positive
Gellner remarque que les Lumières ont enseigné que l’homme devient homme par la raison humaine et qu’il est donc possible de séculariser la vision religieuse selon laquelle l’homme devient homme par sa relation au Dieu unique.24
Plus tard, dans son analyse de l’islam moderne et du marxisme, Gellner soutient que l’islam moderne ne divinise pas le monde terrestre, mais le sujet du respect dans l’islam reste une entité extraterrestre et transcendante. Bien que la vie dans ce monde (terrestre) soit soumise à de vastes frontières, elle conserve toujours son statut terrestre profane. Les sphères sacrées et profanes restent séparées, selon la théorie de Durkheim, et ne se souillent pas mutuellement. Ce n’est pas seulement que la sphère divine est un refuge devant le monde terrestre. Le monde terrestre est aussi un refuge pour les demandes excessives et l’exaltation de la religion (c’est, dans notre contexte, l’hypothèse disproportionnée de l’action de Dieu). Selon Gellner, l’Islam contrôle et réglemente, mais malgré tout cela, ne condamne pas la vie quotidienne et sa composante économique.
Pour le marxisme, cependant, le cas est radicalement différent. Selon Gellner, il s’agit ici d’une erreur philosophique décisive. L’idée philosophique centrale du marxisme était d’abolir la multiplicité de l’existence sur le monde terrestre et surnaturel. Ainsi, le marxisme a non seulement interdit l’utilisation du monde de l’au-delà comme source de salut, dans le but de s’échapper de ce monde, mais aussi – et cela est lui devenu fatal – le respect de soi du monde terrestre et de l’activité humaine qui l’entoure.25
Gellner note que ce n’est pas accidentellement que le pedigree intellectuel du marxisme conduit, par l’intermédiaire de Hegel, au panthéisme de Baruch Spinoza et de son sens de l’unité et du caractère sacré de ce monde. Ainsi, il est fort possible que le bolchevisme n’ait pas causé le manque de sacré, mais au contraire le manque de profane. Si, en période de stagnation économique, la sphère profane, dans les circonstances habituelles, perdait son intérêt, il était impossible de la rejeter et de lui donner un caractère de routine car c’était la maison la plus sacrée du sacré. Le travail était en fait l’essence de l’homme et le « sacrement du nouvel ordre ». Mais quand il s’est avéré que ce « sacrement » était extrêmement pollué, comme à l’époque de Brejnev, la foi doit s’y perdre. Elle pouvait survivre à la pollution du temps de Staline, quand elle s’était même épanouie, mais elle ne pouvait être que « blasphème » contre l’existence économique.26
Au XIXe siècle, des affirmations séculières mondiales ont été enregistrées afin d’obtenir des instructions religieuses pour agir contre eux.27 Les sermons piétistes sur les inondations catastrophiques en sont un exemple. S’ils étaient encore interprétés eschatologiquement au début du XVIIIe siècle, ils deviennent au début du XIXe siècle une punition de Dieu, qui nous appelle à ne pas nous abandonner à la « suprématie de la raison », au « rationalisme ».28
L’autonomie relative comme solution
Quand nous cherchons à nous rapprocher de la sécularisation chrétienne, nous pouvons nous poser quelques questions: par ex., comment est-il possible de résoudre les problèmes de l’impératif de Dieu dans le premier commandement et dans l’autonomie de l’homme comme un signe du don du Créateur et de la confiance de Dieu en l’homme ? Si nous parlons de la sécularisation, nous nous déplaçons entre: Dieu et le monde, ce monde et l’autre monde, la science et la religion, l’abandon à Dieu et le service au monde, l’Église et l’État et enfin la culture (art sacral) et l’esthétique. La question suivante à se poser est de savoir si l’autonomie appartient réellement aux domaines mondiaux ? Une réponse très importante est que le monde séculier écoute ses propres lois, qui ne sont pas soumises à des normes de foi et de religion. Néanmoins, il n’est pas vrai que l’homme n’avait aucune responsabilité pour utiliser la réalité mondaine en conjonction avec le plan de son Créateur. C’est parce que ni l’homme séculier, ni même le monde séculier ne se sont créés par eux-mêmes, leur existence dépend entièrement de la volonté d’un être supérieur – c’est pourquoi on parle d’autonomie relative.29 J.-B.Metz ajoute que les facteurs séculiers incluent une certaine indépendance ; ils sont régis par leurs propres lois, mais ils ont leur origine en Dieu. En utilisant le processus de la sécularisation de Dieu (Dieu incarné en Jésus pour le monde terrestre) l’homme se libère de l’omnipotence des éléments de ce monde (Kol 2,8.20; Gal 4,3, 1 Corinthiens 8: 4). C’est le fondement de l’humanisme compris chrétiennement.30
Vattimo explique au contraire que l’être chrétien kénotique renvoie à Dieu qui se tient au milieu, mais renonce sciemment à son omnipotence et devient un homme (un frère et ami).31 La libération humaine est donc importante, parce que, comme ajoute Barth, dans la recherche et les retrouvailles avec Dieu, l’homme est capable d’utiliser Dieu pour ses propres fins.32 Il s’agit ici de l’évaluation correcte des réalités séculières : celles-ci conserveront une autonomie réelle et la mondanité dans la mesure où elles ont leurs propres buts, leurs lois, leurs méthodes et leurs significations pour le bien de l’homme. Mais seul l’homme dirigé vers Dieu est capable d’agir de manière objective, à savoir de gérer les choses de ce monde en accord avec leur autonomie guidée par des lois morales.
Le conservatisme strict et fermé aimerait toutefois voir le monde organisé sous la domination de l’Église comme leader unique du monde. Mais l’Eglise n’est pas appelée à diriger le monde d’une manière conservatrice, tout simplement parce qu’elle n’est pas en mesure d’identifier toutes les solutions spécifiques de tous les problèmes de ce monde. Voilà pourquoi nous devons respecter une certaine autonomie des domaines du monde (Chenu, Rahner).33 Alors d’une part il est important de reconnaître les signes des temps actuels. D’autre part, nous aimerions avoir toutes les chances d’avoir une ligne téléphonique directe avec Dieu (raz de marée en Thaïlande et les sermons ultérieurs sur la colère de Dieu). La sécularisation ne signifie pas pour autant la sécularisation des valeurs religieuses, mais elle les reconnaît en raison de la foi, de l’indépendance et de la signification du monde lui-même.34
Le rôle de l’Église dans le monde
La tâche fondamentale de l’Eglise est de pénétrer le monde avec l’esprit de l’Evangile sans le diviser dans sa propre structure. Comme avait bien remarqué le cardinal Marx de Bavière en commentant les scandales sexuels dans l’Eglise, L’Eglise n’est pas ici pour prendre un rôle moralisateur, mais pour prêcher l’évangile.35 Et un autre homme d’Eglise, Mgr. Fazio explique la nécessité de la décléricalisation du monde. Le faux cléricalisme ne distingue pas entre les ordres naturel et surnaturel, les pouvoirs politique et spirituel.36 La doctrine de la création (le pilier principal du christianisme) est la base pour une bonne compréhension de la sécularisation: Dieu a donné à l’homme la possibilité de connaître la structure de la réalité. L’harmonie entre la foi et la raison conduit à respecter l’autonomie relative des réalités terrestres. Dans beaucoup de religions règne un scepticisme quant à la capacité de l’homme. Le fondamentalisme même empêche la sécularisation par le totalitarisme religieux qui viole les droits fondamentaux de l’homme.37
Vattimo revient sur ce point avec sa théorie de la sécularisation comme expérience confessionnelle authentique. Selon lui, la sécularisation est un moment positif d’enseignement de Jésus-Christ et la réalité intérieure du christianisme : comme Jésus abandonné sur la croix, l’homme moderne ressent l’aliénation de Dieu, et il s’aliène parfois de Dieu lui-même. L’homme aliéné de Dieu absolutise et idéalise la réalité séculière – donc la sacralise de façon inappropriée. Pour une bonne relation au monde, une relation juste à Dieu est nécessaire.38 Et Rhonheimer ajoute que la mondanité n’a sa place que dans le christianisme. Cela signifie l’importance du monde et du service pour le monde, son autonomie et l’indépendance, mais aussi le devoir de tout chrétien de s’engager dans le monde39. Dans le mystère de l’Incarnation la sécularisation prend sa pleine signification et son propre but. La sécularisation donc défend la réalité terrestre. Si elle est détruite, remarque le cardinal Duka, alors seront libérés les courants qui suppriment complètement notre autonomie terrestre.40
Comme l’enseigne Gogarten, la sécularisation (dédivinisation) est une conséquence légitime de l’impact de la foi biblique sur l’histoire.41 L’homme en tant que Fils de Dieu est libéré du monde, mais aussi pour le monde. La foi chrétienne sécularise le monde et l’amène à l’autonomie, mais aussi vers la responsabilité de l’homme (celui-ci est appelé à l’adoption d’enfant de Dieu et donc à la responsabilité envers Dieu: 1 Cor 3, 21 à 23). Une société qui n‘est pas passée par la sécularisation peut être caractérisée par un lien étroit entre la politique et la religion (Matthieu 22, 21). L’espoir du monde moderne est que l’homme ne perde pas le contact avec Dieu afin que la sécularisation ne dégénère pas en sécularisme. Du point de vue du Royaume de Dieu la sécularisation signifie à peu près autant que ce qui est faisable. Ceci est réalisé de telle sorte que l’homme soumet ce monde pour ses propres buts et empêche le mal d’agir.42
L’unique élément critique réglementaire de la sécularisation, selon Vattimo, est qu’il s’agit ici de l’amour dont la croissance montre de quelle façon la sécularisation est la réalité religieuse authentique (avec l’amitié, la tolérance, l’estime, le respect des autres, du pluralisme et de la démocratie). Ce principe critique permet de combler le fossé entre la modernité et la proclamation chrétienne. Ce principe démasque exactement dans la personne de Jésus Christ les nouveaux mythes. Le Christ révèle ainsi « le vrai sens de l’histoire du salut. » L’homme croyant ne peut croire que par le dialogue. Alors que le contraire aime le fondamentalisme et le dogmatisme. Un tel croyant ne croit pas à un Dieu somptueux autoritaire, mais à un Dieu dialogique, fraternel et amical – partenaire, alors seulement il est capable de chercher humblement le royaume de Dieu et son accomplissement et de prendre part à l’histoire du salut et à la proclamation de l’Évangile. Dans ce dialogue le Christianisme postmoderne construit l’éthique du dialogue et de la solidarité. Croire à sa propre foi signifie l’espoir d’avoir une foi authentique.43 C’est pourquoi ce terme de la sécularisation chrétienne est un déterminant, une marque du christianisme lui-même. La seule chose à éviter est de ne pas aller trop loin dans la direction terrestre, celle de la théologie politique désignée par Carl Schmidt, Bultmann, Löwith jusqu’au Gogarten, mais ce sera l’objet d’un prochain article.44
Répertoire bibliographique
Barth, Karl (1992) : Der Römerbrief. In : Gibellini, Rosino (sous la dir. de) : La teologia del XX secolo. Brescia : Editrice Queriniana, 16-18.
Benoît XVI (2011), Message pour la Journée mondiale de la Paix 2011. In : http://w2.vatican.va .
Duka, Dominik (2010): Náboženství v sekularizované společnosti. Dans: http://www.dominikduka.cz (5 juin 2013).
Fazio, Marianno (2007) : Crisis of the truth about man (Ndt : Crise de la vérité sur l’homme). In : Zenit, 7 février 2007 (http://www.zenit.org [5 juin 2013]).
Fischer, Karsten (2009): Die Zukunft einer Provokation. Religion im liberalen Staat. Berlin University Press. 2009.
Höffe, Ottfried (2018) : Religion in säkularen Europa : Einführung. In: Ottfried Höffe/Andreas Kablitz (Hrsg.): Religion im säkularen Europa. Politisches Projekt und kulturelle Tradition – Schriftenreihe des Arbeitskreises Europa der Fritz Thyssen Stiftung, Band 4, Paderborn, Verlag Wilhelm Fink, 7-17.
Hösle, V. (2014): « Religionen profitieren von Säkularisierung. » In : www.kath.net de 21 fevrier 2014.
Gellner, Ernest (2003) : Nacionalismus. Brno, CDK.
Gibellini, Rosino (1992) : La teologia del XX secolo. Brescia : Queriniana Editrice.
Gogarten, Friedrich (1965) : Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit (Ndt : Désastre et espoir des temps modernes). Die Säkularisierung als theologisches Problem (Ndt : La sécularisation en tant que problème théologique). In: Cox, Harvey (Hg.): The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective. New York: The Macmillan Company, 12–30.
Gogarten, Friedrich (1972): Destino e speranza dell’epoca moderna. Brescia: Morcelliana.
Günthör, Anselm (1988): Chiamata e Riposta. Una nuova teologia morale, vol. II: Morale speciale. Alba: Edizioni Paoline.
Kaľata, Dominik (1992): Sekularizácia a kresťanský postoj k svetu. In: Svedectvo viery 2. Trnava, Dobrá kniha.
Marramao, Giacomo (1999): Die Säkularisierung der westlichen Welt. Frankfurt/M. 1999.
Wirsching, Daniel/Knoller, Alois: Kardinal Marx, empfinden Sie die "Ehe für alle" als Niederlage? In: https://www.augsburger-allgemeine.de
Mráz, Marian SJ (2004): Sekularizácia je nielen ohrozením ale aj znakom nádeje. In: http://www.uski.sk
Rahner, Karl / Vorgrimler, Herbert (1961): Kleines Theologisches Wörterbuch. Freiburg i. Br.: Herder.
Rhonheimer, Martin (2010): Christian Secularity, Political Ethics and the Culture of Human Rights. In: Josephinum Journal of Theology, 16, 320–338.
Schmid Hansjoerg.: https://www.youtube.com ;
https://www.kaththeol.uni-muenchen.de
Schwibach Armin (2010): Gegen die innere Wüste. In: www.kath.net
Shiner, Larry (1967): The Concept of Secularization in Empirical Research, In: Journal for the Scientific Study of Religion 6/2, 207-220.
Sousedík Stanislav (2011): Svět, světskost, sekularizace. In: Res claritatis Monitor, 17. 4.2011 (https://rcmonitor.cz ).
Swan, Michael (2013): Turkey´s unity rooted in secularism. In: The Catholic Register, Sunday 15 December 2013.
Vatican II, Concil (1965) : Gaudium et spes (GS). Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps.
Vattimo, Gianni (1996): Credere di credere. Milano: Garzanti.
NOTES
1 Sousedík, S. (2011), 11.
2 Benoît XVI. (2011).
3 Sousedík, S. (2011), 11-12.
4 Hösle, V. (2014).
5 Swan, M. (2013).
6 Duka, D. (2010).
7 Höffe, O. (2018), 15.
8 Shiner, L. (1967), 207-220.
9 Höffe, O. (2018), 16.
10 Schmid, H. (2018), slide 2-3.
11 Rhonheimer, M. (2010).
12 Schwibach, A. (2010).
13 GS (1965), 36.
14 Fischer, K. (2009), 193.
15 Hösle, V. (2014), 11-12.
16 Swan, M. (2013).
17 Gibellini, R. (1999), 113.
18 Günthör, A. (1990), 42.
19 Gogarten, F. (1965), 15.
20 Kaľata, D. (1992), 390.
21 Cox, H. (1965), 19.
22 Kaľata, D. (1992), 390.
23 Mráz, M. (2004).
24 Gellner, E. (2003), 91.
25 Gellner, E. (2003), 108.
26 Gellner, E. (2003), 109.
27 Árnason, J.P./Wittrock, B. (2012).
28 Manfred Jakubowski-Tiessen (2013), 187.
29 Gibellini, R. (1999), 136.
30 Kaľata, D. (1992), 392-3.
31 Vattimo, G. (1996), 14.
32 Barth, K. (1999), 16.
33 Gibellini, R. (1999), 136.
34 Rahner, K. / Vorgrimler, H. (1996), 299.
35 Wirsching, D./Knoller, A. (2017).
36 Fazio, M. (2007).
37 Fazio, M. (2007).
38 Vattimo, G. (1996), 9-10.
39 Rhonheimer, M. (2010), 322.
40 Gogarten, F. (1965), 15.
41 Cox, H. (1965), 23.
42 Rhonheimer, M (2010), 331.
43 Vattimo, G. (1996), 95.
44 Marramao (1999), s. 88.
 IT
IT  EN
EN 











