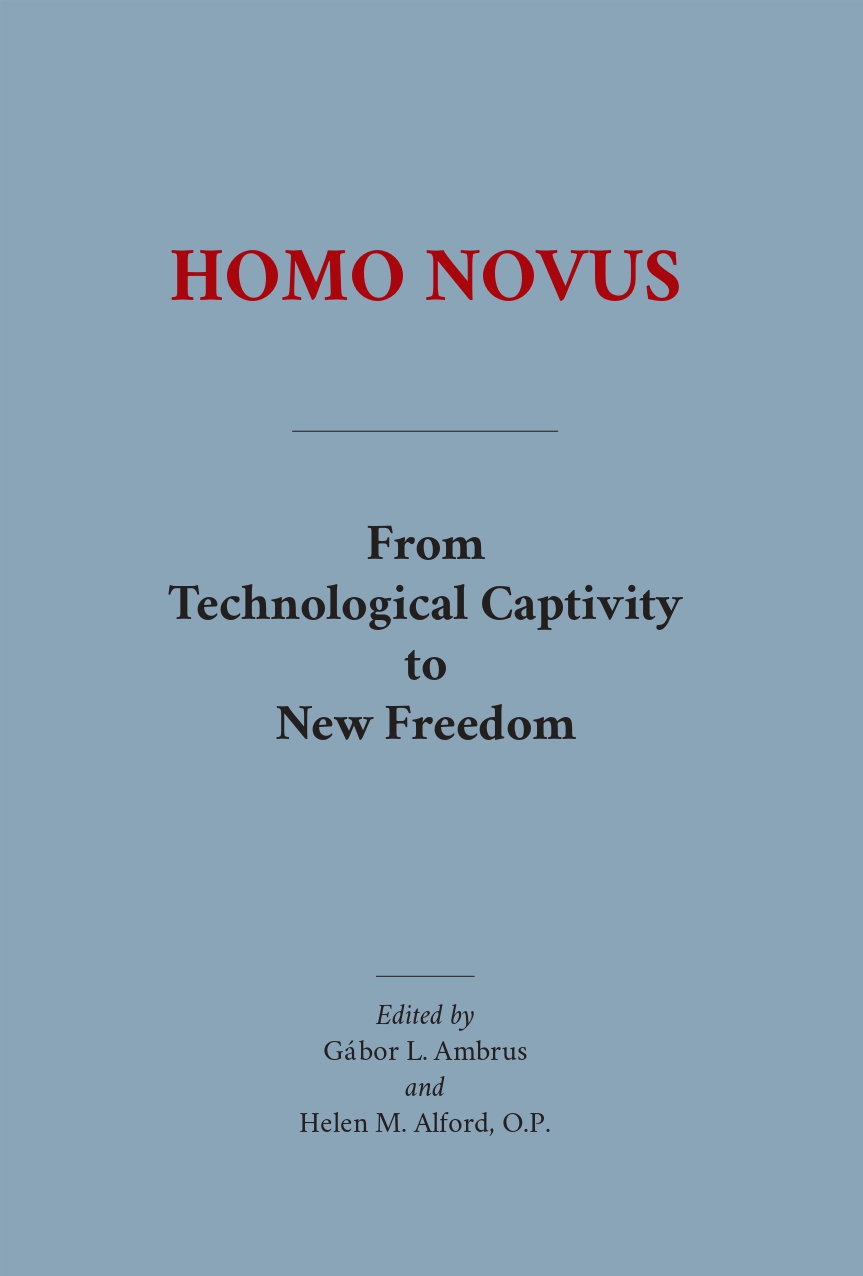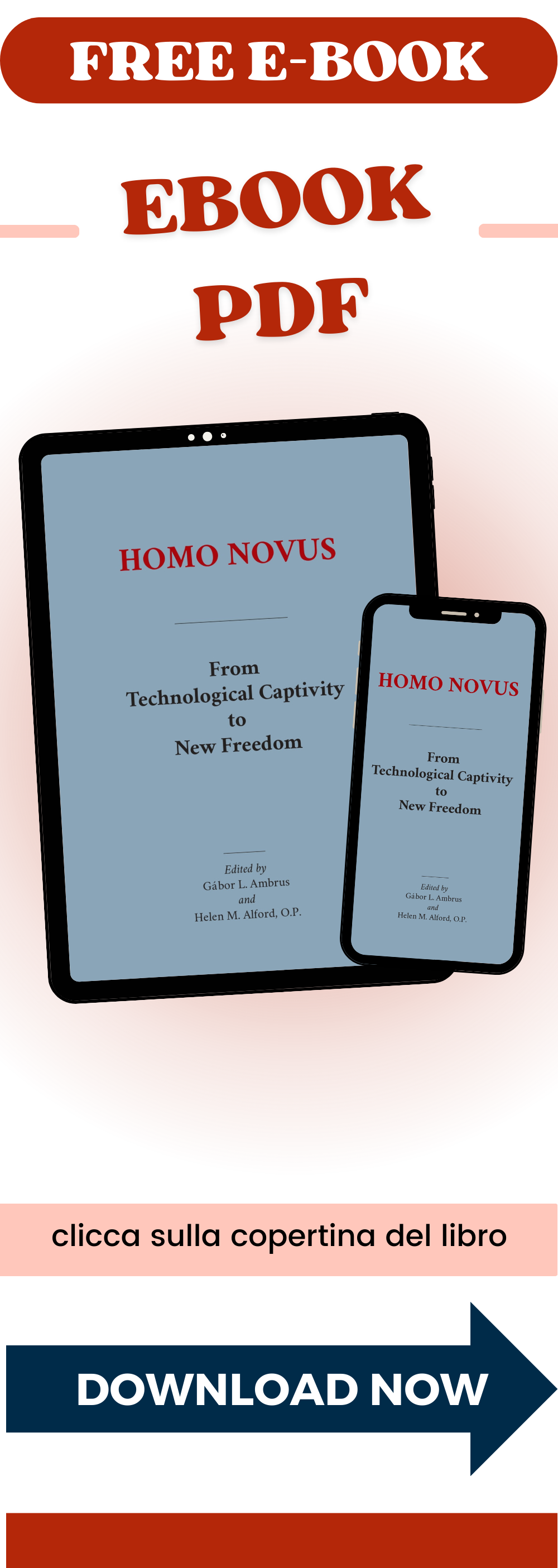Légitimité et nature du discours ecclésial dans le temporel

 n ce temps de crise politique, économique et sociale, la voix de l’Église Catholique peut-elle être de quelque utilité pour aider notre pays et notamment les acteurs du monde politique et de la société civile ? Dans le contexte français d’une stricte séparation de l’Église et de l’État, toute parole confessionnelle en matière politique et sociale peut rapidement être considérée comme illégitime2. Le religieux n’a pas à se mêler de la marche du pays. Son domaine est celui de la sphère privée. Si l’Église doit exercer un pouvoir, il ne peut être que spirituel et son champ d’exercice se restreint à la communauté des croyants. L’Église Catholique en est bien consciente. En effet, comme elle le rappelle dans le Catéchisme (CEC): « Il n’appartient pas aux pasteurs de l’Église d’intervenir directement dans la construction politique et dans l’organisation de la vie sociale » (CEC 2442). A qui incombe cette tâche ? L’action directe dans l’ordre politique et sociale est la mission spécifique des fidèles laïcs et plus largement des citoyens. Si l’Église se refuse à intervenir directement par respect de la distinction et de l’autonomie des ordres, elle ne s’interdit pas toute parole sur la « chose publique ». Lorsqu'elle intervient dans l’ordre temporel, c’est en vertu de son autorité morale, ce qui relève « d’une mission distincte de celles des autorités politiques » (CEC 2420). Elle propose alors un jugement moral sur les réalités politiques et sociales et plus largement un enseignement inspiré de la révélation chrétienne mais aussi de la sagesse humaine. Cette doctrine sociale de l’Église énonce un ensemble de considérations qui éclaire l’origine et la nature de nos sociétés et qui fournit aussi des principes de discernement pour ceux qui ont à œuvrer dans la bonne marche de la communauté humaine. L’Église « s’efforce [simplement, pour ainsi dire] d’inspirer les attitudes justes dans le rapport aux biens terrestres et dans les relations socio-économiques » (CEC 2420).
n ce temps de crise politique, économique et sociale, la voix de l’Église Catholique peut-elle être de quelque utilité pour aider notre pays et notamment les acteurs du monde politique et de la société civile ? Dans le contexte français d’une stricte séparation de l’Église et de l’État, toute parole confessionnelle en matière politique et sociale peut rapidement être considérée comme illégitime2. Le religieux n’a pas à se mêler de la marche du pays. Son domaine est celui de la sphère privée. Si l’Église doit exercer un pouvoir, il ne peut être que spirituel et son champ d’exercice se restreint à la communauté des croyants. L’Église Catholique en est bien consciente. En effet, comme elle le rappelle dans le Catéchisme (CEC): « Il n’appartient pas aux pasteurs de l’Église d’intervenir directement dans la construction politique et dans l’organisation de la vie sociale » (CEC 2442). A qui incombe cette tâche ? L’action directe dans l’ordre politique et sociale est la mission spécifique des fidèles laïcs et plus largement des citoyens. Si l’Église se refuse à intervenir directement par respect de la distinction et de l’autonomie des ordres, elle ne s’interdit pas toute parole sur la « chose publique ». Lorsqu'elle intervient dans l’ordre temporel, c’est en vertu de son autorité morale, ce qui relève « d’une mission distincte de celles des autorités politiques » (CEC 2420). Elle propose alors un jugement moral sur les réalités politiques et sociales et plus largement un enseignement inspiré de la révélation chrétienne mais aussi de la sagesse humaine. Cette doctrine sociale de l’Église énonce un ensemble de considérations qui éclaire l’origine et la nature de nos sociétés et qui fournit aussi des principes de discernement pour ceux qui ont à œuvrer dans la bonne marche de la communauté humaine. L’Église « s’efforce [simplement, pour ainsi dire] d’inspirer les attitudes justes dans le rapport aux biens terrestres et dans les relations socio-économiques » (CEC 2420).
Mais en quoi des principes moraux peuvent-ils être utiles pour gouverner un pays ou faire fonctionner une entreprise ? On pourrait objecter que tout discours moral est inopérant en politique ou en économie. Ces domaines ne relèvent-ils pas non du registre de l’éthique mais de celui de la technique et donc de la science ? A cela, on peut répondre d’abord, avec le pape François dans Laudato si’ (LS), que « la politique ne doit pas se soumettre à l’économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au paradigme d’efficacité de la technocratie » (LS 189), ensuite avec Benoît XVI que « la sphère économique n’est pas, par nature, ni éthiquement neutre ni inhumaine et antisociale ». « Elle appartient, poursuit-il dans Caritas in veritate (CV), à l’activité de l’homme et, justement parce que humaine, elle doit être structurée et organisée institutionnellement de façon éthique. » (CV 36) L’économie et a fortiori la politique ne sont pas le fruit de forces « automatiques et impersonnelles » (CV 71), mais bien le fruit de décisions humaines. Ce sont des domaines qui font appel à la conscience morale et qui engagent la responsabilité personnelle et sociale de leurs acteurs. Ce sont des activités qui procèdent de libertés humaines et qui appartiennent de ce fait à la sphère morale.
Nécessité d’opter pour le bien commun dans le contexte actuel
L’économie et le politique ne peuvent donc pas revendiquer d’indépendance vis-à-vis de l’éthique, sous peine de devenir des réalités nonhumaines, voir inhumaines. Or, dans nos sociétés libérales force est de constater que le marché étend son hégémonie au point de soumettre les États à sa logique et en faire des instruments de son expansion. Dans ce contexte de soumission de la politique à la finance et d’un marché où tend à régner la seule loi du plus fort, les inégalités sociales augmentent. La crise « des gilets jaunes » est symptomatique de cette dégradation du corps social. Une partie de nos concitoyens n’a plus confiance dans ses élites qu’elle estime vendues aux intérêts du marché et jalouses de leur pouvoir. Nombreux sont ceux qui se sentent en marge du développement et se voient comme des citoyens de seconde zone. Comment sortir de ce système qui broie les hommes ?
Pour l’Église, la réponse ne peut se trouver que dans un sursaut moral. « Le développement, souligne Benoît XVI, est impossible, s’il n’y a pas des hommes droits, des acteurs économiques et des hommes politiques fortement interpellés dans leur conscience par le souci du bien commun. La compétence professionnelle et la cohérence morale sont nécessaire l’une et l’autre. Quand l’absolutisation de la technique prévaut, il y a confusion entre les fins et les moyens : pour l’homme d’affaires, le seul critère d’action sera le profit maximal de la production ; pour l’homme politique, le renforcement du pouvoir ; pour le scientifique, le résultat de ses découvertes. » (CV 71) Pour résister au « tout technique », il faut avoir le courage « d’opter de nouveau pour le bien et se régénérer » selon la formule de Laudato si’ (LS 205). Car en effet, pour initier des chemins de sortie de crise, il est nécessaire de réorienter les activités humaines non vers ce qui détruit l’homme et la société mais vers ce qui contribue à leur développement intégral, à savoir le bien humain. C’est par son « ouverture au bien, à la vérité et à la beauté » (LS 205), mais aussi par « l’exercice de la vie morale », c’est-à-dire la quête et la réalisation du bien, que la personne atteste sa dignité et perfectionne son humanité (CEC 1706). Dans l’ordre des réalités sociales, ce bien est appelé « bien commun ».
Cette notion est un des grands principes de la doctrine sociale de l’Église. Le bien commun est invoqué constamment dans le Magistère comme principe à double titre : premièrement, en tant que fin ou but des réalités sociales, à savoir la famille, l’entreprise, ou encore l’État et deuxièmement, en tant que critère régulateur ou normatif de ces mêmes réalités. C’est la recherche et la réalisation du bien commun qui donnent leur raison d’être à toutes les réalités humaines communautaires, si bien que « chaque communauté possède un bien commun qui lui permet se reconnaître en tant que telle » (CEC 1910). Et la bonté de leurs activités sera fonction de leur service du bien commun. En somme, « chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à des règles spécifiques » (CEC 1881). C’est en vertu de ce principe que l’Église peut porter un jugement moral sur la politique, l’économie ou la société civile. Ainsi, une bonne politique ou une bonne loi est celle qui sert le bien commun. Toute réalité sociale qui perd de vue son bien commun finit par nuire au progrès et au bonheur des personnes humaines qui la composent.
Résistances culturelles et idéologiques au bien commun
La recherche et la réalisation du bien commun est pour l’Église la voie par excellence pour obtenir des changements sociaux qui soient effectivement au service de la personne : « Toute société, digne de ce nom, peut s’estimer dans la vérité quand chacun de ses membres, grâce à sa capacité de connaître le bien, le poursuit pour lui-même et pour les autres. » (Compendium de la doctrine sociale de l’Église - CDS 150) Toutefois, un certain nombres de conditionnements culturels et idéologiques font perdre de vue aux hommes l’horizon du bien commun. Certes, comme le rappelle Laudato si’, « il n’y a pas système qui annulent complètement l’ouverture au bien » (LS 205), mais il n’en demeure pas moins que cela contribue à rendre inintelligible l’idée d’un bien commun.
La logique économique, tout d’abord, a contribué à refaçonner notre rapport à soi, aux autres et au monde. Il n’est pas excessif de dire que dans les sociétés libérales, l’être humain a été pour une part réduit à n’être qu’un instrument du marché, c’est-à-dire un producteur et un consommateur de biens matériels. La réduction des fonctions humaines à la seule consommation a produit une culture ou un style de vie consumériste qui « nourrit des formes d’égoïsmes collectif » et accroît la « voracité » (LS 204). Force est de constater que « la pure accumulation », sensée procurer le bien-être, ne réalise pas un « authentique bonheur humain » (CDS 334). Les relations sociales et même notre éco-système en pâtissent. Dans ce contexte, la conception du bien humain est rabaissée au seul bien-être qui tend à la satisfaction des besoins les plus primaires. Il devient alors difficile de formuler un idéal commun élevé. Si le « vivre ensemble » est invoqué constamment comme un mantra, il ne cache en fait qu’une conception très pauvre du commun. Le « vivre ensemble » se résume bien souvent à « un consommer ensemble ». Lors du terrible attentat du Bataclan (13 novembre 2015) qui aurait pu être pour notre nation l’occasion de s’unir autour de finalités nobles, l’une des rares injonctions adressée au peuple fut de retourner occuper les terrasses de café (!). « Face à la barbarie, citoyens, consommez ! » C’est un peu court comme visée morale et politique. Nos aspirations se sont appauvries3.
L’autre forme de résistance au bien commun, intrinsèquement liée à la précédente, découle de la vision libérale de la politique sur laquelle roulent nos démocraties modernes4. Les théories modernes refusent de penser les finalités de la politique en terme de bien commun. Cette notion, jugée trop dogmatique et religieusement connotée, en définissant un idéal commun de la vie bonne ne pourrait conduire qu’au fanatisme. Au nom d’une conception a priori du bien commun, on justifierait la marginalisation et la persécution de ceux qui ne suivraient par cet ordre moral. Ainsi dans les régimes libéraux, la question du bien devient une affaire strictement privée et subjective. Chacun est libre de mener la forme de vie qui lui convient, dans les limites de la non-nuisance à la liberté d’autrui. Les finalités ou les missions de l’État moderne s’en trouvent alors considérablement réduites. Elles se résument à assurer la sécurité du peuple comme condition pour l’exercice de ses libertés, surtout dans le domaine économique, ainsi qu’au respect des droits individuels et à la création de droits nouveaux qui entérinent l’évolution des mœurs. On ne parle plus de bien commun, mais d’intérêt général, tantôt somme des intérêts particuliers, tantôt expression d’une volonté générale. Dans les deux cas, l’intérêt général ne promeut pas une conception objective du bien de la communauté humaine, mais seulement les libertés individuelles, comme ultime valeur.
Première approche du bien commun
Opter de nouveau pour le bien commun s’avère au plan pratique une tâche ardue au regard du contexte qui est le nôtre. Au plan théorique, les difficultés sont aussi nombreuses. Si le Magistère use de la notion de bien commun comme un leitmotiv, les définitions qu’il en propose existent bien, mais ne permettent pas toujours de s’en faire une idée claire. La consultation du Catéchisme ou du Compendium de la doctrine sociale de l’Église peut laisser en effet le lecteur perplexe. On y affirme que chaque communauté possède son bien commun, mais sans préciser lequel. Et s’il existe plusieurs communautés, y auraient-ils donc plusieurs biens communs ? Mais le bien commun n’est-il pas un ? Ces questions et bien d’autres révèlent les difficultés d’interprétation du concept de bien commun au point de le discréditer aux yeux de nombreux théoriciens. Le bien commun ne serait qu’une fiction, une coquille vide et donc sans utilité pour régler l’ordre politique et social.
Afin de bien saisir le principe du bien commun, il convient d’abord de rappeler deux vérités anthropologiques. La première est que l’homme porte en lui une aspiration au bien. La quête du bien n’est ni accidentelle, ni optionnelle. Elle n’est pas réservée à une catégorie d’hommes qui aurait le loisir de se poser des questions existentielles. Comme le disaient déjà les Anciens, « tout homme désire être heureux ». Le Catéchisme se fait l’écho de ce désir naturel du bonheur en citant saint Augustin : « Tous certainement nous voulons vivre heureux, et dans le genre humain il n’est personne qui ne donne son assentiment à cette proposition avant même qu’elle ne soit pleinement énoncée. » (CEC 1718) Ainsi, il est dans la nature humaine de rechercher le bonheur, c’est-à-dire un bien qui va accomplir pleinement notre humanité. La deuxième vérité anthropologique concerne la sociabilité : « La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. » (CEC 1879) L’homme est par nature un animal social et politique.
Ces deux vérités anthropologiques permettent de saisir que le bien commun ne saurait consister en la seule somme des biens individuels. Comme le dit Benoît XVI dans Caritas in veritate, le bien commun est le « bien lié à la vie en société ». « C’est le bien ''du nous tous'', constitué d’individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté sociale. Ce n’est pas un bien recherché pour lui-même, mais pour les personnes qui font partie de la communauté sociale et qui, en elle seule, peuvent arriver réellement et plus efficacement à leur bien. » (CV 7) Le bien commun dont parle l’encyclique est ici le bien de la cité, autrement dit de la communauté politique, la forme la plus élevée de société humaine. Les autres formes de sociétés, qu’elle soit naturelle comme la famille, ou fruit de la volonté humaine comme les associations et les autres groupes intermédiaires, ont aussi leur bien commun. Dès qu’il y a un « nous », il y a bien commun. Les biens communs des groupes intermédiaires sont liés organiquement au bien commun de la communauté politique. Ils ont certes leur consistance propre, mais ils dépendent de la communauté politique, car sans elle ils ne pourraient pas être complètement réalisés : « L’individu, la famille, les corps intermédiaires ne sont pas en mesure de parvenir par eux-mêmes à leur développement plénier » (CDS 168) ; « Il revient à l’État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile, des citoyens et des corps intermédiaires. » (CEC 1910) En retour, le bien commun de la communauté politique dépendra de la réalisation effective des biens communs intermédiaires.
S’il existe des liens de dépendance entre les biens communs des diverses réalités sociales, il existe aussi un lien de dépendance entre le bien dit « individuel » et le bien commun. Notre bien personnel dépend du bien commun : « le bien commun que les hommes recherchent et poursuivent en formant la communauté sociale est une garantie du bien personnel… » (CDS 61). En effet, tout être humain est une réalité individuelle, mais il n’en demeure pas moins un être de nature sociale. Même au zénith de notre existence et donc de notre autonomie, nous sommes toujours dépendants des autres. Nous recevons constamment des autres et des communautés tout un ensemble de biens sans lesquelles nous ne pourrions pas être heureux et tout simplement vivre. « La personne ne peut pas trouver sa propre réalisation uniquement en elle-même, c’est-à-dire indépendamment de son être « avec » et « pour » les autres. » (CDS 165) Rare sont les hommes qui peuvent subsister hors de tout lien social, en milieu privé d’êtres humains. En vérité, leur technique de survie est en elle-même un don reçu, fruit de l’expérience d’autres hommes. En chaque « je » individuel, il y a toujours du « nous ». La dépendance dans l’ordre des biens est constitutive de la dépendance inscrite au cœur de la nature humaine. Ainsi, bien qu’il soit possible de parler de biens individuels, ces biens sont toujours en même temps des biens communs. Ils sont communs quant à leur origine, parce que nous ne pouvons les atteindre qu’en compagnie des autres. Ils sont aussi communs quant à leur fin, car ces biens profitent toujours au corps social. Cet aspect est exprimé avec concision dans le Catéchisme : « Conformément à la nature sociale de l’homme, le bien de chacun est nécessairement en rapport avec le bien commun » (CEC 1905). Pas de recherche du bien personnel sans recherche du bien commun et réciproquement.
A la lumière de ce qui vient d’être énoncé, on peut citer ce long passage du Compendium qui résume les développement précédents : « Le bien commun ne consiste pas dans la simple somme des biens particuliers de chaque sujet du corps social. Etant à tous et à chacun, il est et demeure commun, car indivisible et parce qu’il n’est possible qu’ensemble de l’atteindre, de l’accroître et de le conserver, notamment en vue de l’avenir. Comme l’agir moral de l’individu se réalise en faisant le bien, de même l’agir social parvient à sa plénitude en accomplissant le bien commun. De fait, le bien commun peut être compris comme la dimension sociale et communautaire du bien moral. » (CDS 164) On pourrait ajouter que dans la mesure où il n’y a pas de bien personnel qui ne soit ordonné au bien commun, il n’y a pas non plus d’agir moral plénier sans agir social. Notre vie morale est intrinsèquement communautaire. C’est en cherchant à réaliser le bien des autres comme étant le sien que l’être humain accomplit son inclination au bonheur dans la ligne de sa nature sociale.
Pour une politique du bien commun
Comment accomplir le bien de la communauté politique ? Il faut maintenant passer de la théorie à la pratique et cela pour deux raisons. Premièrement, par delà la définition du bien commun, le propos de cette conférence vise à montrer comment la doctrine de l’Église peut aider le politique à retrouver des chemins concrets pour réaliser le bien commun, seul antidote à la dégradation de la société. La deuxième raison tient à la nature même du bien commun politique. Il n’est jamais une solution toute faite qui pourrait être élaborée par une équipe de consultants et qu’il suffirait de mettre en œuvre. Le bien commun ne préexiste pas en théorie, mais il est à une réalité pratique à construire dans l’agir communautaire par ceux qui sont les acteurs de la société. Il n’est pas la seule affaire de l’État ou des politiques, mais exigent la participation de tous. Il se définit et prend forme par l’intermédiaire du fonctionnement des institutions de l’État, et notamment dans le travail de délibération de nos élus et l’élaboration des lois, dans l’activité économique, ainsi qu’au sein de toute activité collaborative, dans les associations ou tout simplement dans les familles. Le bien commun politique est ainsi un bien historiquement réalisable. Comme toute réalité d’ordre pratique, le recherche et la réalisation du bien commun dépendra des circonstances, de la configuration et de l’histoire du pays, des ressources, de nombreux facteurs humains ou non… Le bien commun est constitutivement fragile d’où la mission qui incombe à l’État de la défendre. Comme l’écrit François Daguet : « S’il est si difficile de traiter directement du bien commun, si l’on est porté spontanément à en parler sans l’avoir défini, c’est qu’il ne se laisse pas définir aisément. Le bien commun, ici-bas, est un bien vers lequel on tend sans jamais l’atteindre autrement que partiellement, il se construit et se défait sans cesse, il est comme un terme vers lequel on tend sans jamais pouvoir le saisir5. » Qui veut œuvrer en vue du bien commun doit accepter qu’une telle entreprise ne soit jamais achevée. Cette dimension d’inachèvement peut avoir quelque chose de frustrant et de démobilisant. Elle est aussi un appel à la dépossession. Nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien des générations à venir.
Sans définir à la place des communautés leur bien commun, la doctrine sociale de l’Église pose comme point de départ à son élaboration que « le bien commun comprend “l’ensemble des conditions sociales qui permettent aux groupes et aux personnes d’atteindre leur perfection, de manière plus totale et plus aisée“ (GS 26) » (CEC 1924). En effet, sans ces conditions qui assurent à tous le minimum pour tout simplement « mener une vie vraiment humaine », il ne serait pas possible de mener une vie bonne, c’est-à-dire une vie morale qui accomplisse notre humanité. L’exercice plénier de notre part la plus noble exige que nous n’ayons pas à lutter pour survivre. Cet « ensemble de conditions sociales » constitue le fondement ou les conditions de possibilité de la recherche du bien commun. Le Magistère précise qu’à ce niveau fondamental le bien commun comporte trois éléments essentiels : le respect et la promotion des droits de la personne, « le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires », et enfin « la paix sociale », « c’est-à-dire la stabilité et la sécurité d’un certain ordre » (LS 157).
Dans nos régimes démocratiques, l’autorité publique assure en général sa mission de rendre accessible à tous les biens matériels et spirituels pour mener une vie vraiment humaine : « nourriture, vêtement, santé, travail, éducation et culture, information convenable, droit de fonder une famille… » (CEC 1908). Il en va de même pour le soutien que l’État accorde aux entreprises et aux divers corps intermédiaires de la société civile pour accomplir leurs finalités et par là contribuer au bien commun. Enfin, la sécurité des citoyens est garantie. Bien sûr, en chacun de ces domaines, un mieux est toujours souhaitable et possible.
Là où la politique manque malheureusement à ses devoirs et nuit à la réalisation du bien commun, c’est dans le respect de la personne humaine et de la promotion de la famille. Dans les démocraties dites modernes, les lois civiles qui « autorisent et favorisent l’avortement et l’euthanasie s’opposent, non seulement au bien de l’individu, mais au bien commun » (Evangelium vitae - EV 72). « En effet, développe l’encyclique L’Evangile de la vie, la méconnaissance du droit à la vie, précisément parce qu’elle conduit à supprimer la personne que la société a pour raison d’être de servir, est ce qui s’oppose le plus directement et de manière irréparable à la possibilité de réaliser le bien commun ». Dans nos sociétés, la cœxistence d’une affirmation « des valeurs comme la dignité de la personne, la justice et la paix » et la tolérance ou la pratique des « formes les plus diverses de mépris et d’atteinte à la vie humaine » (EV 101) ne peut que saper le fondement de la démocratie. Le relativisme moral altère profondément la vie en société (EV 20). De même, les lois civiles qui ont contribué d’abord à fragiliser le lien conjugal puis à dénaturer le mariage, ont conduit à un affaiblissement de la famille comme institution naturelle. Parmi les divers corps intermédiaires qui existent entre la personne et l’État, la famille tient une place unique en tant que cellule de base de toute société. La famille, par sa mission éducative, contribue d’une manière unique et irremplaçable au bien commun, puisqu’elle est « la première école de vertus sociales ». C’est au sein de la famille que les futurs citoyens acquièrent les vertus, c’est-à-dire les dispositions de caractère sans lesquelles aucun bien moral n’est réalisable. Parmi ces vertus, on peut citer la modération, la justice ou la solidarité.
Une politique du bien commun sera en priorité un « agir en faveur de la vie » ainsi qu’une promotion et une défense de la famille. Elle veillera aussi à lutter contre le relativisme des valeurs en cherchant à retrouver une morale commune. Ainsi, une politique du bien commun ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur la nécessité de réaffirmer l’existence de normes morales stables et objectives, qui seules « constituent le fondement inébranlable et la garantie solide d’une convivialité humaine » (Veritatis splendor, VS 96). Seule la référence à la loi naturelle peut garantir le bon fonctionnement des institutions au service du bien commun des personnes. Enfin, une politique du bien commun visera une moralisation de l’autorité, c’est-à-dire « un appel aux vertus qui favorisent la pratique du pouvoir dans un esprit de service (patience, modestie, modération, charité, effort de partage) ; une autorité exercée par des personnes capables d’assumer de façon authentique le bien commun comme finalité propre de leurs propres actions, et non pas le prestige ou l’obtention d’avantages personnels. » (CDS 410)
La recherche bien commun comme forme de vie
La recherche du bien commun présuppose un certain nombre de conditions culturelles et institutionnelles favorables ainsi qu’une conception objective du bien humain. Ces données préalables ne sont pas le tout de la recherche du bien commun, bien qu’elles constituent déjà un immense chantier. La recherche du  bien commun doit être pensée et vécue comme une forme ou un style de vie (LS 202-203) où est maintenue l’exigence de toujours viser les biens nobles, les biens les plus excellents qui accomplissent notre nature humaine et pas seulement les réalités utiles ou plaisantes. Cette forme de vie requiert l’acquisition et la pratique des vertus. Enfin, elle se vit toujours en compagnie des autres.
bien commun doit être pensée et vécue comme une forme ou un style de vie (LS 202-203) où est maintenue l’exigence de toujours viser les biens nobles, les biens les plus excellents qui accomplissent notre nature humaine et pas seulement les réalités utiles ou plaisantes. Cette forme de vie requiert l’acquisition et la pratique des vertus. Enfin, elle se vit toujours en compagnie des autres.
Ce style de vie prend sa source dans les grandes inclinations de la nature humaine qui visent le bien, le vrai et le beau. Cependant, il demeure difficile de mettre en œuvre cette forme de vie tant est grande notre propension à nous satisfaire de biens moindre, à préférer un simple bien-être socio-économique au vrai bonheur. La présence des chrétiens dans la société doit contribuer à maintenir un idéal élevé de la vie bonne par l’invitation constante à viser plus haut. En rappelant que l’homme ne peut pas se réaliser totalement dans l’immanence de cette vie, les chrétiens témoignent de l’existence d’un bien commun transcendant tout ce que les hommes peuvent accomplir dans l’histoire. Le bien commun de la société, digne d’être recherché pour lui-même, n’est pas une fin en soi. « Il n'a de valeur qu’en référence à la poursuite des fins dernières de la personne » : Dieu comme bien commun universel de la création (CDS 170).
NOTE
1 Texte d’une conférence délivrée le 21 mars 2018 dans le cadre d’une formation à la doctrine sociale de l’Église organisée par le diocèse de Montauban (France).
2 Sur la question des rapports Église-État en France, cf. S. Perdrix, « Présence des catholiques français en politique : actualité et enjeux », Oikonomia (Ottobre 2018), p. 32-35.
3 Sur le thème de la pauvreté des aspirations, voir Michael J. Sandel, Justice, Paris, Albin Michel, 2016, p. 384-388.
4 Sur l’aspiration à la neutralité axiologique de la société politique, cf. M. J. Sandel, Justice..., p. 363-369.
5 François Daguet, Du politique chez Thomas d’Aquin, « Bibliothèque thomiste, LXIV », Paris, Vrin, 2015, p. 76.
 IT
IT  EN
EN