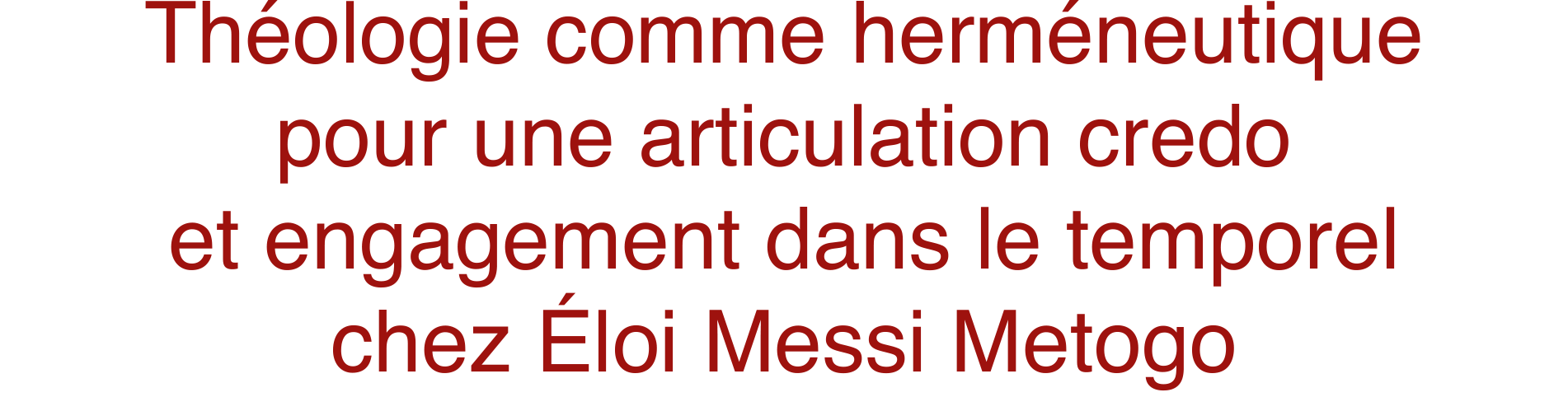
FRANÇOIS NDZANA
 a réflexion théologique, selon le Concile Vatican II, se fait à partir de la Parole de Dieu révélée et reçue.1 Elle s’enracine dans une tradition et honore un héritage. Mais elle se trouve aussi sollicitée par les questions vitales qui émergent en un temps et en un lieu. Dans cette perspective, le discours théologique ne se réduit pas à une pure spéculation sur des réalités intemporelles et étrangères aux expériences humaines. Il traite des questions fondamentales de l’existence des hommes. Fidèle à cette vision conciliaire, le théologien camerounais Eloi Messi Metogo assigne à la réflexion théologique, la tâche de déterminer les lieux précis où la responsabilité humaine est appelée à s’inscrire en des actions concrètes de rénovation personnelle et communautaire. Selon lui, faire de la théologie ne consiste pas à sacrifier au délire imaginaire ou à la construction esthétique des concepts, mais à chercher des réponses aux questions existentielles des hommes en interrogeant le donné révélé.2 C’est dans cette perspective qu’il convient de situer son œuvre et son apport à la théologie chrétienne.
a réflexion théologique, selon le Concile Vatican II, se fait à partir de la Parole de Dieu révélée et reçue.1 Elle s’enracine dans une tradition et honore un héritage. Mais elle se trouve aussi sollicitée par les questions vitales qui émergent en un temps et en un lieu. Dans cette perspective, le discours théologique ne se réduit pas à une pure spéculation sur des réalités intemporelles et étrangères aux expériences humaines. Il traite des questions fondamentales de l’existence des hommes. Fidèle à cette vision conciliaire, le théologien camerounais Eloi Messi Metogo assigne à la réflexion théologique, la tâche de déterminer les lieux précis où la responsabilité humaine est appelée à s’inscrire en des actions concrètes de rénovation personnelle et communautaire. Selon lui, faire de la théologie ne consiste pas à sacrifier au délire imaginaire ou à la construction esthétique des concepts, mais à chercher des réponses aux questions existentielles des hommes en interrogeant le donné révélé.2 C’est dans cette perspective qu’il convient de situer son œuvre et son apport à la théologie chrétienne.
En effet, une lecture attentive de l’essentiel de l’œuvre théologique du Dominicain Eloi Messi nous donne de voir que les champs investis par sa pensée traduisent son souci de faire du donné révélé, une source de réponses aux préoccupations existentielles de l’homme tout court, et de l’Africain en particulier. De « l’anthropologie religieuse » à la « christologie par le bas », en passant par l’appel à la responsabilité de l’Africain dans la construction de l’histoire de l’Afrique, le père Eloi Messi Metogo s’est fait le chantre d’une réflexion théologique force de relèvement de « l’humanité blessée » des hommes et des femmes de son temps. Pour notre contribution, nous développerons en deux points, trois grandes thématiques sur lesquelles sa pensée s’est déployée avec pertinence: « anthropologie et religiosité africaine », « l’humanité de Jésus comme socle d’une évangélisation authentique », et « l’appel à la responsabilité des Africains » pour sortir l’Afrique de son malaise actuel.
1. Sur l’anthropologie et religiosité africaine
Dans cette sphère de sa réflexion, le père Eloi Messi s’interroge sur le sens fondamentalement religieux reconnu à l’Africain et aux sociétés africaines. Dans son être profond, l’Africain est-il incurablement religieux comme s’attèlent à le démontrer les travaux d’ethnologues et autres théologiens africanistes comme François Kabasele Lumumba?3 Comment perçoit et pratique–t-il cette religiosité? A partir de ces interrogations, le père Eloi fait une analyse critique d’une certaine ligne de pensée théologique, socio-anthropologique et ethnologique qui, imputant l’indifférence religieuse africaine à l’influence des cultures étrangères, valide à tort la thèse du sens inné de la religion chez l’Africain. Pour eux, l’Africain est irrévocablement religieux. L’indifférence et l’incroyance lui viennent de la rencontre avec des cultures étrangères. Dans son ouvrage Dieu peut-il mourir en Afrique ? Essai sur l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire4, le théologien dominicain développe de façon argumentée et soutenue une thèse qui contredit le caractère irrémédiablement religieux de l’Africain. Contrairement à cette thèse communément admise par des travaux d’ethnologues, d’anthropologues et de théologiens africanistes, Eloi Messi relève dans les cultures des peuples africains, des traces de l’indifférentisme religieux et de l’incroyance. Cela démontre en réalité que l’Africain n’est pas irrévocablement religieux comme cela se dit. On pense, bien à tort, que l’indifférence religieuse et l'incroyance ne concernent pas l'Afrique; et qu’à tout prendre, il ne s’agit que d'importations étrangères tant il va de soi que l'Africain est doué d' « un sens naturel de la présence de Dieu ». Or l’étude objective des traditions connues révèle que les Africains ne croient pas tous en un Dieu unique, créateur et rémunérateur. La croyance à l’au-delà n’est pas aussi évidente qu’on le dit souvent. Il y a des cas d’incroyance dans les sociétés traditionnelles, et il existe une tradition de pensée critique à l’égard de la religion que l’on trouve dans un grand nombre de contes africains.5
En réalité, à travers cette prise de position, Eloi Messi soulève le débat sur la question de « l’identité culturelle et religieuse africaine ». Alors qu’une certaine théologie des valeurs culturelles africaines prône, selon la perspective de Ka Mana, le retour aux sources de l’authenticité des valeurs culturelle et religieuse ancestrales en vue d’un enracinement profond de l’Evangile en terre d’Afrique – ce qui dénote une conception fixiste de l’identité culturelle africaine –, le Père Eloi Messi s’inscrit plutôt dans une vision dynamique de l’identité culturelle africaine. L’Africain n’affirme pas son africanité à partir de l’argument d’un patrimoine culturel, au nom duquel les valeurs et autres semences de religiosité lui sont transmises de génération en génération. Une telle conception de l’identité culturelle et religieuse africaine est réductionniste et fixiste. Selon Eloi Messi, celle-ci (identité culturelle et religieuse) n’est ni un acquis, ni un héritage à recueillir et à transmettre. Elle n’est même pas à refonder dans un passé récent ou lointain, aussi élogieux soit-il. Mais c’est ici et maintenant qu’elle se construit et s’affirme dans l’actualité de l’histoire présente et ses enjeux: « l’identité culturelle africaine est un projet à réaliser à travers les tribulations, les aspirations et les attentes actuelles des peuples africains. Les réponses qu’on apportera aux défis actuels seront des éléments constitutifs de la culture africaine. Il importe de prendre la mesure de ces défis6 ».
Ainsi, si l’Africain est « foncièrement religieux », c’est dans l’aujourd’hui de l’histoire de l’Afrique que doit se déployer cette religiosité en faveur du relèvement des défis des hommes et des sociétés. Ce déploiement actuel interpelle l’Africain à bâtir « une culturelle qui ne se réduit pas aux seules valeurs spirituelles auxquelles l’Africain s’identifie, à ce qu’on appelle ‘les valeurs africaines’, à la musique et à la danse7 ». Elle implique la science, la technique, la technologie. Car, selon Eloi Messi, « les découvertes scientifiques, les techniques de production et de gestion des biens, les progrès de la démocratie font partie de la culture comme moyens qui nous permettent d’habiter paisiblement le monde d’aujourd’hui ». Il s’en suit que si l’Afrique accuse un grand retard face aux vrais défis du développement des Africains, et aux atouts disponibles pour les relever, si elle occupe la place du continent le plus pauvre, longtemps vaincu et colonisé malgré son « atout » de religiosité, cela est dû, selon Eloi Messi, à son infériorité matérielle et à sa conception réductionniste de la culture.8 Ses économies majoritairement agraires se caractérisent par des pratiques de production anciennes, avec absence des technologies humainement maîtrisables, capables d’outiller les acteurs pour un développement respectueux des enjeux de promotion de la « montée humaine » et de préservation de l’environnement. Eloi Messi rappelle donc aux Africains que c’est au prix de la maitrise de la science et de la technique, ainsi que d’une bonne conception de la culture, que l’Afrique retrouvera son indépendance et sa fierté perdues.9 La culture ne se réduit pas à un ensemble de valeurs spirituelles anciennes. Mais elle intègre la science et la technologie.
Cette approche d’Eloi Messi fait prendre conscience du réductionnisme qui caractérise la culture africaine dans sa rencontre avec les autres cultures au nom de la mondialisation. A l’heure où les peuples sont invités à la rencontre interculturelle du donner et du recevoir, la question que nous nous posons à la suite d’Augustin Messomo Ateba est la suivante: quel est l’apport de l’Afrique à ce rendez-vous des échanges entre peuples et cultures10? Alors que la culture occidentale dispose aussi bien de la puissance économique, technologique, artistique que des institutions politiques fortes et efficaces, offrant au monde le « paradigme occidental »; alors que la Chine et son « modèle chinois » occupe une place incontournable dans la scène mondiale, et que l’Inde affirme mondialement son émergence irréversible, l’Afrique pourtant qualifiée par le pape Benoit XVI de « poumon spirituel de l’humanité », peine à exister pour elle-même et aux yeux du monde. Comment expliquer un tel paradoxe pour un continent attaché à de nombreuses traditions et valeurs spirituelles ? Les valeurs de croyances religieuses, de solidarité africaine, d’hospitalité, d’harmonie et de respect de l’environnement ne sont-elles pas au final, un leurre pour le continent africain ? L’Africain qui réduit sa culture à ces valeurs ne s’endort-il pas dans sa léthargie sociale en face d’autres cultures qui s’outillent en science, technique et technologie pour leur développement?
En réponse à ces interrogations, l’analyse d’Eloi Messi interpelle et sensibilise. L’échec de l’Afrique est certainement dû à une mauvaise compréhension du « spirituel ». L’Africain semble en effet opposer le « spirituel » au « matériel11». Ce qui est spirituel, qui renvoie au rapport de l’homme avec Dieu, s’oppose radicalement au « matériel » et compromet sérieusement l’accomplissement de l’harmonie recherchée avec Dieu et les ancêtres. Il en résulte une dichotomie entre la sphère du « spirituel » et celle du « temporel ». Non seulement le spirituel n’impacte pas sur le monde réel pour sa transformation, mais il se vit surtout en marge du monde et ses réalités politiques, économiques, environnementales. Il s’érige donc une barrière entre la dimension spirituelle de la vie des hommes, et ce qui relève des dimensions sociales, économiques, politiques et techniques. Chez certains Africains chrétiens, on retrouve les traces de cette dichotomie soit dans une conception erronée d’une foi reléguée dans la sphère du privé, souvent débarrassée de ses dimensions sociales et politiques12, soit dans une mauvaise conception du Salut chrétien, réduit à sa seule dimension eschatologique, perdant de vue le principe de « la praxis de l’envoi » qui induit selon Jürgen Moltmann, « la possibilité de transformer le monde » au nom de l’espérance eschatologique13.
Conscient du risque d’immobilisme social qu’une telle conception de la foi peut provoquer en Afrique, Eloi Messi assigne aux Églises d’Afrique la mission de former les chrétiens authentiques dans leur foi, c’est-à-dire des chrétiens de synthèse, hommes et femmes de foi et d’action. Selon lui, les Églises d’Afrique ne pourront pas faire face à la léthargie sociale sans dégager les hommes et femmes d’une conception de la foi qui occulte les vrais problèmes et les défis à relever14. C’est pourquoi « l’homme africain restitué à l’histoire devrait aborder la théologie dans le souci d’une transformation de sa situation dans le monde. Parti des textes sacrés et différents commentaires auxquels ils ont donné lieu le long des siècles, il doit revenir pour la constitution d’un discours théologique autonome et rigoureux, à la réalité concrète, à la vie quotidienne où son peuple est constamment méprisé et exploité15 ». Les théologiens et les Eglises devront donc se donner un projet mobilisateur pour mettre un terme à la dépendance économique vis-à-vis de l’extérieur, assurer la formation et la participation du peuple chrétien aux projets communs. La réflexion théologique devra relever les défis de la modernité et inspirer une pratique libératrice de l’homme aliéné16.
En théologien averti, pour promouvoir ce passage du discours théologique à l’action, et du sommeil social à la transformation des sociétés, Eloi Messi enracine son énoncé théologique dans la « Christologie par le bas ». Il présente l’humanité de Jésus comme socle de l’évangélisation en contexte de paradoxe d’une « Afrique très pieuse et religieuse » en apparence, mais qui, dans sa pratique de foi, sépare maladroitement sa religiosité de son engagement à transformer le temporel.
2. De l’humanité de Jésus comme socle d’évangélisation et d’appel à la responsabilité des Africains bâtisseurs d’une Afrique nouvelle
Dans son ouvrage Théologie africaine et ethnophilosophie, Eloi Messi affirme au sujet de l’identité de Jésus que « le visage de Jésus est celui d’un homme inconditionnellement libre pour aimer, et, par cela même, libérateur de ses frères17 ». Pour appeler à la conversion des cœurs et opérer son œuvre libératrice, Jésus pose des gestes actualisés au cœur des enjeux sociaux de son milieu qu’il remet en cause avec une radicalité intransigeante. Il dénonce l’hypocrisie des scribes et des pharisiens (Mt 23, 13), fustige le marchandage au temple (Jn 2, 16) et met en garde contre le pouvoir tyrannique des dirigeants (Lc 13, 32); autant de gestes par lesquels il affirme sa messianité. A ce titre, la pratique de Jésus en son temps revêt une signification et une densité politique évidentes. Et c’est à cause de cet engagement même que, devenu intolérable aux pouvoirs en place, il est mis à mort. Mais que, également, son existence est « ratifiée » par Dieu18. Selon Eloi Messi, l’acte de profession de foi des chrétiens en ce Jésus Messie et Fils de Dieu, « vrai Dieu et vrai homme », ne devrait pas omettre cette dimension « d’engagement social et politique » du Messie prédicateur de justice et promoteur de dignité de l’homme.
Il s’en suit que l’humanité de Jésus, riche d’actions et de gestes de grande portée socio-politiques, est un socle pour l’évangélisation authentique aujourd’hui. Elle invite les chrétiens à ne pas passer à côté de leur mission d’incarner dans la vie sociale et politique, les valeurs de l’Évangile à la manière du levain dans la pâte. Ils sont appelés à dénoncer les injustices et les erreurs de gestion et de gouvernance, et promouvoir la vérité pour tous. C’est dans cette humanité de Jésus qu’Eloi Messi puise les arguments pour dénoncer la léthargie des Africains, due selon le Dominicain, à la séparation radicale du sacrée et du profane. La foi est mise en retrait de la société. A la suite de Jacques Maritain, Eloi Messi pense qu’on ne peut pas être un chrétien authentique en restant insensible aux défis posés aux hommes et aux peuples de son temps19. C’est dans l’engagement, au nom de l’Evangile, que l’identité chrétienne trouve sa pleine expression.
Dans cette perspective, la mission du chrétien implique une réalisation socio-temporelle des vérités évangéliques. Celles-ci ne se limitent pas dans les choses du culte et de la religion et, du moins chez les « meilleurs chrétiens », dans les choses de la vie intérieure20. La spiritualité ne se vit pas en autarcie. Elle n’a rien d'un enclos d'autoprotection, de repli sur soi traduisant une certaine fuite du monde et une retraite décrochée. Elle est plutôt un lieu vital de ressourcement. Car sans la spiritualité, même les engagements les plus généreux finissent par s'assécher. Sans elle, les liturgies sont insipides. Sans elle, même les Églises deviennent des organisations bureaucratisées, fonctionnalisées. C’est grâce à elle que les vérités évangéliques se déploient dans les choses de la vie sociale, économique et politique21. Il n'y a donc pas d'engagement résolu sans une réelle jonction entre l’intériorité capable de foi et d'espérance, et la temporalité promotrice d’actions concrètes. Deux pôles matériels et spirituels inséparables chez Eloi Messi. Ils se renforcent l'un et l'autre quand on les vit ensemble. C’est pourquoi le Dominicain se méfie d'une intériorité sans engagement, tout autant que d'un engagement sans intériorité.
Mais si Eloi Messi observe une dissociation fréquente entre l’intériorité et la temporalité chez l’Africain, on doit reconnaître aussi que leurs rapports sont sans cesse à repenser et à renouveler. Et c’est là le défi pour les Églises et les théologiens africains: trouver une synthèse actualisée entre l’acte de foi et l’engagement dans le temporel. La meilleure synthèse entre les deux dimensions, se trouve dans l’humanité de Jésus, qui nous rappelle que, c’est dans nos profondeurs humaines et spirituelles que s’exprime notre engagement concret à transformer le monde.
En proposant une anthropologie religieuse fondée sur l’humanité de Jésus, Eloi Messi a pour objectif de sortir l’Africain de ses sempiternelles pleurnicheries à travers lesquelles il pointe du doigt les autres comme cause de ses malheurs: traite  négrière, colonisation etc. L’appel à la prise de responsabilité invite tous les Africains à s’impliquer au nom de leur foi, comme acteurs des projets communs, chacun à son niveau, dans une approche par réseaux de proximité, d’amitié, et de compétence. La force d’une telle mobilisation émerge d’une foi pleinement conséquente des enjeux politiques et socio-économiques de nos sociétés.
négrière, colonisation etc. L’appel à la prise de responsabilité invite tous les Africains à s’impliquer au nom de leur foi, comme acteurs des projets communs, chacun à son niveau, dans une approche par réseaux de proximité, d’amitié, et de compétence. La force d’une telle mobilisation émerge d’une foi pleinement conséquente des enjeux politiques et socio-économiques de nos sociétés.
Prof. Dr François NDZANA
UCAC-Yaoundé
NOTE
1 Cf. Vatican II, Constitution Dei Verbum 9.
2 Cf. Messi Metogo Eloi, Introduction à la théologie chrétienne, cours dispensé à l’UCAC, année académique 2008-2009, inédit.
3 Cf. François Kabasele Lumumba, La religion africaine réhabilitée: regards, changements sur le fait religieux africain, Karthala, 2007.
4 Livre publié chez Karthala, Paris, 1997.
5 Cf. Ibid., Quatrième de couverture du livre.
6 Ibid., p. 186.
7 Ibid., p. 183.
8 Cf. Ibid.
9 Cf. Ibid., pp. 183-184.
10 Cf. Augustin Messomo Ateba, « Eloi Messi ou l’inculturation intégrale du christianisme en Afrique noire », in Mélanges, 2018, inédit.
11 Benoît XVI, Exhortation apostolique post-synodale Africae munus, n°177.
12 Voir J.B. Metz, La foi dans l’histoire et dans la société. Essai de théologie fondamentale pratique, traduit de l’allemand par Paul Corset, Paris, Cerf, 1979. L’auteur développe le thème de la « privatisation » de la foi aux pages 52-54.
13 Voir J. Moltmann, Théologie de l’espérance. Etudes sur les conséquences d’une eschatologie chrétienne, Coll Traditions chrétiennes, 12, Paris, Cerf, 1983, pp. 309-312.
14 Cf. Eloi Messi Metogo, op.cit., p. 215.
15 Eloi Messi Metogo, Théologie africaine et ethnophilosophie, L’Harmattan, Paris, p. 10.
16 Cf. Ibid.
17 Ibid., p. 37.
18 Cf. Idem.
19 Cf. Maritain Jacques, Lettre sur l’indépendance, OEC VI, p. 255.
20 Cf. Ibid.
21 Cf. Ibid., p. 344.
 IT
IT  EN
EN 











